AUX ORIGINES DU MAÎTRE DU SUSPENSE…
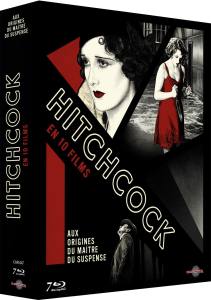 HITCHCOCK EN 10 FILMS
HITCHCOCK EN 10 FILMS
Tout a-t-il été dit ou écrit sur le cinéma d’Alfred Hitchcock ? Des écrits de Donald Spoto à ceux de Patrick Brion ou Laurent Bourdon sans évidemment oublier le remarquable et indispensable Hitchcock/Truffaut, on serait tenté de le croire. On se plonge dans ces ouvrages avec toujours le même plaisir de la (re)découverte. Mais rien, sans doute, ne vaut la preuve par l’image. C’est là que le beau coffret, qui sort chez Carlotta Films, est incontournable pour nous plonger dans les années anglaises de Hitch. Alfred Hitchcock est sans doute le réalisateur le plus emblématique de toute l’histoire du cinéma. L’adjectif « hitchcockien », intégré au langage courant pour définir le travail de nombreux cinéastes œuvrant dans le domaine du thriller, illustre à lui seul l’influence majeure qu’il continue d’exercer sur le septième art. Hitchcock entama sa carrière au début des années 1920 et réalisa son premier long-métrage, Le Jardin du plaisir, en 1925. Au cours des cinq décennies suivantes, il signa plus d’une cinquantaine de films, d’abord au sein de l’industrie du cinéma britannique, puis à Hollywood, où il tourna son ultime long- métrage, Complot de famille, sorti en 1976. Au fil du temps, il se bâtit une réputation incontestée de « maître du suspense », portée par des thèmes récurrents et des procédés stylistiques d’une profonde originalité. Dans un beau coffret collector édition limitée contenant sept Blu-ray superbement restaurés, on trouve dix films réalisés durant les cinq années qu’Hitchcock passa aux studios d’Elstree, chez British International Pictures. Ces œuvres témoignent d’une grande variété, tant par leur traitement cinématographique que par leurs sources d’inspiration : scénarios originaux (Le masque de cuir, À l’américaine) ou, pour la plupart, adaptations théâtrales ou littéraires (Laquelle des trois ?, Junon et le paon). Le passage d’Hitchcock chez British International Pictures peut se lire comme un diptyque, dont le premier volet célèbre l’apogée du muet, et où le réalisateur, nourri d’influences multiples, peaufine son art de la narration visuelle. Le second illustre sa rencontre avec l’avènement du parlant, initié à partir de 1929. Conçu à l’origine comme un film muet, Chantage (1929) fut rapidement adapté aux récentes avancées techniques et tourné dans une seconde version sonore. Fille d’un épicier, Alice White (Anny Ondra) tue, en état de légitime défense, un homme qui tentait de l’agresser. Son petit ami policier la couvre, mais un truand à la petite semaine l’a aperçue quittant les lieux et tente de la faire chanter. Déjà, dans Blackmail (en v.o.), on observe la manière dont les objets occupent une place déterminante dans le cinéma de Hitch. Partout, dans ces films anglais, on remarque, outre les premières apparitions du maître (dans Chantage, un gamin l’empêche de lire dans le métro), trouvailles visuelles et obsessions formelles qui séduiront pleinement dans les films de la période américaine. Parmi toutes ces pépites, on se régale, en particulier de Rich and Strange (A l’est de Shanghai, 1931), une comédie satirique qui est aussi une savoureuse évocation du mariage conçu comme un voyage au long cours. Fred et Emily Hill, un couple marié, partent en croisière pour fuir leur vie étriquée et routinière. Mais leur relation se délite lorsqu’ils succombent l’un après l’autre à l’attrait de compagnons de voyage. A Truffaut, Hitchcock confia que c’était son film préféré dans la période anglaise. Tandis que Spoto parle du film comme d’« une sorte de journal intime livré au public ». Assurément, le cinéaste se régale de la détérioration du couple qui deviendra l’un de ses thèmes de prédilection. Enfin, dans les suppléments exclusifs, outre un livret de 64 pages, on trouve le documentaire inédit écrit et réalisé par Laurent Bouzereau : Becoming Hitchcock (72 mn). Un trésor pour cinéphiles ! (Carlotta)
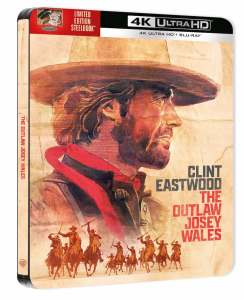 JOSEY WALES, HORS-LA-LOI
JOSEY WALES, HORS-LA-LOI
Vers la fin de la guerre de Sécession, Josey Wales cultive tranquillement son champ dans le Missouri quand des soldats nordistes surgissent, incendient son ranch, violent sa femme et massacrent sauvagement sa famille. Des partisans sudistes, aux ordres du capitaine Fletcher, arrivent peu après et Wales se joint à elle. Le Sud est vaincu et Fletcher annonce une amnistie aux partisans qui déposeront les armes. En fait, c’est un piège : lors de la reddition, au moment où les partisans prêtent serment à l’Union, les Nordistes les abattent à la mitrailleuse. Parce qu’il avait refusé de se rendre, Josey Wales échappe au carnage de même que Jamie, un jeune franc-tireur blessé. Comme Josey Wales avait abattu un grand nombre de Nordistes, sa tête est mise à prix. Un détachement nordiste commandé par Terrill et guidé par Fletcher le prend en chasse. L’objectif de Wales est de rejoindre les réserves indiennes où il pense qu’il sera en sécurité. Échappant aux battues, Wales et Jamie parviennent à traverser le Missouri puis à liquider deux imprudents qui espéraient les capturer pour toucher la prime. Le jeune partisan meurt peu après et Josey Wales se retrouve seul pour poursuivre son périple. En cours de route, il est rejoint malgré lui par un vieux chef indien philosophe dépossédé par Washington, puis par une jeune Indienne rejetée par sa tribu et traitée en esclave par un ignoble trafiquant. Mais bien des épreuves et des combats attendent encore Wales qui parviendra pourtant à rejoindre, avec quelques personnes amies, un solide ranch au milieu d’une clairière et au bord d’une rivière. Chacun a désormais un foyer. Wales va pouvoir repartir car il lui reste à éliminer le Nordiste responsable de la mort des siens… Avant de disparaître pour toujours. En 1976, Clint Eastwood est déjà un personnage marquant à Hollywood même s’il n’est pas (encore) considéré comme un artiste. Il a déjà tourné Les proies (1971), Un frisson dans la nuit (1971) et, bien entendu, L’inspecteur Harry (1971), un personnage qui va longtemps lui coller à la peau et lui valoir, en France, une étiquette de réactionnaire. Il signe ici un western emblématique (présenté dans une restauration 4K) qui explore les thèmes de la vengeance et de la survie dans le contexte tumultueux de la fin de la guerre de Sécession. Comme souvent dans ses westerns, Eastwood incarne un personnage charismatique et taciturne, apportant une profondeur à son rôle d’anti-héros. Josey Wales se distingue aussi par sa représentation nuancée des personnages indiens en évitant les stéréotypes habituels et souvent simplistes d’autres westerns. Enfin le film remet en question les mythes de la construction américaine, présentant les nordistes comme des opportunistes et les sudistes comme des victimes… (Warner)
 SEPTET : THE STORY OF HONG KONG
SEPTET : THE STORY OF HONG KONG
Johnnie To, Sammo Hung, Ann Hui, Patrick Tam, Yuen Woo-Ping, Ringo Lam et Tsui Hark appartiennent tous au meilleur du cinéma de Hong-Kong. Chacun, à sa manière, s’est illustré dans cette filmographie abondante et foisonnante. Initiateur du projet, Johnnie To, accompagné de six autres confrères et consœur, ont uni, pour la première fois, leurs talents afin de composer une symphonie d’histoires en hommage à leur ville. Entièrement tourné sur pellicule, Septet, ce sont sept cinéastes et donc sept regards qui partagent, en sept histoires, leurs visions d’une ville fascinante, des années 50 à aujourd’hui. Voilà un ambitieux projet que d’évoquer, entre nostalgie, changement et mémoire, une ville et son cinéma ! On sait que ce genre de « collage » ne fonctionne pas toujours bien mais les sept histoires courtes réunies, ici, se répondent de manière cohérente, dans la mesure où elles balayent, dans une succession de sept décennies, différents aspects de la ville sans pour autant tomber dans les clichés touristiques. Dans Exercise, pour les années cinquante, Sammo Hung évoque son enfance et l’entraînement rigoureux des jeunes artistes martiaux. Avec Headmaster, pour les années soixante, la cinéaste Ann Hui, considérée comme l’une des grandes figures de la Nouvelle vague hong-kongaise, traite de la relation entre un directeur d’école et une enseignante. Tender Is the Night, pour les années quatre-vingt, permet à Patrick Tam de raconter l’histoire d’un couple d’adolescents séparés par l’émigration. Dans Homecoming, Yuen Woo-ping, pour les années quatre-vingt-dix, aborde le lien entre un grand-père et sa petite-fille pendant la rétrocession. Avec Bonanza, pour les années 2000, Johnnie To met en lumière les ambitions financières de jeunes adultes durant la crise du SRAS. Pour les années 2010, Ringo Lam, disparu en 2018, évoque, dans Astray, la nostalgie d’un homme revenant à Hong Kong après des années d’absence. Enfin, Tsui Hark, pour les années 2020, signe Conversation in Depth qui se déroule dans un hôpital psychiatrique et aborde de manière bien foutraque des thèmes contemporains. Une lettre d’amour à Hong Kong ! (Metropolitan)
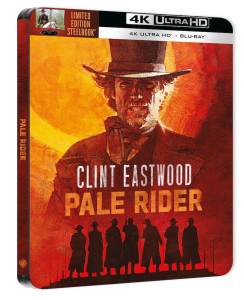 PALE RIDER, LE CAVALIER SOLITAIRE
PALE RIDER, LE CAVALIER SOLITAIRE
Les derniers chercheurs d’or indépendants de LaHood, bourgade minière de Californie, sont harcelés par les hommes de main du puissant Roy LaHood. Ce dernier a fondé la ville qui porte son nom et exploite une mine qui s’épuise. Pour se sortir d’affaire, il cherche à récupérer les parcelles des indépendants. Les malfrats partis, la jeune Megan Wheeler enterre son chien, innocente victime, et prie. C’est à ce moment que surgit de la montagne un cavalier solitaire tout de noir vêtu. Il est pasteur, comme l’atteste son col blanc, mais nul ne connaît son passé ni même son nom. Hull Barret, opposé depuis longtemps à Roy LaHood, l’accueille sous son toit. Pour réduire ce gêneur au silence, Roy Lahood fait appel à des tueurs à gages. Mais le cavalier solitaire ne va pas tarder à prouver ses qualités de tireur. Il élimine ainsi tous ses adversaires (dont le chef est surpris de le reconnaître juste avant de mourir) et disparaît en silence au fond d’un vaste paysage neigeux. Lorsqu’il tourne, en 1985, Pale Rider (présenté, ici, dans une restauration 4K), Clint Eastwood est définitivement reconnu comme un cinéaste et comme un artiste. D’ailleurs Pale Rider sera sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes. C’est aussi la période où il va entamer une carrière politique et devenir maire de Carmel. Avec le personnage silencieux et sans nom de ce western, considéré comme l’un des meilleurs des années 80, Clint Eastwood donne une figure énigmatique qui traverse l’aventure comme un être quasiment immatériel qui ne fait que passer. Les paysages sont rudes et magnifiques et le cinéaste s’applique à proposer, même si les scènes d’action sont nombreuses, une mise en scène stylisée, presque hiératique, voire austère où la violence est cependant omniprésente. Car le pasteur surgi de nulle part est bien venu pour faire régner le Bien contre le Mal, serait-ce à coups de colts. On pense parfois avec ce justicier mutique à certains des héros qu’Eastwood a incarné chez Sergio Leone. Une sorte de légende westernienne sensorielle et très dépouillée en forme de réflexion sur la justice et la rédemption, le titre lui-même renvoyant à un verset de l’Apocalypse. (Warner)
 DADDIO
DADDIO
Après avoir atterri à l’aéroport JFK de New York, une jeune femme prend, un soir, un taxi pour se rendre à son appartement de Manhattan. Pendant le trajet, elle échange avec Clark, le chauffeur de taxi. D’abord légère et banale, la conversation va prendre un tournant profond et criant de vérité sur des sujets sensibles comme l’amour, la perte, le sexe et la dynamique du pouvoir dans les relations. A l’heure des portables et des réseaux sociaux, l’échange avec l’autre devient une denrée rare. Et discuter dans un taxi avec le chauffeur se fait probablement de moins en moins. Mais plutôt que de s’isoler à l’arrière de son taxi, une jeune femme choisit de parler. Et plus encore à coeur ouvert. Avec Daddio, deux êtres aux parcours différents, que rien, à priori, ne devait rapprocher, vont partager un véritable contact humain et s’ouvrir l’un à l’autre pour parler des choses de la vie. Avec un dispositif minimaliste, la cinéaste et scénariste américaine Christy Hall, pour sa première réalisation, réussit un road-movie urbain qui se double d’un huis-clos intimiste. Pour porter un récit dont le charme repose sur les dialogues, elle doit évidemment s’appuyer sur deux comédiens en verve. C’est le cas du « vétéran » Sean Penn qui donne une performance subtile et en nuances. Mais c’est aussi le cas de Dakota Johnson, entrée dans l’histoire hollywoodienne avec l’Anastasia Steele du fameux (et un rien surfait) Cinquante nuances de Grey (2015) et qui constitue, en finesse, l’autre pendant de ce duo. A ce film presque contemplatif, Phedon Papamichael, directeur de la photo d’Alexander Payne (Sideways), de James Mangold (Walk the Line), Oliver Stone (W : l’improbable président) ou George Clooney (Monuments Men) apporte enfin un beau sens de la lumière… Captivant et même émouvant! (Metropolitan)
 CHUKA LE REDOUTABLE
CHUKA LE REDOUTABLE
Aventurier solitaire, Chuka est assiégé, avec des soldats, dans un fort de l’armée américaine. Autour de ce bastion retranché qui abrite une compagnie disciplinaire, des guerriers indiens s’apprêtent à lancer l’attaque. Ces Indiens sont, en effet, révoltés par la famine qui les décime. Pour éviter le massacre, il suffirait aux occupants du fort de partager leurs vivres avec ces hommes affamés. Mais le colonel Stuart Valois, responsable du fort, refuse catégoriquement… En 1967, Gordon Douglas met en scène ce western qui s’apparente souvent à un huis-clos avec cette troupe acculée alors qu’un assaut à l’issue inéluctable se prépare. Dans le fort, règne une ambiance délétère tandis que la discipline est maintenue coûte que coûte, quitte à donner du fouet à ceux qui ne marchent pas droit. Cet atmosphère crépusculaire se traduit notamment dans une séquence réussie de dîner bien arrosé dans le fort alors que les soldats poussés à bout sont prêts à exploser. Solide routier d’Hollywood pendant cinq décennies, Gordon Douglas (1907-1993) a tourné nombre de westerns mais aussi des films d’aventures ou de polars comme Tony Rome est dangereux (1967), Le détective (1968) ou La femme en ciment (1968), les trois avec Frank Sinatra. Ici, le rôle-titre de l’aventurier est tenu par Rod Taylor, acteur australien qui décrocha son premier grand rôle au cinéma en 1960 avec La machine à explorer le temps. Mais son rôle probablement le plus célèbre est celui de Mitch Brenner dans Les oiseaux (1963) de Hitchcock. Il tient son dernier rôle au cinéma en incarnant, dans une brève séquence face à Michael Fassbender, Winston Churchill dans Inglourious Basterds (2009) de Quentin Tarantino. Mené à un bon rythme avec une action quasi ininterrompue, avec une photographie soignée, avec de bons acteurs (outre Rod Taylor, on trouve ici l’excellent Ernst Borgnine ou le Britannique John Mills), Chuka le redoutable se regarde avec plaisir d’autant que la séquence finale est chargée d’émotion. (Sidonis Calysta)
 JAMAIS SANS MON PSY
JAMAIS SANS MON PSY
Célèbre psychanalyste à qui tout réussit, le Dr Olivier Béranger est pourtant à la peine. Il n’arrive pas à se débarrasser de Damien Leroy, un patient aussi angoissé qu’envahissant. Il tente alors que le convaincre de trouver enfin le grand amour. Une façon idéal de se reconstruire et même de guérir. Alors que le praticien s’apprête à fêter ses trente ans de mariage avec sa femme Paloma, leur fille Alice leur annonce avoir rencontré un homme. Olivier va vite déchanter en découvrant qu’il s’agit du collant Damien. Autant dire que les choses se vont pas s’arranger pour le docteur Béranger et sa famille… L’exemple même de la comédie de boulevard « à la française » avec un milieu bourgeois aisé dans lequel un trublion vient mettre la panique. Ici, c’est moins les problèmes d’un psy et de son client que d’un futur beau-père et d’un futur gendre. Derrière la caméra, on trouve Arnaud Lemort, un ancien du stand-up, de la Bande à Ruquier à la radio, passé à la réalisation en 2010 avec Dominique Farrugia pour L’amour, c’est mieux à deux qui remporta un joli succès dans les salles en passant la barre du million d’entrées. Ici, il retrouve, dans le rôle d’Olivier Béranger, Christian Clavier qu’il avait déjà dirigé, en 2018, dans Ibiza. L’ancien du Splendid et des Bronzés est évidemment efficace en type qui tente de tirer les ficelles face à l’humoriste Baptiste Lecaplain en patient qui finit par retrouver sa confiance en lui. Autour d’eux, on remarque Rayane Bensetti, Cristina Reali, Laurent Bateau, Thomas VDB et, dans le rôle d’Alice, Claire Chust, vue dans Scènes de ménage sur M6. Pas vraiment surprenant mais se regarde néanmoins agréablement. (Seven Sept)
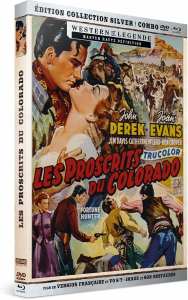 LES PROSCRITS DU COLORADO
LES PROSCRITS DU COLORADO
A la mort de son père alors qu’il n’avait que 15 ans, Jet Cosgrave avait été déshérité du ranch familial situé dans le Colorado par son oncle Linton après que ce dernier eu modifié le testament avec l’aide d’un avocat corrompu. Plusieurs années ont passé. Jet est de retour à Colton, Colorado, bien décidé à faire valoir ses droits sur ce qu’il considère être son bien, quitte à le reconquérir par la force faute d’y parvenir légalement. Il est bien décidé à voler les bêtes de son oncle Linton, à modifier leurs marques et ensuite à déloger voire tuer ce membre de la famille malveillant. A cet antagonisme familial vient s’ajouter une rivalité de voisinage, une haine farouche existant depuis quelques années déjà entre le despotique Linton et de modestes fermiers, les Polsen, qui se sont vus eux aussi dépossédés de portions de terres… Pour mener sa vendetta, Jet fait appel à une bande de mercenaires sans scrupules qu’il destine à combattre Linton (Jim Davis) et ses hommes. En arrivant en ville, Jet tombe sous le charme de Miss Austin (la charmante Catherine McLeod). Pas de chance, elle n’est autre que la future épouse de son oncle et ennemi juré… Réalisé en 1954 par William Witney (1915-2002), The Outcast (en v.o.) est un bon western de série B qui joue largement la carte de l’action sur fond de vengeance et de tensions familiales. A la tête d’une belle filmographie dans laquelle on trouve nombre de westerns, Witnet était connu pour avoir inventé une mise en scène alternant plusieurs plans serrés très courts avec un plan large long, cela afin de gagner du temps et d’avoir des séquences très dynamiques de bagarres. Même si l’intrigue est parfois confuse, on peut prendre plaisir aux bagarres qui opposent, à poings nus, Jet (John Derek) à son oncle ou encore une lutte à cheval filmée en gros plan. Enfin, grâce au procédé Trucolor, le film offre des images très lumineuses… (Sidonis Calysta)
 LES VIGNES DU SEIGNEUR
LES VIGNES DU SEIGNEUR
Henri Lévrier s’est expatrié pour oublier Gisèle dont il est secrètement amoureux. De retour en France, il est accueilli par la famille de Gisèle, son mari, le comte Hubert de Karadec, et sa mère. Ce retour coïncide avec celui d’Yvonne, la fille de Gisèle, qui rentre d’Angleterre où elle poursuivait ses études. Henri s’est guéri durant son exil de son penchant pour l’alcool et la mère de Gisèle conçoit le projet de lui faire épouser sa petite-fille, Yvonne. Celle-ci est accompagnée d’un jeune Britannique qui ne parle pas un mot de français, mais apprendra bientôt. Henri avoue à Gisèle qu’il s’est expatrié par amour et une idylle se noue entre eux. Celle-ci rend Henri tout à la fois heureux et terriblement angoissé à l’idée que son ami et mari de Gisèle, Hubert de Karadec, l’apprenne. Il prend mille précautions et invente une liaison imaginaire pour détourner d’éventuels soupçons. Tant et si bien que le romanesque de toutes ces manœuvres séduit la jeune Yvonne. Une rechute d’Henri dans l’alcool met un terme à la liaison avec Gisèle, tandis qu’un autre sentiment apparaît… En 1932, René Hervil adapte pour le cinéma une pièce de Francis de Croisset et Robert de Flers, auteurs dramatiques en vogue au début du siècle et jusque dans les années vingt. Acteur, réalisateur et scénariste, Hervil (1881-1960) est à la tête d’une solide filmographie qui débute dès 1912. Les vignes du seigneur, présenté dans la collection Découverte DVD, est une œuvre tardive dans laquelle Victor Boucher, connu pour ses interprétations chez Roger Richebé (L’habit vert en 1937) et Sacha Guitry (Faisons un rêve en 1936 ou Ils étaient neuf célibataires en 1939) , tient le rôle d’Henri Lévrier au coeur d’une comédie légère et sentimentale. En 1958, le cinéaste français Jean Boyer adaptera à son tour cette pièce et donnera le rôle de Levrier, l’alcoolique repenti, à Fernandel, alors au sommet de sa gloire… (Gaumont)
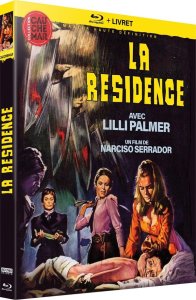 LA RESIDENCE
LA RESIDENCE
Au 19e siècle, la redoutable madame Fourneau, secondée par Irène, l’une de ses élèves, est la directrice très autoritaire d’un internat pour jeunes filles. Très possessive avec Luis, son fils de 16 ans, un adolescent asthmatique et voyeur auquel elle interdit toute rencontre féminine jusqu’à ce qu’elle lui présente un jour l’épouse qu’elle aura choisie pour lui. Mais Luis rencontre, en secret, une jeune fille. Celle-ci est assassinée et son corps disparaît. Alors qu’il regarde discrètement les élèves de l’internat prendre leur douche, Luis se retrouve coincé dans un conduit d’aération. Il sera délivré par Teresa, nouvellement arrivée dans l’établissement. Une idylle naît entre les deux. Mais Irène découvre la liaison. Teresa sera humiliée en public. Gravement blessée par cet acte de cruauté, elle tente de s’enfuir et sera assassinée elle aussi… Reprenant ses esprits, Irène ose dire à la directrice que ce qui se passe dans la maison va quand même trop loin . Il lui en cuira… Le cinéaste uruguayen Narciso Ibanez Serrador (1935-2019) a travaillé toute sa carrière en Espagne où il a signé des films d’horreur mais aussi beaucoup de programmes pour la télévision publique. Comme Les révoltés de l’an 2000 tourné en 1976, La résidence est l’un de ses films les plus connus dans le genre horrifique. Réalisé en 1969, le film est une belle démonstration de cinéma de genre. On y trouve l’internat à l’atmosphère étouffante, des jeunes filles qui s’ennuient et qui se laissent aller à leurs désirs charnels, une directrice bien toxique et son fils, un adolescent solidement tordu. Ce slaher distille une ambiance ténébreuse et permet à l’Allemande Lilli Palmer, star du cinéma germanique et partenaire de Jean Gabin dans Le tonnerre de Dieu (1965) de camper la « méchante » Madame Fourneau. Autour d’elle, les amateurs de cinéma d’horreur ibérique reconnaîtront trois icônes du genre : Cristina Galbó, Maribel Martín ou María Elena Arpón mais aussi, dans le rôle de Luis, John Moulder-Brown qu’on verra ensuite dans Deep End de Jerzy Skolimovski et Ludwig ou le crépuscule des dieux de Luchino Visconti. (Sidonis Calysta)
 SONIC 3
SONIC 3
Après Sonic, le film (2020) puis Sonic 2, le film (2022), le cinéaste américain Jeff Fowler remet ça avec un épisode 3, toujours adapté pour le grand écran de la série de jeux vidéo du même nom éditée par Sega dans lequel Sonic, Knuckles et Tails vont devoir batailler avec un certain Shadow, un ennemi puissant et mystérieux qui disposent de pouvoirs inédits. Dépassée dans tous les domaines, la Team Sonic devra former une improbable alliance pour tenter d’arrêter Shadow et protéger notre planète. Auprès du général Kenneth Walters, le commandant du G.U.N (Gardiens Unis de la Nation) le trio en apprend plus sur le passé de Shadow. Lorsqu’ils sont attaqués par des drones, le chef de l’armée est mortellement blessé mais il a le temps de confier à Sonic, une carte d’accès numérique et de l’avertir de la garder en sécurité… Bien des péripéties toutes plus redoutables les unes que les autres attendent encore Sonic, le hérisson anthropomorphe bleu, et ses amis. Le premier Sonic a été un imposant succès avec 2,1 millions de spectateurs dans les salles françaises, le second a fait un peu mieux encore (2,2 millions) et le troisième est monté encore un peu plus haut (2,6 millions), autant dire que le hérisson capable de foncer à une vitesse vertigineuse, a tout du superhéros qu’il parodie avec une sympathique bonne humeur. Sonic 3, on l’a compris, va aussi vite que ses prédécesseurs et amuse les petits (et les grands) avec des aventures joyeuses et farfelues qui mêlent allègrement animation et prises de vues réelles. On retrouve pour la troisième fois Jim Carrey en déjanté docteur Ivo Robotnik, James Marsden et Tika Sumpter en parents adoptifs et Keanu Reeves qui prête sa voix à Shadow, le surpuissant hérisson noir. Drôle, loufoque, enlevé et… rapide ! (Paramount)
 LES FAUX JETONS
LES FAUX JETONS
Associés milanais dans une entreprise de construction, Parodi et Manzini sont venus à Rome pour décrocher le contrat du Village de la jeune fille avec le président de l’institution, le sentencieux et moraliste Cipriano Paolini. Ce dernier est secondé par Bellini, un type aussi coincé que mielleux mais qui n’a pas son pareil pour obtenir de solides pots-de-vin destinés à leur parti politique. Si Bellini semble craindre les femmes, tous les autres sont des chasseurs de jupons qui ne dédaignent pas les services d’accortes masseuses. En réalité, un trio de prostituées bien décidées à se constituer un agréable et fructueux petit commerce… Mais lorsque la femme de Parodi débarque de Milan, les choses se compliquent… En 1962, le cinéaste italien Lucio Fulci (1927-1996) est au début d’une carrière qui fera de lui, selon les cas, le « poète du macabre » ou le « parrain du gore » à cause de son goût pour le giallo et les films d’épouvante considérés comme très violents pour l’époque. Ici, cependant, il signe une modeste pochade où s’enchaînent des gags et des quiproquos facilement prévisibles. Outre la présence de la belle Sylva Koscina, Le massaggiatrici (en v.o.) vaut par la présence de Louis Seigner (Paolini) et de Philippe Noiret dans le rôle de Bellini. L’acteur du Vieux fusil et de La vie et rien d’autre, entame, ici, une carrière dans le cinéma italien qui durera de longues années. Noiret, qui venait de tourner Zazie dans le métro de Louis Malle, tenait le film en piètre estime. Il avait accepté d’y jouer pour ne pas rester sans travail. Il devait en effet interpréter au théâtre une pièce avec Pierre Fresnay, mais ce dernier avait décidé au dernier moment de choisir un autre partenaire… (Gaumont)
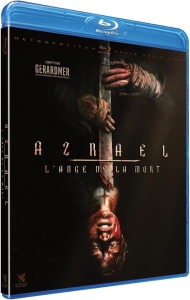 AZRAEL – L’ANGE DE LA MORT
AZRAEL – L’ANGE DE LA MORT
Alors qu’ils sont en train de se déclarer -en silence- leur amour en pleine nature, une jeune femme et son ami sont capturés par d’autres humains, appartenant à une communauté dévote, qui décident de les offrir en sacrifice, dans un étrange rituel, à de mystérieuses créatures. Ainsi Azrael est ligotée sur une chaise face à la forêt, tandis que ses ravisseurs tournent le dos à la scène et n’ont pas le droit de regarder ce qui s’approche. Personne ne dit mot. Forcément le langage humain a disparu de la surface de la Terre. Une bête difforme sort de la forêt en poussant des cris rauques. Cette bête humanoïde doit dévorer Azrael. Qui parvient pourtant à prendre la fuite. Et si sa fin n’était plus maintenant qu’une question de temps ? Car il s’agit bien d’apaiser, par sa mort, un esprit ancien et malveillant. Présenté en compétition au festival du film fantastique de Gérardmer, le film de l’Américain E.L. Katz, connu pour la comédie horrifique Cheap Thrills (2014), n’a manifestement pas bénéficié d’un énorme budget. Ainsi, cette série B part d’abord sur de bonnes bases, notamment en jouant de la suggestion et en prenant le parti de l’absence complète de dialogues. Mais la mise en scène se relâche ensuite, le film perd son rythme et les monstres déboulent dans tous les coins, faisant fi du mystère. Dans le rôle d’Azrael, on trouve la comédienne australienne Samara Weaving qui s’est fait une jolie place à Hollywood dans la comédie horrifique avec des films comme The babysitter (2017) ou Wedding Nightmare (2019) et qui tient bien la rampe avec un personnage qui subit toutes les avanies. (Metropolitan)

