FEMMES D’IRAN, MAMIES DU MORVAN ET BUSINESSMAN NEW-YORKAIS
 LES GRAINES DU FIGUIER SAUVAGE
LES GRAINES DU FIGUIER SAUVAGE
Une poignée de balles tombe, en gros plan, sur une table… Iman, robuste quinquagénaire barbu, ne sait pas encore que ces projectiles vont l’entraîner dans une terrible spirale. Après avoir longtemps oeuvré comme un fonctionnaire discret et zélé, Iman vient d’être promu juge d’instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran. Une nomination qui va lui assurer un sérieux bien-être matériel. Mais il devra être exemplaire dans un tribunal où l’atmosphère n’est pas des plus sereines. A cause de ses responsabilités, on lui a confié une grosse arme de poing qu’il range soigneusement tous les soirs dans un tiroir de sa chambre… Alors qu’Iman vient juste de prendre son poste, un immense mouvement de protestations populaires commence à secouer le pays. Nous sommes en septembre 2022, la jeune Mahsa Amini, 22 ans, vient de mourir dans un commissariat et le mouvement « Femme, Vie, Liberté » prend de l’ampleur. Dans la famille d’Iman, Rezvan et Sana, les deux filles, constamment sur leurs téléphones portables, soutiennent le mouvement avec virulence. Najmeh, leur mère, tente de ménager les deux camps. Iman, qui part à l’aube et revient tard le soir, est de plus en plus déconnecté des siens. Pire, dépassé par l’ampleur des évènements, Iman bascule dans la paranoïa lorsque son arme de service disparait mystérieusement… Plutôt qu’un brûlot politique, Les graines du figuier sauvage a la beauté d’une véritable chronique familiale. L’appartement cossu est un refuge pour la mère et les filles qui suivent les images, prises clandestinement par des portables et diffusées partout sur les réseaux sociaux, des manifestants et des militants des droits civiques traqués et frappés par la police. Lorsque Rezvan veut héberger, pour la nuit, Sadaf, une amie étudiante, sa mère s’y oppose. Mais Najmeh soignera Sadaf lorsque Rezvan ramènera son amie, le visage massacrée par un tir de chevrotines. De son côté, Iman perd complètement pied. Dans son travail, il est devenu suspect depuis que son arme a disparu. Persuadé que sa femme ou ses filles ont volé le pistolet, il va jusqu’à les jeter entre les mains des pires enquêteurs de la police islamique. Convaincu que le danger est partout, Iman décide de partir loin de Téhéran dans la maison où il a grandi… Du huis-clos de l’appartement de Téhéran à celui de la maison dans les montagnes, Mohammad Rasoulof construit un film constamment sous tension. Il passe même quasiment par la case thriller lorsque Iman, au volant de sa voiture, entame un rodéo pour échapper à des activistes qui l’interpellent pour pointer ses exactions. Quand, enfin, Iman sera parvenu dans sa maison, il perdra tout contrôle, allant jusqu’à mener, sur les siens, les mêmes sinistres interrogatoires qu’il pratique dans ses bureaux. De la même manière que le pistolet du film est une métaphore du pouvoir au sens large, l’immense bâtisse ocre, véritable labyrinthe dans lequel se poursuivent Iman, sa femme et ses filles, est une métaphore d’un pays où la liberté est un vain mot. Les graines du figuier sauvage est une œuvre puissante, sobre, bouleversante et utile. (Pyramide)
 QUAND VIENT L’AUTOMNE
QUAND VIENT L’AUTOMNE
Le jour de la Toussaint, Michelle attend la visite de sa fille Valérie qui doit venir lui rendre visite, dans son ravissant coin de la campagne bourguignonne, pour déposer son fils Lucas pour une semaine de vacances auprès de sa grand-mère. Celle-ci est partie, dans les bois, avec son amie Marie-Claude pour cueillir des champignons. Quelques heures plus tard, Michelle a cuisiné les champignons et se réjouit d’accueillir sa fille et son petit-fils. Si Lucas est ravi de retrouver Michelle, les relations de Valérie avec sa mère sont beaucoup plus tendues. Las, l’assiette de champignons passe mal. Valérie est transportée à l’hôpital pour un lavage d’estomac. De retour, elle décide de quitter immédiatement la Bourgogne avec Lucas. Le cinéaste de Grâce à Dieu (2018) et Eté 85 (2020) plante son décor dans la Nièvre, du côté de Donzy et de Cosne-sur-Loire pour un drame bien servi par les lumières mordorées du chef opérateur Jérôme Alméras. Un paysage automnal apaisé et quasiment immobile qui va venir en rupture avec l’histoire de Michelle, avec les doutes qui s’installent puisque rien n’est totalement volontaire ou clair dans ses actes. Car, pour être placée sous le signe de la douceur et de la simplicité, la mise en scène ne cesse jamais de distiller une tension et un suspense sur les véritables enjeux des personnages, confrontés à des cas de conscience complexes, au-delà du bien et du mal. Quand vient l’automne fait la part belle à deux femmes âgées. Véritable thriller avec ses fausses pistes (à chacun de se faire son opinion sur les motivations de Michelle), le film questionne le temps qui passe, le vieillissement, les silences du quotidien, les brèves absences, les douleurs muettes et infligées, une forme de protection comme moyen de survie, le poids de l’héritage mais aussi l’amour intangible pour un petit-fils. Magnifique quand, la gorge serrée par les rebuffades de sa fille, elle traverse, désabusée et perdue, son jardin potager, Michelle offre à Hélène Vincent, 81 ans, l’inoubliable Madame Le Quesnoy de La vie est un long fleuve tranquille (1988), l’un de ses plus beaux rôles au grand écran. Avec sa doudoune rose, Michelle partage une vraie amitié avec Marie-Claude, superbement incarnée par une Josiane Balasko dont la démarche, le corps, le visage dégagent une forte humanité. A côté de ces deux remarquables comédiennes, on retrouve, avec plaisir, Ludivine Sagnier (Valérie) qui revient au cinéma d’Ozon plus de vingt ans après Swimming Pool (2003) et Sophie Guillemin, lumineuse en femme-flic. Et puis on découvre, à chaque apparition un peu plus, Pierre Lottin qui fit ses débuts dans le rôle de l’aîné de la saga des Tuche (2011-2025) et qui impressionne, ici, dans le rôle de Vincent, le fils de Marie-Claude qui vient de sortir de prison. Avec une énergie qui fait songer au Depardieu des jeunes années, Lottin campe brillamment un type ambigu, vulnérable et inquiétant dont on se dit qu’il peut vriller à tout moment. (Diaphana)
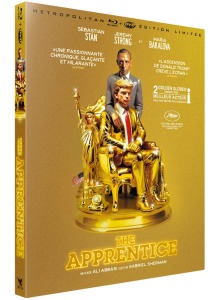 THE APPRENTICE
THE APPRENTICE
Bien avant de devenir milliardaire, star d’une émission de télé-réalité ou président des États-Unis, Donald J. Trump a été, dans les seventies, un travailleur acharné, déterminé à faire fortune sur le marché immobilier new-yorkais. Même si, à l’époque, Manhattan était considéré comme un quartier miséreux et gangréné par la criminalité, Trump était convaincu que la ville allait renaître de ses cendres et qu’il était l’homme de la situation pour mener cette renaissance – si seulement il avait les bons appuis. Ces appuis, il va les trouver en écumant les boîtes de nuit réservées à l’élite new-yorkaise. C’est là qu’il croise Roy Cohn, avocat aussi pugnace que sulfureux. D’emblée, les deux hommes se rapprochent dans la même volonté d’intégrer la haute société de New York qui les bat froid alors même que l’un et l’autre appartiennent à des milieux aisés. Connu pour Les nuits de Mashad (2022), le cinéaste irano-danois Ali Abbasi n’entend pas balayer tout le parcours de Trump. Il porte un regard plus intime sur un épisode de la vie de Trump qui aura des répercussions majeures sur la culture américaine et le monde dans son ensemble. Le projet du film date du printemps 2017. Trump est président depuis quelques mois seulement. Le scénariste Gabriel Sherman observe que, pendant sa campagne et ses premiers jours à la Maison Blanche, Trump se servait de tactiques auxquelles Cohn l’avait initié, notamment utiliser les médias. Car faire parler de soi aux infos est un moyen d’obtenir du pouvoir. La relation entre Trump et Cohn donne naissance à un conte moral en forme de thriller sans coups de feu mais non sans violence. On y voit comment un jeune entrepreneur qui cherche ses mots tout comme l’approbation et la reconnaissance de son père, tombe sous le charme d’un Cohn qui va lui livrer toutes les ficelles pour mettre à profit un système corrompu en usant de méthodes aussi sournoises que féroces. Ainsi Roy Cohn lui fournit trois commandements capitaux. Règle n°1 : Attaquer. Attaquer. Attaquer. Règle n°2 : Ne rien reconnaître. Tout nier en bloc. Règle n°3 : Revendiquer la victoire et ne jamais reconnaître la défaite. De son côté, le credo de Trump est simple comme bonjour. « Dans la vie, dit-il, il y a deux types de gens. Les tueurs et les losers ». On a compris que lui se situe du côté des gagnants. Donc des tueurs. Sebastian Stan campe un jeune Trump excessif et haineux et à la morale sinon absente, du moins très élastique. L’excellent Jeremy Strong se glisse dans la peau de Roy Cohn, conseiller juridique de Trump de 1974 à 1986. Type sulfureux dont l’existence lui vaudra d’être emporté par le sida, Cohn, dans l’ombre, va façonner un disciple qui en viendra in fine à le dominer après avoir compris ses leçons les plus inquiétantes. On le sait bien, le cinéma n’a jamais changé le monde mais il peut nous éclairer. Cette évocation de Trump est à la fois distrayante tout en faisant froid dans le dos. (Metropolitan)
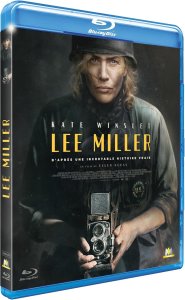 LEE MILLER
LEE MILLER
C’est le temps béni des vacances sur la Côte d’Azur, les heures de farniente avant que les ombres de la Seconde Guerre mondiale s’avancent sur l’Europe. A Mougins, à la fin des années trente, Lee Miller, qui fut mannequin pour Vogue, passe du bon temps avec Pablo Picasso, les Eluard… C’est là que l’existence de Lee va croiser celle de l’écrivain surréaliste Roland Penrose. Elle épousera le Britannique dans l’Angleterre de 1947. Auparavant la vie de Lee Miller aura été bouleversée pour toujours par sa participation à la guerre en tant que reporter de guerre, témoignant, dans les rangs de la 83e division américaine, des combats de Normandie avant de poursuivre vers l’Allemagne en étant, l’une des premières, avec David E. Scherman, correspondant du magazine Life, à découvrir l’horreurs des camps de concentration de Buchenwald et Dachau… Il faudra à Lee Miller batailler dur pour que ses photos soient publiées. Elles le seront dans un numéro du Vogue américain dans l’immédiat après-guerre… C’est en tombant, à New York, sur un livre consacré à Lee Miller qu’Ellen Kuras prend connaissance de l’extraordinaire destin de l’artiste américaine (1907-1977). Comme elle trouve un air de ressemblance entre Lee et Kate Winslet, elle décide d’envoyer un exemplaire à la comédienne. Quelques années plus tard quand Kate Winslet songe à incarner Lee Miller, elle va demander à Ellen Kuras de la mettre en scène. Lee Miller est une bonne occasion de découvrir cette partie de la vie de Lee que furent les années de guerre. Une époque où celle qui fut la muse et la compagne de Man Ray dira : « Je préfère faire des photos que d’être dessus ». Et puis ce personnage de femme déterminée, quand même peu connue du grand public, permet à la cinéaste de brosser le portrait d’une femme habitée par un esprit de liberté et de révolte contre l’ordre social établi, tant dans sa vie amoureuse, sa carrière. Sans oublier de précurseurs idéaux féministes. Cet agréable biopic offre à Kate Winslet un nouveau personnage de femme forte et indépendante même si ses fêlures sont abondantes et douloureuses. L’inoubliable interprète de Rose DeWitt dans Titanic (1997) se glisse avec aisance dans la peau d’une rebelle qui ira jusqu’à essuyer ses bottes boueuses sur le tapis de bain blanc de l’appartement privé d’Hitler. Le 30 avril 1945, Lee et Scherman sont à Munich. Au 16 de la Prinzregentenplatz, ils montent à l’appartement privé d’Hitler. Le même jour, le Führer vient de se suicider dans son bunker de Berlin. Avisant la salle de bain, Lee décide de se baigner. Scherman shoote la photo qui sera publiée dans Vogue en 1945. Comme un défi à l’horreur du nazisme et du totalitarisme. La séquence fameuse fit entrer Lee Miller dans la légende de la photographie. (M6)
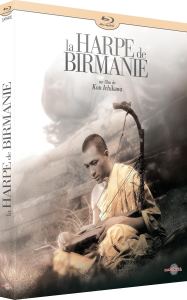 LA HARPE DE BIRMANIE
LA HARPE DE BIRMANIE
Dans la jungle birmane, en juillet 1945, une section de l’Armée Impériale japonaise est en déroute. Apeurés, les soldats craignent de tomber sur l’ennemi et rêvent de rentrer au pays, même s’ils se doutent bien qu’il est en piteux état. Parmi les soldats se trouve Mizushima, un joueur de harpe, qui ravive le moral des hommes et sert d’éclaireur grâce à son instrument. Lors d’une halte dans un village, la section est cernée par les troupes britanniques. Alors qu’il sait bien que la cause est perdue et afin d’éviter un massacre, le capitaine Inoue, chef de choeur dans le civil, ordonne à ses hommes de chanter pour signifier leur pacifisme. En face, les soldats anglais répondent à leur tour en chantant There is No Place Like Home. Les soldats nippons se rendent sans violence. Mizushima est alors chargé de convaincre un groupe de soldats japonais, réfugiés sur un piton montagneux, de cesser de se battre et de se livrer aux Anglais. Mizushima est très mal accueilli par ses compatriotes qui le traitent de lâche. La négociation est un échec, les soldats japonais tous éliminés et le joueur de harpe laissé pour mort. Plusieurs jours plus tard, alors que ses compagnons, désormais prisonniers de guerre, s’inquiètent du sort de Mizushima, ils croisent un moine birman qui lui ressemble de façon troublante… En 1956, le cinéaste japonais Kon Ichikawa adapte un classique de la littérature nippone signé de Michio Takeyama qui s’intéresse à l’histoire vraie du soldat Kazuo Nakamura. Attiré très jeune par le bouddhisme, ce soldat se destinait à devenir moine avant d’être enrôlé et de combattre notamment en Birmanie. Outre ses activités chorales, Nakamura se consacra à la mémoire des soldats tués au combat. Avec son trentième long-métrage, Ichikawa (1915-2008) va connaître son premier grand succès international, le film étant en compétition à la Mostra de Venise et en sélection pour l’Oscar du meilleur film étranger. Dans une mise en scène limpide qui évolue entre la tension guerrière et un apaisement musical, La harpe de Birmanie se présente comme un conte humaniste et une émouvante fable pacifiste portée par la belle musique d’Akira Ifukube. Face à la guerre qui met à l’épreuve l’âme humaine, Mizushima (Shoji Yasui), désormais bonze, s’isole du groupe des soldats et entame un trajet mystique dans un monde en ruine où, partout, il est confronté aux méfaits de la guerre. Ichikawa construit son film sur deux voies, celle, collective, de la vie et de la reconstruction et celle, personnelle, du travail de deuil. Dans une nouvelle restauration 4K, La harpe de Birmanie sort pour la première fois en Blu-ray. Dans les suppléments, une préface de Diane Arnaud, universitaire et critique de cinéma et L’histoire d’un soldat (24 mn) dans lequel Claire Akiko-Brisset raconte l’aventure du soldat Nakamura. (Carlotta)
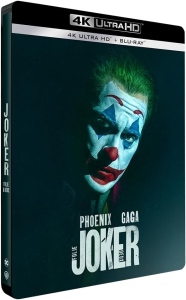 JOKER : FOLIE A DEUX
JOKER : FOLIE A DEUX
Deux ans après ses crimes sous les traits de Joker, Arthur Fleck est, en 1983, interné au sinistre hôpital psychiatrique Arkham de Gotham City dans l’attente prochaine de son procès. Toujours déchiré entre ses deux identités, Arthur est la cible des gardiens qui le chambrent sans arrêt : « T’as pas une blague pour nous, ce matin ? » Mais le détenu de la cellule 258 s’enferme dans un mutisme souvent inquiétant tant son regard transperce ses interlocuteurs. La première fois qu’il lâche quelques mots : « Je peux avoir une cigarette ? » Tandis que Maryanne Stewart, son avocate, prévoit de plaider un trouble dissociatif de l’identité pour faire valoir que le personnage de Joker est responsable des crimes commis deux ans plus tôt, Arthur tombe en arrêt devant l’atelier de musicothérapie. Il remarque d’emblée Lee Quinzel qui ne le lâche pas des yeux. Comme le détenu se tient bien, un gardien l’autorise à fréquenter l’atelier. Pour Arthur, c’est l’occasion de se rapprocher de Lee qui, complètement fascinée par lui, affirme qu’elle a vu pas moins de dix fois le téléfilm consacré à Arthur/Joker. Alors que son procès va s’ouvrir, Fleck va rejoindre Lee dans une folie commune au travers de la musique alors qu’à l’extérieur du tribunal, les nombreux partisans de Joker affichent leur soutien pour qu’il soit libéré. Cinq ans après la sortie de Joker, voici donc Joker : Folie à deux qui s’ouvre en dessin animé, façon Merrie Melodies (co-signé du Français Sylvain Chomet) dans lequel le Joker se bagarre avec une ombre qui veut son indépendance… Todd Phillips revient derrière la caméra pour une approche cette fois, très musical de son récit. Bien sûr, le film s’inscrit dans deux sous-genres bien déterminés : le film de prison et le film de procès mais en y intégrant de multiples références aux grandes heures de la comédie musicale, avec, par exemple, Fred Astaire chantant That’s Entertainment. On entend aussi Get Happy, Fly Me to the Moon, That’s Life, voire même une variation sur le Ne me quitte pas de Brel. Si le thriller perd, petit à petit, de son rythme et peine alors à captiver, il reste qu’on demeure impressionné par la brillante performance d’un Joaquin Phoenix, toujours aussi habité. Le visage émacié, l’oeil brûlant, le mot rare puis entraîné dans un torrent verbal, son Arthur Fleck est à la fois pathétique et effrayant. A ses côtés, Lady Gaga (qu’on avait vu, pour la dernière fois au cinéma, dans House of Gucci en 2021) est crédible dans le personnage trouble et tordu de Lee Quinzel. Sur les ailes de la transe… (Warner)
 SECONDS
SECONDS
Banquier âgé d’une quarantaine d’années, Arthur Hamilton est las de son quotidien routinier. Un jour, il reçoit un jour un appel surprenant, venant d’un ancien ami que tout le monde croyait mort, et qui lui propose de changer de vie. Intrigué, Hamilton pousse ses recherches, et atterrit entre les mains d’une mystérieuse société, fonctionnant sur le bouche-à-bouche, lui faisant effectivement miroiter d’avoir la vie dont il a toujours rêvé… S’il hésite d’abord, Hamilton va s’engager dans un programme lui permettant de démarrer une nouvelle vie en échange de 30 000 dollars. Cet argent couvre entre autres les frais de chirurgie esthétique du faciès, de l’acquisition et la transformation d’un cadavre qui permet de simuler sa mort. S’ensuit la chirurgie esthétique qui change son visage, ce qui le rajeunit considérablement, puis Arthur doit suivre une période de rééducation. Enfin, pour découvrir sa future carrière, il apprend qu’il avait effectué avant l’opération chirurgicale une analyse psychologique sous substance psychotrope, qui révèle qu’il souhaite être un artiste peintre. La compagnie lui fournit alors une nouvelle identité, Antiochus Wilson, peintre diplômé d’une école d’art, qui a déjà réalisé plusieurs expositions, et qui habite à Malibu. En 1965, John Frankenheimer, qui avait déjà à son actif des films comme Le prisonnier d’Alcatraz (1962), Sept jours en mai (1964) et Le train (1964) tourne Seconds qui deviendra L’opération diabolique pour sa distribution française. Pour tenir le double rôle d’Hamilton/Wilson, le cinéaste avait pensé à Kirk Douglas ou Laurence Olivier. Il choisira finalement Rock Hudson qui parviendra à convaincre Frankenheimer qu’il ne pouvait qu’incarner Wilson. Le cinéaste confiera le rôle d’Hamilton à John Randolph, un comédien longtemps demeuré sans travail à cause de son inscription sur la sinistre liste noire d’Hollywood. Le film est présenté en sélection officielle au festival de Cannes 1966 et il est très mal accueilli par la presse européenne. Il faudra attendre une ressortie au milieu des années 2010 pour que Seconds soit enfin perçu comme une œuvre radicale, visuellement splendide (le générique de Saul Bass est remarquable) fonctionnant comme un cauchemar paranoïaque et qui dénonce, au passage, les mirages du rêve américain. Un thriller psychédélique dissonant qui mérite d’être redécouvert et qui sort dans une édition digibook avec une présentation par Jean-Baptiste Thoret, des interviews du cinéaste et de Rock Hudson, enfin un livre de 48 pages écrit par Olivier Père. (Sidonis Calysta)
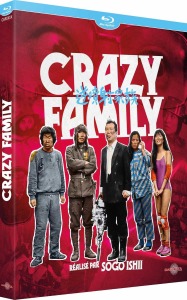 CRAZY FAMILY
CRAZY FAMILY
Katsukuni Kobayashi est sur un petit nuage : le voilà heureux propriétaire d’une moderne maison de banlieue dans laquelle il vient d’emménager avec sa famille. Maintenant c’est sûr, tous ses problèmes vont s’envoler! Chacun à sa propre occupation. Le père Katsuhiko se consacre obsessionnellement à son travail, la mère Saeko est un modèle idéal de femme au foyer, le fils Masaki se consacre sérieusement à ses examens et Erika est une gentille petit fille fan de J-pop et de catch qui aspire à devenir célèbre par le biais du cinéma ou de la chanson. Mais le père déchante rapidement lorsqu’il découvre que la maison est infestée de termites. Mais ce petit monde va basculer dans la plus pure folie lorsque débarque Kobayashi, le grand-père venu sans crier gare rendre visite à son fils et sa famille. Le patriarche va s’incruster petit à petit, semant la discorde et la folie au sein de la famille. Avec des personnages qui semblent sortis d’un manga foutraque, Sogo Ishii va pousser le bouchon de plus en plus loin alors que Katsukuni décide de prendre des mesures drastiques pour sauver les siens… Le père va fermer toutes les issues possibles, imaginant entraîner les siens dans un harakiri collectif. Autant dire que la maisonnée va devenir un champ de bataille. Toutes les armes sont bienvenues pour estourbir les adversaires. Alors, on travaille au couteau, à la batte de baseball, au sabre, pourquoi pas au marteau piqueur (Katsukuni avait imaginé de construire une pièce au sous-sol pour son père), voire même aux prises de catch qu’Erika apprécie tant. Tout cela fait de Crazy Family un vaste et savoureux délire ! Fidèle à son style outrancier et punk, Sogo Ishii (Crazy Thunder Road) signe, en 1984, une comédie déjantée teintée d’humour noir, qui s’attaque à la sacro-sainte institution que représente la famille au Japon. Dans ce home invasion où la menace vient de l’intérieur, le cinéaste explose les idées préconçues sur le bonheur familial, cauchemar déguisé qui finit par étouffer ses personnages. Influence revendiquée par Takashi Miike pour son déjanté Visitor Q (2001), Crazy Family est un réjouissant jeu de massacre. Cette satire drôle, jouissive et dérangeante est disponible pour la première fois en Blu-ray dans sa version restaurée 2K et est accompagnée de bons suppléments. Dans un entretien (28 mn), le réalisateur Gakuryu Ishii ex-Sogo Ishii, secondé par le mangaka Yoshinori Kobayashi et la troupe de la Directors Company, explique avoir voulu élaborer avec Crazy Family un nouveau genre de drame familial, traitant de la violence au Japon. Avec Crazy Family : l’enfant rebelle de Sogo Ishii (19 mn), James Balmont, spécialiste du cinéma de l’Asie de l’Est, analyse la place de Crazy Family au sein de la filmographie du réalisateur. (Carlotta)
 MAD FATE
MAD FATE
Par une nuit d’orage, un maître de feng shui tente de sauver une prostituée d’une mort certaine, mais le destin en a décidé autrement. Arrivé à son domicile, il découvre le corps de la jeune femme, victime d’un abject serial killer. Un livreur déboule à son tour sur la scène de crime, hypnotisé et fasciné par ce qu’il voit. Le maître de feng shui (Gordon Lam) prédit au garçon un avenir sombre et meurtrier. Mais cette fois, il jure de tout faire pour changer le cours des choses. Sauf que l’inspecteur chargé de l’enquête est convaincu que le livreur est un psychopathe-né dont la soif de sang ne peut être arrêtée.. Deux ans après son virtuose et ultra-violent Limbo, le réalisateur hongkongais Soi Cheang signe, en 2023, un nouveau coup d’éclat avec Mad Fate qui porte dans son ADN l’héritage des stylistes de genre qui ont marqué le cinéma d’action hongkongais, de Ringo Lam (City on Fire) à Johnnie To (Mad Detective), qui officie ici en tant que producteur. Abandonnant le noir et blanc crasseux pour une palette de couleurs très « giallesque », le surdoué Soi Cheang livre une vision hallucinée et jubilatoire de Hong Kong, qui lorgne aussi bien du côté du thriller désenchanté que de la comédie décalée et surnaturelle. Mélange détonnant entre polar et fantastique, Made Fate, avec une énergie folle, embarque le spectateur dans un impressionnant chaos de spiritualité volontiers dérisoire et de pulsions morbides, le tout dans un récit bouillonnant qui s’achève dans une folie totale. En suppléments, on trouve Le poids du destin (16 mn), un entretien inédit dans lequel Soi Cheang parle de sa collaboration avec Johnnie To et son scénariste phare Yau Nai-hoi, tous deux à l’initiative de Mad Fate, puis revient sur la notion de destinée et sur le message de son film. (Carlotta)
 CONSTANTINE
CONSTANTINE
Condamné à errer en enfer à cause d’un suicide raté, John Constantine, exorciste et médium capable de voir l’autre monde, tente de racheter son salut. Afin de gagner sa place au paradis, il a accepté de lutter sans relâche contre les créatures du Mal. Alerté par une série d’événements étranges liés au mystérieux suicide d’Isabel, la soeur jumelle de Katelin Dodson, une inspectrice de police (Rachel Weisz) plutôt incrédule, John Constantine découvre bientôt que la pire des menaces pèse sur le monde, et sur les habitants de la ville de Los Angeles en particulier. Et surtout Constantine représente le seul espoir de l’humanité. Réalisateur fétiche de la saga Hunger Games, l’Américain Francis Lawrence s’était fait remarquer avec Je suis une légende (2007) avec Will Smith puis de De l’eau pour les éléphants (2011) avec Reese Witherspoon et Robert Pattinson. Mais il avait débuté, en 2005, dans la réalisation avec cette adaptation de la série de comics Hellblazer. Tournant le dos aux héros en collant hollywoodiens, Lawrence a fait le choix de placer Constantine dans un univers démoniaque qui, pour être distrayant, n’est pas spécialement « excité ». Mieux, l’atmosphère sombre et oppressante du récit s’adresse plutôt à un public adulte. Comme la mise en scène est soignée et que les effets spéciaux sont bons, l’ensemble avance avec une suite de temps forts. Après avoir été Neo dans les trois opus de la saga Matrix (1999-2003), Keanu Reeves se glisse, ici, dans la peau d’un extralucide anticonformiste qui se lance dans une enquête qui lui fera découvrir l’univers des anges et des démons qui hantent les sous-sols du Los Angeles d’aujourd’hui. Vingt ans après sa sortie en salle, ce film d’action fantastique revient dans une version restaurée 4K exclusive en édition collector Blu-ray présentée dans un Steelbook comprenant des bonus inédits notamment Deux décennies de damnation dans lequel Keanu Reeves et le réalisateur Francis Lawrence se retrouvent face caméra pour célébrer le 20e anniversaire de ce film culte. Avec également les commentaires audio du cinéaste, des scènes coupées et une fin alternative. (Warner)
 MA VIE MA GUEULE
MA VIE MA GUEULE
Dire que Barberie Bichette est complètement à l’ouest, est un doux euphémisme. Celle qu’on appelle à son grand dam, Barbie, a peut-être été belle, peut-être été aimée, peut-être été une bonne mère pour ses enfants, une collègue fiable, une grande amoureuse, oui peut-être… Mais aujourd’hui, c’est noir, c’est violent, c’est absurde et ça la terrifie : elle a 55 ans (autant dire 60 et bientôt plus !). C’était fatal mais comment faire avec soi-même, avec la mort, avec la vie en somme… Alors Barbie parcourt l’existence comme une sorte de zombie. Oh, pas un méchant zombie mais un zombie quand même. Qui traverse sans s’arrêter la salle de réunion de son boulot dans la com’ ou qui croise, dans un jardin public à l’heure du déjeuner, Philippe Katerine. Avec Ma vie ma gueule, Sophie Fillières invite le spectateur à observer un monde dont l’inintelligible parfois nous dépasse, nous écrase, nous effraie et parfois nous rehausse, nous hisse, là où on ne s’y attend pas. Voici, entre sourire et détresse, une manière de conte fortement poétique dans ce sens où il déstabilise et émeut tout à la fois. Emportée par la maladie en 2023 alors qu’elle venait d’achever le tournage de son film, la cinéaste de 58 ans, expliquait: « Je voudrais essayer de traiter de plein fouet, pif, paf, youkou !, comment se débrouiller et faire avec l’énigme de soi. Car nous en sommes toutes et tous une. Comment nous admettre comme personnage, ce qui nous inscrira enfin dans une histoire qui serait la nôtre propre ? » Bien sûr, il faut, ici, se laisser prendre, se laisser promener par le bout du nez sous peine de décrocher assez vite. Mais, comme la cinéaste, on peut faire confiance à cette épatante comédienne qu’est Agnès Jaoui. Habituée des rôles « normaux » bien ancrés dans le réel, elle s’offre, ici, de la fragilité, de l’instable, du déséquilibre. Avec elle, Barbie se débat comme elle peut sur un fil à peine encore assez tendu, en équilibriste trompe-la- mort, trompe-la-détresse, trompe-le-craquage… (jour2fête)
 C’EST LE MONDE A L’ENVERS
C’EST LE MONDE A L’ENVERS
Le climat s’emballe, l’économie s’effondre… Stanislas, un trader parisien redouté des buildings de La Défense, se retrouve démuni : plus d’eau, plus d’électricité, plus de connexion, et plus de compte en banque. Sa femme, Sophie, le convainc d’aller trouver refuge avec leur fils à la campagne chez Patrick, un agriculteur dont Stanislas vient d’acheter la ferme dans un but spéculatif et dans une démarche de greenwashing. Mais Patrick et Constance, sa femme, ont aussi tout perdu avec la crise, et ils n’entendent pas céder leurs terres à ces Parisiens fraichement débarqués sur leur propriété. Malgré tout ce qui les oppose, ces deux familles vont devoir apprendre à vivre ensemble avec comme seules ressources, celles que la nature offre et ainsi inventer les codes d’un nouveau monde. Quand tout déraille et que tout s’effondre à cause de la crise économique, que peut faire le genre humain ? Connu autant comme aventurier avec des expéditions à travers la Laponie, l’Alaska ou la Sibérie que comme écrivain, Nicolas Vanier compte également pas moins d’onze longs-métrages de fiction à son actif. On se souvient ainsi du Dernier trappeur (2004), Belle et Sébastien (2013) d’après la série télé éponyme ou Donne-moi des ailes (2019) inspiré de l’histoire vraie de Christian Moullec, l’homme qui vole avec les oiseaux, cygnes, grues et oies. Il signe, ici, une comédie dramatique d’anticipation où la ville et la campagne vont devoir cohabiter, au propre comme au figuré, et plus encore accepter de bâtir des compromis. Si la dimension de la comédie est bien présente dans cette aventure rurale (le film a été tourné à Vézelay dans le Morvan), le réalisateur invite cependant le spectateur à se questionner sur une apocalypse où l’argent n’aura plus de valeur, pas plus que les biens matériels non plus et où il convient de revenir aux sources pour survivre. Pour porter ce message qui a des accents contemporains, Nicolas Vanier se repose sur une belle distribution avec Michaël Youn en trader, Eric Elmosnino en homme de la campagne, Barbara Schulz, Valérie Bonneton, François Berléand et Yannick Noah qui débute au cinéma. Quand le retour à la nature s’impose ! (Gaumont)
 QUAND LE CLAIRON SONNERA
QUAND LE CLAIRON SONNERA
Dans le Texas des années 1830, Jim Bowie, un grand propriétaire terrien marié à une Mexicaine, débarque à Anahuac où les colons ne supportent plus le despotisme grandissant du président mexicain Antonio López de Santa Anna qui refuse leurs demandes de réformes gouvernementales. Pour mater la rébellion, ce dernier envoie sur place plusieurs garnisons. Une poignée de Texans décident alors de prendre les armes pour défendre leurs droits. Jim Bowie se rallie à eux. Les combats deviennent vite intenses entre les résistants et les renforts mexicains… Evidemment, on songe au célèbre Alamo réalisé en 1960 par John Wayne. Le Duke y incarnait aussi le trappeur Davy Crockett dans cette page fameuse de la guerre d’indépendance du Texas. Cinq ans plus tôt, Frank Lloyd signait The Last Command (en v.o.) qui allait être son dernier long-métrage et qui racontait également l’aventure du fort Alamo, cette fois du point de vue d’un autre héros de cette bataille inégale, en l’occurrence Jim Bowie qui y laissera, comme Crockett ou Travis, la vie. Dans l’Alamo de Wayne, c’est Richard Widmark qui tenait le rôle de Bowie. Ici, c’est Sterling Hayden qui est impressionnant en Bowie ami avec le général Santa Anna et qui tente de le convaincre de prendre en compte les préoccupations des Texans. En vain. Bowie retrouvera une ultime fois Santa Anna, sous drapeau blanc, pendant le siège du fort, chacun comprenant le point de vue de l’autre et convenant que les événements sont devenus incontrôlables. Si le film est parfois un peu bavard, Frank Loyd, célèbre pour avoir réalisé en 1935, Les révoltés du Bounty avec Clark Gable et Charles Laughton qui lui valut l’Oscar du meilleur film en 1936, réussit de remarquables scènes d’action. L’assaut final sur Alamo est aussi remarquable que celui de Wayne. (Sidonis Calysta)
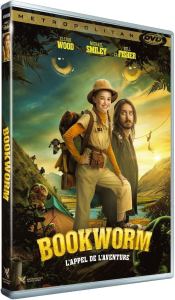 BOOKWORM
BOOKWORM
Parce que sa maman a été hospitalisée à la suite d’un accident de grille-pain, le monde de Mildred, 11 ans, va être complètement bouleversé. Car voilà que débarque Straw, son père, qu’elle n’a jamais connu. Celui-ci est un magicien en rupture de ban qui vient s’occuper d’elle et qui accepte, soucieux de faire plaisir à la gamine, de l’emmener camper à la recherche de la légendaire panthère de Cantorbery et ainsi pouvoir récupérez le prix de 50 000 dollars offert à tout explorateur intrépide qui réussira la mission de prouver que la bête mythologique existe. Comme, en plus d’être blessée, la mère de Mildred est lourdement endettée, la fillette y voit l’occasion d’une surprise lorsqu’elle se réveillera en payant ses factures… Voici, dans les magnifiques décors naturels de Nouvelle-Zélande, une aventure familiale qui a tous les atours du feel good movie tout en traitant de thèmes comme la monoparentalité, les liens du sang ou la prise de responsabilité Avec d’un côté une Mildred (la douée Nell Fisher) intelligente, indépendante et débrouillarde et d’autre part, un père, magicien raté (il préfère qu’on dise illusionniste) qui n’a jamais rien accompli de sa vie. Ou quand les enfants montrent le (bon) chemin à leurs parents ! Ecrit pour Elijah Wood dans le rôle d’un père aussi maladroit que pathétique mais qui finit par être chaleureux, le film d’Ant Timpson permet donc de trouver le comédien américain devenu mondialement célèbre en interprétant le Hobbit Frodon Sacquet dans la trilogie Le seigneur des anneaux (2001-2003) de Peter Jackson. Si, par la suite, Wood a tenu de bons rôles dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) ou Sin City (2005), il a depuis un peu disparu des grands écrans. Le voilà donc, bien attachant en magicien raté mais en père humain. (Metropolitan)
 ELEVATION
ELEVATION
Dans un monde post-apocalyptique où l’humanité, déjà détruite à 95 %, s’est réfugiée en altitude, parce que plein de vilaines bêtes bouffent tous ceux qui s’aventurent sous la ligne de 2400 mètres d’altitude, un gamin a disparu… Un père célibataire et deux femmes s’allient pour affronter ces affreuses créatures (qui localisent leurs victimes grâce à leur souffle) afin de sauver la vie de l’enfant. Le quatrième long-métrage de l’Américain George Nolfi, connu aussi comme scénariste notamment d’Ocean Twelve (2004), se range dans la catégorie des thrillers d’action « postapo ». Ici, pour sauver la vie de son jeune fils Hunter, qui souffre d’une maladie entraînant des difficultés respiratoires, Will part avec la scientifique Nina et une jeune femme nommée Katie pour obtenir les médicaments dont Hunter a besoin. Cela les amène à descendre sous la limite des montagnes Rocheuses, que les créatures ne peuvent pas franchir. Bien que le père méprise la scientifique, elle pourrait détenir la clé pour vaincre les monstres. Nina pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils découvrent comment tuer les créatures. Si Elevation n’est pas spécialement passionnant du côté de son scénario, cette série B comporte cependant des séquences captivantes. Et comme le trio d’aventuriers est expert dans le maniement des armes à feu, on comprend que les sales bestioles vont prendre cher… Nolfi a confié le rôle de Will à Anthony Mackie vu dans Million Dollar Baby (2004) et qui sera prochainement Captain America dans Captain America : Brave New World, celui de Nina à Morena Baccarin qui fut Vanessa Carlysle dans Deadpool (2016), Deadpool 2 (2018) et Deadpool et Wolverine (2024) et enfin le personnage de Katie à Maddie Hasson connue pour son rôle de Willa Monday, une Gitane délinquante juvénile dans la série de la Fox The Finder. Pas surprenant mais plutôt efficace. (Metropolitan)
 LES YEUX DE FEU
LES YEUX DE FEU
En 1750, un pasteur, chassé de son village pour adultère, s’enfuit avec quelques fidèles dans une région inexplorée d’Amérique du Nord. Le petit groupe finit par trouver un endroit où s’installer, inconscient des dangers qui se cachent dans les bois environnants. Avec son univers peuplé d’esprits hostiles, avec une jeune femme aux dons extraordinaires et une forêt hantée par une terrifiante sorcière, le premier film d’Avery Crousne frappe par son originalité, son atmosphère étrange et onirique. Situé en 1750, une période historique riche peu exploitée dans le cinéma de genre, le film mêle habilement l’horreur surnaturelle avec des éléments folkloriques et historiques. En relatant l’histoire d’un groupe de pionniers aux croyances chrétiennes rigides durant la colonisation américaine, le réalisateur, qui fut photographe, propose une reconstitution historique impeccable. L’ajout du surnaturel et de l’horreur témoigne des angoisses liées à la colonisation, à la nature sauvage et au climat de danger qui entoure l’homme lorsqu’il s’éloigne de la civilisation. Les yeux de feu repose sur un style visuel original. Les effets spéciaux psychédéliques peuvent d’abord paraître datés mais au final, ils donnent à l’ensemble une allure de cauchemar biscornu, pour une terreur psychologique teintée d’onirisme. Les arbres ornés de plumes, les visages des esprits prisonniers des troncs noueux, ou encore la présence de l’étrange jeune fille aux pouvoirs surnaturels donnent une puissance visuelle évocatrice. Pour embarquer dans un voyage envoûtant et angoissant en terre inconnue… Dans son combo Blu-Ray + dvd + livret de 24 pages, l’édition propose un dvd avec la version longue du film, plus mystérieuse et plus atmosphérique, intitulée Crying Blue Sky. (Rimini Editions)
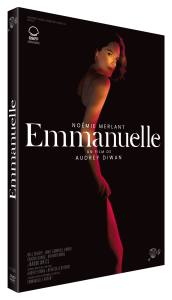 EMMANUELLE
EMMANUELLE
En ce temps-là (1974), Sylvia Kristel, charmante bimbo batave, lovée dans un fauteuil Peacock, affolait, avec ses seins nus, les jeunes spectateurs (les vieux, aussi) et bousculait la sexualité des Trente glorieuses. Le film de Just Jaeckin, solide success story, aura été vu par 8 894 000 millions de spectateurs dans les salles de l’hexagone ! L’Emmanuelle d’Audrey Diwan (remarquée avec L’événement en 2021) embarque le fameux personnage dans une aventure censément féministe, retenant qu’Emmanuelle Arsan, l’auteure du livre-support des deux films, avait écrit un récit à la première personne. « Son héroïne, dit la cinéaste, en est le sujet plus que l’objet. (…) Le premier parti pris qui m’a animé était de redonner à Emmanuelle cette puissance d’être sujet du récit. » La première Emmanuelle était une jeune femme parfaitement oisive qui partait rejoindre à Bangkok un mari libertin. L’Emmanuelle d’aujourd’hui est une executive woman solitaire et sans états d’âme en route pour Hong Kong avec pour pour mission de faire du « contrôle qualité » au coeur du Rosefield, un immense palace de luxe. Elle y croise un couple, Zelda, une jeune étudiante/escort et surtout le mystérieux et insaisissable Kei Shinohara. Qui à la différence des précédents, ne semble pas intéressé par Emmanuelle. Las, le film, avec ses images léchées, ne distille rien de lascif, d’impur, d’érotique pour tout dire. L’Emmanuelle nouvelle est une grande cérébrale qui paraît quasiment se méfier de la gaudriole et du jeu de la bête à deux dos. Noémie Merlant, dont le sex-appeal ne fait aucun doute comme en attestent aussi bien Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma ou Les Olympiades de Jacques Audiard, parvient pourtant à tirer son épingle du jeu. On se demande presque comment tant ce drame érotique manque de fièvre. (Pathé)
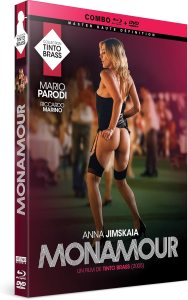 COLLECTION TINTO BRASS
COLLECTION TINTO BRASS
Ce qu’il y a de bien avec Tinto Brass, c’est qu’on n’est jamais surpris par son travail ! Voilà encore, dans la collection qui lui est consacrée, deux occasions de vérifier le goût du cinéaste italien pour le porno soft, pour les situations vaguement scabreuses et pour les femmes voluptueuses qui savent précisément ce qu’elles aiment (en fait, tout). En 1994, il signe L’uomo che guarda (Le voyeur, en vf) dont il tire le scénario d’une nouvelle de l’incontournable Alberto Moravia. C’est l’histoire d’un professeur d’université qui devient obsédé par l’idée que sa femme (la comédienne polonaise Katarina Visilossa) qui prend de plus en plus de distance avec lui, le trompe avec son père invalide. Quant à Monamour, réalisé en 2005, c’est à ce jour le dernier long-métrage réalisé par le metteur en scène aujourd’hui âgé de 91 ans. Jeune femme au foyer, Marta est clairement nymphomane. Elle est mariée à Dario, un éditeur de livres à succès. Bien qu’elle aime toujours son mari, Marta (la comédienne ouzbek Anna Jimskaya) n’a pas pu atteindre la satisfaction sexuelle depuis des mois en raison de leur vie amoureuse terne et prévisible. Alors qu’elle séjourne à Mantoue pour la foire du livre Festivaletteratura, Marta suit les conseils de son amie Sylvia et entame une liaison avec un bel et mystérieux artiste nommé Leon, ce qui entraîne des résultats surprenants concernant son mariage défaillant avec Dario. (Sidonis Calysta)

