LE CHANTRE DES PLAISIRS SIMPLES ET LE TERRIBLE FRERE N°1
 COFFRET OTAR IOSSELIANI
COFFRET OTAR IOSSELIANI
Avec son air de vieux monsieur malicieux, l’inclassable Otar Iosseliani a pris la tangente à 89 ans, le 17 décembre dernier à Tbilissi, dans sa Géorgie natale, laissant derrière lui une œuvre courant sur plus d’un demi-siècle et marquée par un ton inimitable et discrètement subversif. Après des études de piano, il entre à l’université de Moscou pour suivre des études de mathématiques et de mécanique. Mais il comprend vite que ce type d’études signifie, en URSS, être recruté par l’armée. Pour se dégager en douceur, il s’oriente vers des études de mise en scène à l’Institut de cinéma de l’Union soviétique et y réalise, en 1958 son premier film, Aquarelle (10 mn) où une blanchisseuse, mère de famille nombreuse, se lasse de voir son mari, ivrogne, lui voler toute sa paie… Iosseliani, c’est une lucidité implacable mais qui ne se dépare jamais d’une poésie douce et d’une humanité franche et généreuse. Toujours à juste distance, sa caméra observe les actions humaines avec une malicieuse bienveillance teintée de mélancolie, capturant l’essence de la condition humaine par son regard acéré. De ses débuts en Union soviétique à son exil en France et sa reconnaissance internationale, Otar Iosseliani, souvent décrit comme un « disciple géorgien et pince-sans-rire de Jacques Tati », se révèle comme un penseur essentiel du cinéma, dont l’intelligence, la culture et la légèreté forment un cocktail unique et inoubliable. Dans le cadre de sa belle politique d’édition, Carlotta Films présente, pour la première fois, dans un coffret de neuf Blu-ray, l’intégrale de l’oeuvre (plus de 30 heures de films) regroupant huit courts et les longs-métrages, tant de fictions que documentaires. On y trouve évidemment de grands classiques comme Pastorale (1975), volontiers considéré comme son chef d’oeuvre. L’histoire est d’une parfaite simplicité. Quatre musiciens venus de la ville passent quelques jours dans un village perdu de haute montagne afin de répéter au calme. Tout le temps que dure le film, on suit la vie du village et notamment de la famille qui héberge les musiciens. On se dispute souvent mais on fait front devant les autorités, sans hésiter à prendre des libertés avec la loi… Iossellani filme la lente disparition de la culture géorgienne. Rien d’étonnant, le film fut longtemps interdit par les censeurs soviétiques. Un musicien -percussionniste celui-là, à l’opéra de Tbilissi- on en trouve un aussi dans cet autre fleuron qu’est Il était une fois un merle chanteur (1970), une fable à l’humour tendre. Et puis il y a encore Les favoris de la lune (1984) ou La chasse aux papillons (1992) qui attestent d’une écriture unique, délicatement sophistiquée, une manière de fugue cinématographique riche d’un petit peuple attachant. Parmi les suppléments, on trouve Otar Iosseliani tourne « Lundi matin », un film documentaire de Niko Tarielashvili (54 mn) et Otar Iosseliani, le merle siffleur dans la Collection Cinéma de notre temps. Réalisatrice et adaptatrice : Julie Bertuccelli (92 mn). Enfin le coffret est accompagné d’un livre (220 p.) qui propose un panorama critique de ses œuvres, projet de film inachevé, retranscription d’un séminaire tenu par le réalisateur à Bologne en 1997. … Otar Iosseliani, l’art de la fugue ou la promesse de pénétrer au cœur de la « méthode Iosseliani ». (Carlotta)
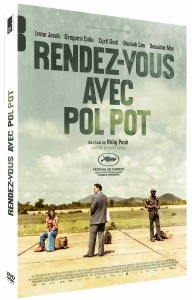 RENDEZ-VOUS AVEC POL POT
RENDEZ-VOUS AVEC POL POT
Sur la piste d’un immense aérodrome vide, quelque part dans un Cambodge devenu Kampuchéa démocratique, une femme et deux hommes attendent… Au loin, enfin, un camion chargé de miliciens s’approche. Nous sommes en 1978 et depuis trois ans, le pays, économiquement exsangue, est sous le joug de Pol Pot et de ses sinistres Khmers rouges. Lise Delbo est journaliste et Paul Thomas, reporter-photographe. Avec eux, se trouve Alain Cariou, intellectuel français, sympathisant de l’idéologie révolutionnaire et vieil ami de Pol Pot. Le trio a accepté l’invitation du régime et espère obtenir un entretien exclusif avec Frère n°1. En attendant l’hypothétique rencontre, le camarade Sung, qui s’exprime parfaitement en français, promène les visiteurs dans des ateliers où l’on peint et sculpte des statues de Pol Pot ou encore dans les champs où un paysan répond, en tremblant de tout son corps, aux questions de la presse. Tant Cariou que les journalistes comprennent très vite que la propagande est à l’oeuvre pour leur présenter une réalité très arrangée. Peu à peu, le traitement réservé aux visiteurs les inquiète et fait basculer leurs certitudes. En s’appuyant sur l’histoire vraie de deux journalistes américains (Elizabeth Becker et Richard Dudman) et d’un Britannique marxiste, Malcolm Caldwell, venus en visite au Cambodge en décembre 1978, le cinéaste franco-cambodgien Rithy Panh signe une remarquable et poignante plongée dans l’horreur du génocide perpétré par les Khmers rouges. Rithy Panh avait 11 ans quand les Khmers rouges prennent le pouvoir. Suivent presque quatre ans d’un régime sanguinaire où toute la population est envoyée dans des camps de travail. Durant ces années, où il perd ses parents et une partie de sa famille, l’adolescent est témoin des pires atrocités. Depuis ses débuts de réalisateur, Panh mène un travail de mémoire en documentant l’histoire de son pays natal et notamment le traumatisme horrible d’un génocide qui coûta la vie à deux millions de personnes. Même s’il se situe, ici, sur le terrain de la fiction (les trois Français sont incarnés par Irène Jacob, Cyril Gueï et Gregoire Colin), le cinéaste réussit pleinement à capter l’indicible. Il le fait dans une mise en scène très habile où les images classiques de la fiction se mêlent à celles d’archives mais aussi en jouant la carte de dioramas qui illustrent poétiquement les faits et gestes des personnages du récit. En suppléments, deux entretiens avec Rithy Panh et Irène Jacob. (Blaq Out)
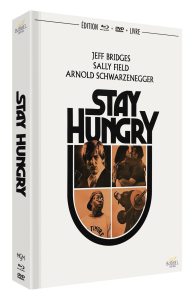 STAY HUNGRY
STAY HUNGRY
Jeune homme du Sud, Craig Blake est né avec une cuillère en argent dans la bouche… Fils de la grande bourgeoisie américaine, il vit seul et oisif dans une immense et belle demeure après la mort de ses parents dans un accident d’avion. Du côté de Birmingham, en Alabama, il passe son temps à monter à cheval, à chasser et à pêcher. Blake sert d’homme lige à des investisseurs douteux qui veulent mettre la main sur tout un quartier afin d’y bâtir un gratte-ciel. Il reste à mettre à acheter un petit club de gym. Blake est chargé de le faire. Mais le jeune homme va découvrir un univers qu’il ne connaît pas et qui l’amuse avant de le séduire. De plus, il croise sur place Joe Santo, un culturiste venu d’Autriche qui s’entraîne pour le titre de Mister Univers… Blake tombe aussi sous le charme de Mary Tate Farnsworth, la petite amie de Santo… Lorsqu’il se lance en 1976 dans le projet de Stay Hungry, le réalisateur Bob Rafelson est l’une des figures les plus emblématiques du Nouvel Hollywood, notamment pour avoir produit le très culte Easy Rider (1969) de Dennis Hopper et d’avoir mis en scène Five Easy Pieces (1970) avec Jack Nicholson. A la fin des années 70, Rafelson travaille sur un film consacré à l’esclavage en Afrique. Mais le projet est trop lourd et le cinéaste cherche quelque chose de plus joyeux qu’il va trouver dans le roman éponyme de Charles Gaines consacré aux salles de gym. Dans un temps où le business du fitness commence à prendre forme, Stay Hungry fait œuvre novatrice en montrant un monde alors peu connu, celui des culturistes. Si Rafelson embauche Jeff Bridges et Sally Field pour les rôles de Blake et Mary Tate, il va trouver en Arnold Schwarzenegger un élément de choix pour son film. A l’époque grande star du bodybuilding, l’Autrichien va entamer, avec Stay Hungry (son mantra est « Pour grandir, il faut que ça brûle ») la carrière de cinéma que l’on sait. Si Rafelson offre un beau rôle dramatique à Arnie, il réussit quelques bons portraits intimistes et des séquences remarquables comme cette réception mondaine où Joe Santo devient un phénomène de foire. Jusqu’ici inédit en Blu-ray en France, Stay Hungry sort en mediabook dans une belle édition collector en tirage limité avec différents bonus et un livre (100 p.) sur la genèse du film. Le film est proposé par le label Bubbelpop, un nouvel éditeur qui se propose de rééditer des films cultes et pop des années 70/80 dans des éditions collector prestigieuses incluant des packagings de qualité, des goodies tels que des livrets, cartes postales, mais aussi, des suppléments vidéos exclusifs réalisés par leurs propres soins. (Bubbelpop)
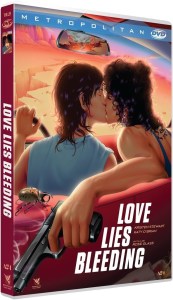 LOVE LIES BLEEDING
LOVE LIES BLEEDING
Un club de gym perdu au milieu de nulle part. Pas l’établissement BCBG mais plutôt l’entrepôt miteux. Ce qui n’empêche pas des costauds de pousser de la fonte. Frêle jeune femme, Lou gère la salle… Un soir, alors qu’elle ferme la boîte, elle remarque, sur le parking désert, Jackie, une ravissante culturiste. Immédiatement amoureuse, Lou l’invite à venir s’entraîner au club. Rapidement, les deux femmes vont être emportées dans une liaison explosive. Bientôt aussi, les ennuis commencent dans une spirale de pure violence où les morts brutales s’enchaînent. Le second long-métrage de la cinéaste anglaise Rose Glass n’y va pas avec le dos de la cuillère. Parce que les étreintes passionnées de Lou et Jackie ne seront rien à côté de l’enfer qui s’ouvre devant elles. Embauchée comme serveuse dans un club de tir, Jackie découvre que Langdon, le patron, n’est autre que le père de Lou avec lequel cette dernière est complètement en froid. Il faut dire que ce type au crâne chauve et aux longs cheveux dans le cou (le vétéran Ed Harris) est un vrai et dangereux fêlé. Tandis que Lou tente de sauver son aventure avec Jackie, celle-ci rêve de participer à un concours de body-building à Las Vegas. Love Lies… condense, dans l’Amérique de 1989, l’ambiance hot de Bound, le côté gore des films de zombies et l’atmosphère très roady de Thelma et Louise, le tout avec un traitement visuel qui puise ses références chez Cronenberg et Lynch. Katy O’Brian (Jackie) est charmante. Kristen Stewart s’empare avec force d’une Lou malmenée par les mauvais coups de la vie. Ces deux-là, malgré un scénario souvent défaillant, tiennent brillamment la baraque. Rose Glass s’interroge sur ce qu’est un personnage féminin fort, ici une bodybuildeuse mentalement et physiquement forte mais aussi exploitée et manipulée. Loufoque, disparate, inquiétant, troublant. (Metropolitan)
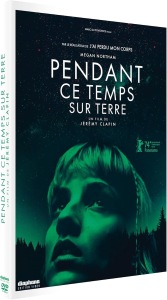 PENDANT CE TEMPS SUR LA TERRE
PENDANT CE TEMPS SUR LA TERRE
Elsa, jeune femme de 23 ans, travaille comme aide-soignante dans un EHPAD dirigé par sa mère. Une existence bien banale, sinon qu’on remarque qu’à la maison, le père de famille s’isole volontiers dans une pièce où il semble « ailleurs ». L’ambiance familiale cache un drame, puisque Franck, le frère ainé d’Elsa, a disparu trois ans plus tôt lors au cours d’une mission spatiale. Nul ne sait ce qui s’est réellement passé. Reste, pour rendre hommage à Franck, une statue le représentant au centre d’un rond-point. Dans la famille, la disparition de Franck laisse toujours un grand vide. Sans but dans la vie, Elsa, végète dans l’établissement de sa mère. Un jour, la jeune femme est contactée depuis l’espace par une forme de vie inconnue qui prétend pouvoir ramener son frère sur terre. Mais il y a un prix à payer… J’ai perdu mon corps, le premier long-métrage (2019) de Jérémy Clapin avait largement retenu l’attention, étant notamment couronné à la Semaine de la critique à Cannes. Une main coupée s’échappait du frigo d’un laboratoire pour entamer un voyage à travers la banlieue parisienne et se réunir avec son corps, un jeune homme nommé Naoufel… Ici, le réalisateur, qui se dit fasciné par l’Espace, tourne la page de l’animation pour un second « long » en prises de vues réelles autour de la relation entre une humaine et une forme de vie extraterrestre. « Ce film, dit le cinéaste, c’est le portrait d’une femme coincée entre deux mondes, celui des morts et des vivants, entre l’espoir et la résignation, entre son enfance et l’âge adulte, entre la Terre et l’Espace. C’est un film qui essaie avant tout de transmettre un sentiment, celui de n’appartenir qu’a moitié au monde. » Autour d’un deuil impossible, Jérémy Clapin invite le spectateur, sur une musique de Dan Lévy, à accompagner Elsa (Megan Northam) à travers deux univers : son parcours dans son monde intérieur, imagé, quasi inaccessible, et sa trajectoire sur terre. Troublant. (Diaphana)
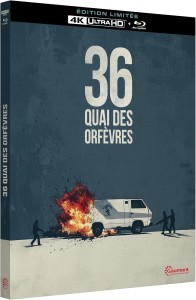 36, QUAI DES ORFEVRES
36, QUAI DES ORFEVRES
Paris. Depuis plusieurs mois, un gang de braqueurs opère en toute impunité avec une rare violence, attaquant à l’arme de guerre des transports de fonds. Proche de la retraite, Robert Mancini, le directeur de la Police Judiciaire exacerbe la concurrence entre le patron de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) et celui de la Brigade de répression du banditisme (BRB). Mancini se montre parfaitement clair avec ses deux subordonnés les plus directs : celui qui fera tomber ce gang le remplacera à son poste de « grand patron » du 36, quai des Orfèvres. Léo Vrinks, le chef de la BRI et Denis Klein, le patron de la BRB, n’hésiteront pas à user de moyens illégaux pour réussir. Deux services concurrents, deux stars de la police et un gros poste à pourvoir, tous les éléments sont réunis pour déclencher une guerre des polices. Plutôt que de reprendre la pâtisserie familiale du côté d’Oléron, Olivier Marchal a fait carrière dans la police nationale, passant par la PJ de Versailles, les renseignements généraux, section antiterrorisme, la police judiciaire du 13earrondissement de Paris avant de sauter le pas du spectacle tout en restant inspecteur la nuit à la PJ. Il quitte définitivement la police en 1994 mais celle-ci demeure omniprésente dans son œuvre de cinéma. Avec Gangsters (2002), 36 quai des Orfèvres (2004) et MR 73 (2008), il signe une trilogie, racontant, dans le second film, les affrontements entre les divas qui dirigeaient la BRB et La BRI. Sans doute Olivier Marchal a-t-il la main un peu lourde en évoquant l’atmosphère qui régnait, à une certaine époque au 36, quai des Orfèvres, mais après tout, on est au cinéma et pas dans un rapport des « boeufs-carottes ». On est tellement au cinéma que Marchal a réuni, ici, un casting de haut vol avec Daniel Auteuil (Vrinks), Gérard Depardieu (Klein), André Dussollier (Mancini) et aussi Roschdy Zem, Valeria Golino, Daniel Duval ou Mylène Demongeot. En édition Blu-ray 4K Ultra HD. (Gaumont)
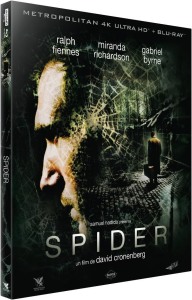 SPIDER
SPIDER
Après plusieurs années d’internement psychiatrique, Dennis Cleg, un jeune homme surnommé Spider, est transféré en foyer de réinsertion dans les faubourgs de l’est londonien. C’est à quelques rues de là qu’enfant, il a vécu le drame qui a brisé sa vie. Il n’avait pas encore douze ans, lorsque son père a tué sa mère pour la remplacer par une prostituée dont il était tombé amoureux. De retour sur les lieux du crime, Spider replonge peu à peu dans ses souvenirs et mène une étrange enquête. En 2002, entre eXistenZ (1999) et A History of Violence (2005), David Cronenberg adapte le roman éponyme de l’écrivain anglais Patrick McGrath qui signera lui-même le scénario du film. Parmi les éléments d’analyse de l’oeuvre du cinéaste canadien, la psychanalyse occupe une place importante et son influence a nourri nombre de films sondant les addictions et les phobies de la société occidentale, ainsi Vidéodrome (1983), Faux-semblants (1988), Le festin nu (1991) ou Crash (1996). Ici, Cronenberg « étudie » l’esprit d’un schizophrène. En errant sur les lieux de son enfance, en tentant de rassembler les morceaux du puzzle qu’est sa mémoire, Spider emporte le spectateur dans son monde, l’invitant à démêler le vrai du faux de sa propre réalité. Dans sa dissection d’un esprit adolescent malade, le cinéaste s’interdit le recours aux ressorts du divertissement, nous laissant le soin d’entrer, tout en lenteur contemplative, dans la tête « déraillante » du malheureux Dennis Cleg bouleversé par le complexe d’Oedipe. Si le récit est complexe, la mise en scène est brillante, pleine de subtilité et de « signes de piste ». Enfin, entouré de comédiens remarquables (Miranda Richardson et Gabriel Byrne dans le rôle des parents Cleg), Ralph Fiennes est magistral. Il ne doit pas prononcer cinq phrases de tout le film et pourtant son jeu traduit, tout en nuances, la folie qui habite le malheureux Spider. Un grand cru de Cronenberg. (Metropolitan)
 FAINEANT(E)S
FAINEANT(E)S
Amies inséparables, Nina et Djoul sont expulsées de leur squat. Elles reprennent la route à bord de leur vieux camion avec une soif de liberté et une seule obsession : faire la teuf… Ah, le monde est bien brutal pour les routardes. D’entrée, on plonge dans la violente dispersion policière d’une rave. Au fond d’un panier à salade, les deux filles se tiennent la main… Ce sont ces deux marginales que Karim Dridi, révélé par Pigalle et Bye Bye, sortis tous les deux en 1995, va suivre dans un périple aussi brinquebalant que le vieux fourgon pourri qui leur sert de demeure. Le cinéaste franco-tunisien raconte un road-movie avec des aventures, des rencontres, de sacrées galères aussi. Car l’alcool, la crasse, le blues sont au rendez-vous de ce voyage. Mais il y a aussi des moments forts et plein de pûreté, comme des instants authentiques de grâce où les regards disent le lien et les émotions. Deux comédiennes étonnantes, .jU (Djoul) et Faddo Jullian (Nina) se glissent superbement dans la peau de ces punks à chien qui aspirent, sans frein, à une liberté totale. Même si le prix à payer est bien cher. Autour de la peur, du désarroi mais aussi de la joie, Dridi signe une sombre errance en forme de mode de vie. (Blaq Out)
 TWISTERS
TWISTERS
Du temps où elle était étudiante, Kate Cooper avait été très marquée par un accident qui a tué trois de ses amis lors d’une violente tornade. Désormais, l’ancienne chasseuse de tornades préfère les étudier à New York, sans prendre de risques. Elle va cependant reprendre du service quand son ami Javi lui propose un nouvel appareil pour les détecter. Bientôt il s’agira de tenter de maitriser l’une des forces les plus destructrices de la nature : des tornades F5. En retournant sur le terrain, Kate (l’Anglaise Daisy Edgar-Jones) va croiser la route d’un insouciant chasseur vidéaste, Tyler Owens, célèbre sur les réseaux sociaux et surtout un personnage accro au danger… En 1996, on découvrait Twister mis en scène par le Hollandais Jan de Bont dans lequel Helen Hunt et Bill Paxton interprétaient des chasseurs de tempêtes à la poursuite d’une énorme tornade en Oklahoma. Deuxième film le plus rentable de 1996 aux Etats-Unis, (avec près de 55 millions d’entrées vendues sur le sol américain), Twister rapporte 495 millions de dollars dans le monde. En général, Hollywood vogue très vite sur la vague du succès. Mais, dans le cas précis, il a fallu attendre le 25e anniversaire de Twister pour voir une nouvelle version de ce film catastrophe. Etait-il bien nécessaire, comme Hollywood aime tant à la faire, de remettre, ici, une couche ? Sans doute que non mais le cinéaste coréano-américain Lee Isaac Chung (remarqué, en 2020 à Sundance avec Minari, un film évoquant sa famille s’installant dans l’Arkansas à la poursuite du rêve américain) réussit plutôt bien son coup. Certes une tornade reste une… tornade mais le film, avec des effets spéciaux très efficaces, parle globalement d’une nature qui se dérègle, générant le chaos, des pertes matérielles et surtout humaines. Les questionnements et les angoisses écologiques d’aujourd’hui sont ainsi bien présentes dans Twisters. Un film-catastrophe de qualité. (Warner)
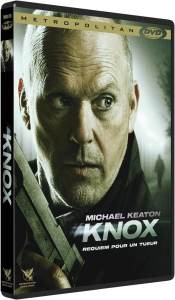 KNOX
KNOX
Tueur à gages expérimenté, John Knox apprend qu’il est atteint de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une forme de démence à évolution rapide. John a désormais de plus en plus de mal à exercer son « travail ». Lors d’un contrat, dans la confusion, il tue par erreur son partenaire et laisse de nombreux cadavres derrière lui. Il décide alors de décrocher et d’utiliser ses derniers jours pour tenter de se racheter notamment auprès de son fils, Miles, qu’il n’a pas vu depuis des années. Contre toute attente, ce dernier se présente à sa porte, blessé et les vêtements plein de sang. Miles demande de l’aide à son père et lui avoue qu’il a tué un homme… Alors que sa santé et son esprit se détériorent rapidement, Knox fait notamment appel à son vieil ami Crane (incarné par Al Pacino) qui le conseille soigneusement sur tous les aspects de ce qui doit être spécifiquement fait. Il compte également sur l’aide d’Annie, une prostituée qu’il voit tous les jeudis depuis quatre ans… Comédien connu pour ses collaborations avec Tim Burton (Beetlejuice en 1980 puis sa reprise en 2024), Michael Keaton incarne surtout Bruce Wayne/Batman dans Batman (1989) et sa suite Batman : Le Défi (1992) qui furent deux grands succès au box-office. Mais on l’a vu aussi, en pugnace journaliste d’investigation, dans Spotlight (2015) qui remporta l’Oscar du meilleur film en 2016. En 2008, Michael Keaton passait pour la première fois à la réalisation avec Killing Gentleman dans lequel il incarnait un… tueur à gages rencontrant une femme victime de violences conjugales. Avec Knox, Keaton revient donc derrière (et devant) la caméra pour un thriller à l’atmosphère tendue. Il est ce type malade qui tente de rassembler ses derniers repères. Les fans de Michael Keaton sont à la fête… (Metropolitan)
 LONGLEGS
LONGLEGS
Au FBI, l’agent Lee Harker est une nouvelle recrue talentueuse. On affecte la jeune femme (qui montre des signes de clairvoyance) sur le cas irrésolu d’un tueur en série insaisissable surnommé Longlegs (Nicolas Cage). L’enquête, aux frontières de l’occulte, se complexifie encore lorsqu’elle se découvre un lien personnel avec le tueur impitoyable qu’elle doit arrêter avant qu’il ne prenne les vies d’autres familles innocentes. En effet, dans les années 70, dans l’Oregon, Lee, alors fillette, aperçoit par la fenêtre de sa chambre un homme dans une voiture se stationner devant chez elle. Alors qu’elle sort, munie de son polaroid, l’homme, à l’allure douteuse et au teint pâle, se présente à elle et semble imprévisible. Fils de l’acteur Anthony Perkins, Osgood Perkins embarque le spectateur dans un long cauchemar qui distille d’entrée, avec une séquence d’introduction impressionnante, une solide malaise. Dans une mise en scène très soignée avec de solides déflagrations de violence, le cinéaste américain s’attache aussi à peaufiner la personnalité d’une enquêtrice isolée socialement et dont les failles vont apparaître de plus en plus fortement. Dans une atmosphère sinistre, la traque menée par Lee Harker (Maika Monroe) va prendre un tour aussi effrayant qu’onirique dans un voyage dans la part la plus sombre de l’homme. (Metrpolitan)
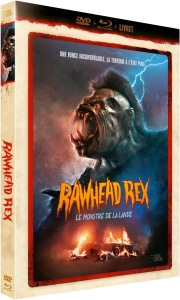 RAWHEAD REX
RAWHEAD REX
L’auteur américain Howard Hallenbeck se rend en Irlande en famille, à la recherche d’objets religieux datant d’avant le Christianisme. Au même moment, des fermiers déplacent un énorme obélisque qui trônait au milieu d’un champ, sans se douter qu’ils vont ainsi libérer une créature monstrueuse enterrée là depuis des siècles. La route de la famille Hallenbeck va alors croiser celle du monstre sanguinaire… Avant de devenir un maître de l’horreur avec entre autres Hellraiser, le romancier et cinéaste Clive Barker collabore avec le jeune réalisateur George Pavlou, qui souhaite tourner des films d’horreur, et adapte pour lui sa nouvelle Rawhead Rex. Bien que Barker s’avoue alors déçu de cette adaptation, le film est aujourd’hui un incontournable du film de monstres ! Aux éléments classiques du genre, le film ajoute des spécificités qui en font un film à part. L’action et le tournage se déroulent en Irlande, dont les paysages sauvages apportent une ambiance glauque et mystérieuse à souhait. Les scènes de nuit sont splendides, la forêt très dense fait froid dans le dos. Le scénario s’inspire de cultes anciens, impliquant notamment une déesse de la fertilité. Le monstre n’est pas juste un meurtrier sanguinaire, c’est un démon piégé depuis des millénaires dans les profondeurs de l’enfer. Entre magie blanche et magie noire (et avec son lot d’effets gore), l’histoire mélange habilement occultisme, religion et culture celte, pour une approche très british du fantastique. Entre éviscérations, décapitations, morsures fatales et corps étripés, Rawhead Rex n’a aucune pitié et n’épargne pas même les enfants ! Un film qui vaut le coup d’œil, sa créature étant l’une des plus kitsch du cinéma d’horreur. (Rimini Editions)

