L’OPTIMISME (MESURÉ) DE KAURISMAKI ET LA VÉRITÉ DE GOLDMAN
 LES FEUILLES MORTES
LES FEUILLES MORTES
Diantre que la vie est triste en Finlande ! D’entrée, la caméra de Kaurismaki se plante dans un supermarché sans âme et elle glisse sur un chariot encombré de viande sous vide. Pas follement appétissant. Dans le vestiaire, une employée enfile un petit imper bleu pâle. « A demain ! » lance une collègue. Ansa rentre chez elle. La ville, la nuit. Un petit appartement aux murs bleus avec un canapé rouge. La radio raconte la guerre en Ukraine, les frappes russes, les morts, les blessés, la maison de Serguei détruite et les larmes de Tatiana. La femme éteint la radio. Sur un chantier, un homme en combinaison et casque intégral nettoie des pièces de métal. Il s’interrompt pour boire discrètement de l’alcool dans une petite fiasque. Plus tard, allongé sur son lit dans le dortoir de son usine, Holappa lit une bande dessinée. Deux personnes solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacun tente de trouver en l’autre son premier, unique et dernier amour. Mais la vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur. Le 19e opus d’Aki Kaurismaki est une pépite de plus. Le Finlandais avait annoncé sa retraite en 2017 à Cannes. Pour notre plus grand bonheur, il a choisi d’en sortir pour donner le dernier volet de sa trilogie du prolétariat entamée en 1986 avec Ombres au paradis et poursuivie en 1990 avec La fille aux allumettes. Comme à son habitude, le cinéaste semble se tenir, non pas à bonne distance mais à une distance pudique, comme pour ne pas empiéter sur l’existence de ses deux prolétaires qu’il observe avec un soin d’entomologiste. Ainsi, ces êtres fragiles nous deviennent complètement familiers. Ansa sera virée sans préavis, de son supermarché. Holappa le sera parce qu’il est surpris en train de boire sur les chantiers. Ansa et Holappa se sont croisés dans un bar-karaoké. Ils se sont regardés. L’une et l’autre ont pensé que, peut-être, un avenir pouvait s’ouvrir à eux. Au sortir d’une séance de cinéma, Ansa (Alma Pöysti) a confié son numéro de téléphone à Holappa. Mais celui-ci perd le bout de papier sur lequel était griffonné le précieux sésame. Ansa attendra un appel qui ne viendra pas. Et Holappa (Jussi Vatanen) reviendra régulièrement attendre devant le cinéma Ritz. Mais ces deux solitudes réussiront cependant à se reconnecter… Presque optimiste, Kaurismaki signe, avec de multiples références à ses passions cinéphiliques, une œuvre où deux êtres semblent seuls, voire étrangers au monde, filmés en plan fixe, frontalement, dans des décors souvent composés de grands à-plats colorés. Avec de la musique et un (indispensable) chien pour atténuer la solitude des humains. La fin est un bijou d’émotion. Rescapé d’un accident de train, Holappa retrouve Ansa. Sur une vaste esplanade, on les voit, de dos, s’éloignant vers la lumière… Chaplin-Kaurismaki, même combat. Celui des opprimés contre le monde. (Diaphana)
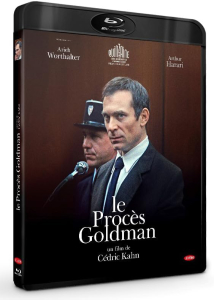 LE PROCES GOLDMAN
LE PROCES GOLDMAN
Extraordinaire parcours que celui de Pierre Goldman ! Né le 22 juin 1944 à Lyon, il est le fils de deux héros de la résistance juive communiste en France. Etudiant à la Sorbonne, il milite contre la guerre d’Algérie. Lorsqu’arrive mai 68, Goldman file en Amérique latine rejoindre Che Guevara. C’est un type amer, déprimé, déboussolé et démuni qui rentre en France en 1969. Le guérillero vire au gangster. Il commet plusieurs braquages, vole des sommes parfois dérisoires. Le 19 décembre 1969, son existence bascule… Il attaque une pharmacie du boulevard Richard Lenoir à Paris. Le hold-up finit dans le sang. Deux pharmaciennes sont tuées et un policier en civil, alors en repos mais qui se précipite sur les lieux, est sérieusement blessé. Arrêté en 1974, Pierre Goldman est condamné, pour ces faits, à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d’assises de Paris. En novembre 1975, débute le deuxième procès de Pierre Goldman. Il continue à clamer son innocence dans le dossier du double meurtre de la pharmacie du boulevard Richard Lenoir. C’est un véritable huis-clos judiciaire que propose Cédric Kahn avec cette plongée dans les arcanes d’un procès d’assises qui prend souvent une forme très houleuse… Le cinéaste découvre Goldman par son livre, Souvenirs obscurs d’un Juif polonais né en France et est frappé par sa langue, son style, sa pensée. Kahn estime que le film à faire, ce n’est pas le biopic mais le procès. On plonge ainsi dans une œuvre âpre, grave, sèche mais puissante qui s’en va chercher, si faire se peut, la vérité « à l’os ». Pas de flash-backs, pas d’images de braquage, pas de musique, pas de comédiens célèbres. Mais une mise en scène qui installe constamment la tension. Le cinéaste n’entend pas créer de point de vue ou de l’empathie mais placer le spectateur dans la position du juré. Sans fioritures. Dans ce théâtre de la justice, montent quasiment en scène les acteurs professionnels que sont le président, le procureur de la République ou encore les avocats de la partie civile ou de la défense. A l’audience, tous joueront leur rôle. Et puis, évidemment, il y a Goldman, accusé hors normes, qui donne à ce procès des accents impressionnants. Car ce militant d’extrême gauche, qui devint en quelques semaines l’icône de la gauche intellectuelle, est installé dans une posture de combat. Insaisissable et provocateur, vif et brillant dans ses répliques, Goldman lance aussi « Je suis innocent parce que je suis innocent ». Surtout Goldman (remarquablement incarné par Arieh Worthalter) est une « star » au charisme remarquable qui réussit à prendre, avec éloquence et verve, la main sur son procès. Un homme qui affirme « Je suis né et mort le 22 juin 1944 ». Car le film pose aussi la question de la judéité à travers un Goldman qui se définissait comme « un enfant de la Shoah ». L’aventure s’achèvera le 20 septembre 1979 lorsque Pierre Goldman est abattu en plein Paris. (Ad Vitam)
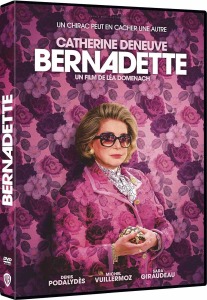 BERNADETTE
BERNADETTE
Nous sommes le 7 mai 1995 et Jacques Chirac remporte, avec 52,64 % des suffrages, l’élection présidentielle face à Lionel Jospin. La droite a reconquis le pouvoir et s’ouvre, après deux mandats de François Mitterrand, les portes de l’Elysée. Chirac goûte pleinement son succès, reçoit longuement les vivats de la foule… A deux pas du président, Bernadette Chirac savoure, elle aussi, l’instant. Parce qu’elle sait quelle fut sa part dans l’accession de son mari à l’Elysée, parce qu’elle pense aussi obtenir enfin la place qu’elle mérite. Mais Jacques Chirac va plutôt la refroidir lorsqu’il lance « Souvenez-vous de la chance de m’avoir épousé ! » Bernadette avale une couleuvre de plus. Il est vrai que Bernadette, née Chodron de Courcel, élevée dans une famille catholique pratiquante, a reçu une éducation stricte et sévère. Chez les Chodron, une fille, ça se tait et ça écoute. Elle rencontre son Jacques en 1951 lorsqu’ils sont, tous les deux, étudiants à Sciences Po. Ils se marient en mars 1956 malgré les réticences de la famille de la mariée. Bien des années plus tard, Bernadette dira que ce n’était « pas qu’un mariage d’amour mais un mariage d’ambition ». C’est une femme effacée, cantonnée à un rôle qui ne lui convient pas, à laquelle s’attache, pour son premier long-métrage de fiction, Léa Domenach. En choisissant la comédie pour garder une bonne distance par rapport aux faits et à la vraie histoire, la cinéaste se concentre sur un personnage qu’elle ne perd jamais de vue. Bernadette Chirac est toujours au centre de ce récit où elle apparaît d’abord écrasée par son entourage, délaissée aussi, toujours reléguée dans l’ombre avant d’entamer une véritable éclosion. Elle va trouver, en Bernard Niquet (Denis Podalydès), un allié qui va favoriser une véritable révélation. La première dame sort du bois, prend le taureau par les cornes et s’impose comme une personnalité incontournable dans la galaxie Chirac. Bernie n’a pas sa langue dans la poche et Claude (Sara Giraudeau) tance sa mère : « Tu ne peux plus dire tout ce que tu penses ! » En jouant habilement sur le look et les sons des années 90 et 2000, Bernadette se déguste comme une satire bienveillante et volontiers attachante. S’étant rendue compte sur le tard qu’on ne la prenait pas au sérieux parce qu’elle était une femme, Bernadette Chirac, en montrant ses crocs, va affirmer un certain féminisme… Et le film ne pouvait trouver meilleure interprète que Catherine Deneuve. On suit avec bonheur la manière dont la brillante comédienne « réveille » littéralement sa Bernadette. Au passage, Léa Domenach étrille tant Chirac (Michel Vuillermoz) qu’une classe politique triviale et suffisante. Après la vision du film, on se réconcilie (quasiment) avec cette femme forte. (Warner)
 COFFRET MASAHIDO SHINODA
COFFRET MASAHIDO SHINODA
Révélé au même moment que Nagisa Oshima ou Kiju Yoshida, le cinéaste japonais Masahiro Shinoda (qui avait été assistant de Yasujiri Ozu dans les années cinquante) fait partie de ces cinéastes exaltés et fiévreux qui éclosent au début des années 1960. Considéré comme l’un des meilleurs représentants de la nouvelle vague nippone, le réalisateur de Silence (1972) et L’étang du démon (1979) aime filmer la marge, les minorités, et le prouve de la plus belle des façons avec ces deux longs-métrages tournés à plus de vingt ans d’écart : Fleur pâle (1964), film noir flamboyant, et Gonza, le lancier (1986), sublime drame sur fond de code d’honneur, lauréat de l’Ours d’argent de la meilleure contribution artistique à la Berlinale de 1986. Dans Fleur pâle, Muraki, après avoir purgé une peine de trois ans pour homicide, réintègre son clan de yakuzas à Tokyo. En reprenant ses activités clandestines, il fait la connaissance de Saeko, qui fréquente son cercle de jeux. Il est bientôt fasciné par cette énigmatique jeune femme, elle-même irrésistiblement attirée par le monde de la nuit… Avec Gonza, le lancier, on suit les aventures de ce lancier de renom qui affronte Bannojo, un membre de son clan, pour avoir l’honneur d’accomplir la cérémonie du thé célébrant la naissance d’un héritier de leur seigneur. Pour voir les rouleaux sacrés détaillant les secrets de la cérémonie, Gonza promet d’épouser la fille de la famille qui les possède, bien qu’il soit déjà fiancé à une autre. Alors qu’il étudie les rouleaux avec Osai, la mère de la maison, Bannojo les espionne puis court proclamer dans toute la ville qu’ils ont commis un adultère… Un beau coffret regroupe ces deux œuvres fulgurantes et radicales à découvrir pour la première fois dans leur restauration 4K ! Dans les suppléments, on trouve Esthétique de la clandestinité (16 mn), un entretien filmé en 2006 où Shinoda évoque pêle-mêle l’esthétique des cartes hanafuda, l’influence des yakuzas sur la société et le monde politique japonais, ainsi que la réception de Fleur pâle, jugé « immoral » par la censure. Enfin Fleur du mal (24 mn) est un entretien avec Stéphane du Mesnildot, essayiste, spécialiste du cinéma asiatique. (Carlotta)
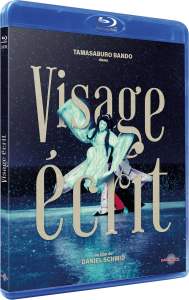 VISAGE ECRIT
VISAGE ECRIT
A l’instar de ses confrères romands Soutter, Tanner ou Goretta, le cinéaste alémanique Daniel Schmid (1941-2006) est l’une des figures marquantes du nouveau cinéma suisse. Il donna des œuvres majeures comme La Paloma (1974), L’ombre des anges (1976), Violanta (1977) ou Hécate, maîtresse de la nuit (1982). Avant d’achever sa carrière en 1999 avec Beresina ou les derniers jours de la Suisse, une virulente comédie noire sur une call-girl russe débarquant dans un pays montagneux et féérique, Schmid avait signé, en 1995, Visage écrit, un documentaire qui constate l’agonie du monde des geishas et présente le portrait d’un acteur de kabuki ainsi que d’inoubliables moments de mime au crépuscule. Il y a bientôt quatre siècles, une loi impériale japonaise imposa que les rôles de femmes dans le théâtre kabuki soient tenus par des hommes, appelés onnagata. Visage écrit de Daniel Schmid est une tentative d’approche de Tamasaburo Bando, le plus prestigieux onnagata contemporain. Ce grand acteur de kabuki, qui a également tourné pour le cinéma (L’étang du démon de Masahiro Shinoda dont Carlotta sort par ailleurs deux perles rares), est considéré comme un véritable « trésor vivant », acclamé aussi bien par Rudolf Noureev que par Yukio Mishima. Dans ce film conçu en quatre parties, le réalisateur suisse livre une œuvre hybride qui abolit les genres et les codes, naviguant allègrement entre fiction et documentaire, Japon moderne et traditionnel. À travers les portraits croisés de Tamasaburo Bando et de ses illustres aînés, comme l’actrice Haruko Sugimura ou le danseur Kazuo Ohno, Visage écrit sonde l’âme de cet art en voie de disparition et rend hommage à ces figures éternelles de la culture nippone. À découvrir pour la première fois dans sa nouvelle restauration 4K. (Carlotta)
 L’AIR DE LA MER REND LIBRE
L’AIR DE LA MER REND LIBRE
Rennes, de nos jours. Saïd habite encore chez ses parents. Le quasi-trentenaire vit une liaison secrète avec Vincent, un musicien de jazz. Incapable d’affronter sa famille, il accepte un mariage arrangé avec Hadjira. « Alors, les tourtereaux, ça va ? » La question de l’invitée à la noce n’est pas bien méchante mais pour les tourtereaux, elle résonne étrangement. Après une histoire d’amour malheureuse et quelques démêlés avec la justice, Hadjira aussi s’est résignée à obéir à sa mère. Piégés par leurs familles, les « tourtereaux » s’unissent malgré eux, pour retrouver, chacun de son côté, leur liberté. Après des films très remarqués comme Le harem de Madame Ousmane (2000), Viva Laldjérie (2004), Délice Paloma (2007) ou Lola Pater (2017), le cinéaste franco-algérien Nadir Moknèche signe une douloureuse chronique où il en va, in fine, de l’honneur des familles. Pour Saïd, sa famille, avec en tête Zineb, sa mère, et Mahmoud, son père, ne comprend pas qu’il soit toujours célibataire. Et ils trouvent même la chose anormale. Pour Rabia, la mère d’Hadjira, il importe de sauver la face. Car sa fille a eu le malheur de tomber amoureuse d’un dealer qui l’a entraînée dans ses embrouilles. Avec beaucoup d’humanité et de finesse, le cinéaste se penche sur Saïd et Hajira et observe comment ils tentent d’organiser, sans être franchement dupes l’un et l’autre, leur situation d’époux et d’épouse. Et il peut ainsi lutter contre les clichés, les à-priori et toutes les « bonnes raisons ». Face à des comédiens chevronnés comme Zinedine Soualem ou Lubna Azabal, Youssouf Abi-Ayad et Kenza Fortas (César du meilleur espoir féminin 2018 pour Shéhérazade) campent avec beaucoup de délicatesse deux personnages ballottés par les événements. (Pyramide)
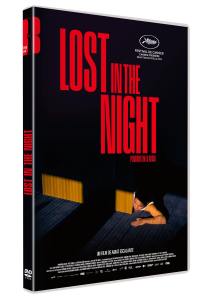 LOST IN THE NIGHT
LOST IN THE NIGHT
Dans une petite ville minière du Mexique, Emiliano recherche les responsables de la disparition de sa mère. Activiste écologique, elle s’opposait à l’industrie minière locale. Ne recevant aucune aide de la police ou du système judiciaire, ses recherches le mènent à la riche famille Aldama. Au-delà des parents, le père est artiste, la mère actrice, il rencontre leur ravissante fille qui joue les influenceuses. Engagé par les Aldama, Emiliano (Juan Daniel Garcia Trevino) n’entend pas s’éloigner du but qu’il s’est fixé… Peut-être moins connu que ses confrères Cuaron, Del Toro ou Inarittu, le Mexicain Amat Escalante est cependant un cinéaste reconnu et apprécié des cinéphiles qui a été pas moins de quatre fois sur la Croisette, notamment en 2013 avec Heli, violente évocation du trafic de drogue, couronné d’un prix de la mise en scène. Du côté de la Mostra de Venise en 2016, Escalante avait surpris, cette fois, avec un conte fantastique (La région sauvage) sur fond de sexualité et de bête étrange. Avec Perdidos en la noche (en v.o.), Escalante était de retour au festival de Cannes avec un thriller social palpitant, qui emporte le spectateur au cœur d’un pays gangréné par la violence et les inégalités. Tour à tour satire noire de la société mexicaine, dénonçant les fléaux que sont la corruption, la violence policière, les narco-trafiquants, ou encore l’exploitation des pauvres par les riches, le scénario de Lost in the night s’élargit à des thèmes plus universels tels que les dérives liées aux réseaux sociaux, le profit avant l’écologie, voire même les excès de l’art contemporain. Bien photographiée, bien interprétée, voici une chronique criminelle sèche et brutale sur la noirceur de la société mexicaine. (Blaq Out)
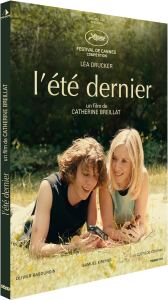 L’ETE DERNIER
L’ETE DERNIER
Avocate pénaliste renommée et spécialisée dans les violences sexuelles faites aux mineurs, Anne s’occupe d’un dossier qui finira aux assises où « souvent les victimes passent pour des accusés ». A sa cliente, elle donne un conseil : « Toujours dire la vérité ». Anne vit en harmonie avec son mari Pierre et leurs deux jeunes fillettes. Un jour, Théo, 17 ans, fils de Pierre (Olivier Rabourdin) d’un précédent mariage, emménage chez eux. Odieux, Théo s’adoucit au contact d’Anne. Un jour, au gré d’une histoire de tatouages, s’installe entre les deux, un jeu de séduction qui les amène à une puissante relation charnelle… La réalisatrice de films jugés sulfureux (Breillat déteste le mot) comme Romance (1999) ou Anatomie de l’enfer (2004), reprend (librement) le thème d’un film danois (Queen of Hearts en 2019) et propose la chronique d’un amour « interdit » dans le contexte d’un milieu de nantis sans problème. Si on peut trouver que le drame bourgeois prend parfois des accents chabroliens, il faut dire que Catherine Breillat s’y entend pour filmer le désir et le plaisir dans de longs plans qui dilatent la sensation. En cédant à son beau-fils, Anne se précipite dans une liaison à laquelle elle voudra vite mettre fin. Mais Théo ne l’entend pas de cette oreille et il intrigue auprès de son père, flairant qu’Anne demeure bouleversée par leur liaison. La cinéaste se repose sur un fin duo d’acteurs avec Samuel Kircher en grand ado à la gueule d’ange et Léa Drucker brillante en executive woman énigmatique mais dévastée par une divine extase… (Pyramide)
 LE REGNE ANIMAL
LE REGNE ANIMAL
Alors que le monde s’est déjà habitué à une épidémie de mutations qui transforment les humains en animaux, François doit déménager dans le sud de la France pour se rapprocher de sa femme Lana, touchée par ce mal mystérieux et envoyée dans un centre spécialisé. Sur place, lui et son fils Émile doivent se réinventer dans un monde qui se peuple de créatures d’un nouveau genre. Dans leur voiture, le père tente de dialoguer avec son fils qui regarde par la fenêtre et soupire. Il est question de la mère d’Emile… Sur l’autoroute, ils sont coincés dans un embouteillage. Banal et agaçant. Mais soudain, François et Emile observent, à deux pas d’eux, une ambulance violemment secouée de l’intérieur. La porte s’arrache. Une créature mi-homme, mi-oiseau s’enfuit… Les monstres sont (déjà) là ! Après Les combattants (2014) couronné d’un César du meilleur premier film, Thomas Cailley, qui s’appuie sur une idée de Pauline Munier, fait un retour en force avec un thriller réaliste doublé d’une touche de teen-movie mais surtout d’une fable fantastique impressionnante où les « humains » se métamorphosent inexplicablement en bêtes sauvages… Avec un excellent tandem de comédiens (Romain Duris et le jeune Paul Kircher), le cinéaste aligne les moments de bravoure au service d’un conte audacieux qui va suivre l’épopée d’un adolescent qui va se métamorphoser aussi… (Studiocanal)
 ENTRE LES LIGNES
ENTRE LES LIGNES
Au printemps 1924, Jane Fairchild, jeune domestique au sein d’une famille anglaise endeuillée, devient la maîtresse de Paul Niven, un jeune homme de la haute bourgeoisie, fils des voisins de ses patrons. Des années plus tard, devenue écrivaine, Jane se remémore ce jour de fête des mères où pendant que les propriétaires partaient à un pique-nique, elle retrouvait secrètement cet amant… Remarquée avec Les filles du soleil sélectionné en compétition officielle au festival de Cannes 2018, la réalisatrice française Eva Husson a signé ensuite Mothering Sunday (en v.o.) qui met en scène, un peu dans l’esprit de Downton Abbey, l’aventure amoureuse d’une bonne et d’un jeune de la haute, lui-même promis à une autre femme de son rang. En adaptant un roman de Graham Swift, la cinéaste s’attache à une relation ténébreuse entre deux amoureux qui bravent les interdits d’une société organisée en classes. Déjà, dans Bang Gang (une histoire d’amour moderne), son premier long-métrage, en 2015, Eva Husson s’attachait à explorer la sexualité et les relations amoureuses chez de grands adolescents. Ici, encore, en travaillant de belles lumières, elle maîtrise les scènes intimistes en s’appuyant sur deux jeunes comédiens Odessa Young (Jane) et Josh O’Connor (Paul) dont la spontanéité de jeu, avec de nombreuses scènes de nudité, est remarquable. Enfin, la cinéaste peut se reposer sur un casting british de qualité avec notamment Colin Firth (le père de Paul), Glenda Jackson (Jane Fairchild âgée) et surtout l’excellente Olivia Colman (Oscar de la meilleure actrice pour La favorite en 2018), épatante en mère cynique et meurtrie à l’idée de perdre son fils unique… (Condor)
 MYSTERE A VENISE
MYSTERE A VENISE
Dans la Venise de 1947, Hercule Poirot a choisi de prendre une retraite paisible. Le célèbre détective belge repousse fermement tous ceux qui sollicitent ses services. Pourtant, il prête l’oreille à Ariadne Oliver, la plus grande écrivaine de romans policiers au monde. Mais sa visite n’a rien à voir, dit-elle, avec un crime… Après Le crime de l’Orient-Express (2017) et Mort sur le Nil (2022), Kenneth Branagh s’attaque à nouveau à Agatha Christie en adaptant Hallowe’en Party, un roman tardif publié en 1969. Le film transpose l’action d’un manoir anglais à un palazzo vénitien mais le scénario de Michael Green s’appuie volontiers sur le goût de la romancière pour le surnaturel. Par une sombre nuit de tempête, Poirot se retrouve dans une maison (soit-disant) hantée mais, avec la mort violente d’une voyante, l’enquête prend une vilaine tournure. Il fait boucler toutes les portes. Le piège est refermé. L’assassin est dans les lieux… Bientôt une seconde mort brutale survient… Avec un récit soigné et des images léchées, Branagh réussit un agréable huis-clos où, comme à son habitude, il réunit un large casting (Kelly Reilly, Michelle Yeoh, Riccardo Scamarcio, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey) et s’offre, avec une évidente gourmandise, un Poirot à l’accent français appuyé. Ah oui, Poirot va résoudre l’énigme ! (Fox)
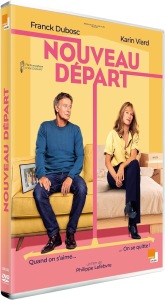 NOUVEAU DEPART
NOUVEAU DEPART
« A l’éternelle jeunesse de la femme que j’aime ! » Alain lève son verre à Diane dont il est amoureux comme au premier jour. Lui a traversé la crise de la cinquantaine sans coup férir. Pour Diane, c’est moins évident. « Après trente ans ensemble, on n’est plus amoureux. On est un couple… » Et elle nie la réalité quand son généraliste lui parle de ménopause. Diane a la sensation de s’ennuyer dans son couple comme dans son travail dans le journalisme. Pour attirer l’attention de ses collègues, elle prétend avoir une liaison avec Stéphane, son jeune et nouveau supérieur. Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, estime qu’il faut se poser les questions essentielles. Et s’il prenait le risque, après trente ans de vie commune, de quitter Diane pour réveiller la flamme et l’envie de se retrouver. Quitte ou double ? En s’inspirant du film argentin Retour de flamme de Juan Vera, Philippe Lefebvre (Le siffleur, Faites des gosses) orchestre une rencontre inattendue entre Karin Viard et Franck Dubosc qui partagent l’écran pour la première fois. En s’appuyant sur des comédiens qui semblent manifestement s’amuser, le cinéaste réussit des situations cocasses et des dialogues enlevés. Une bonne comédie agréable avec un propos dans l’air du temps. (Orange Sudio)

