LE CINEMA ET TANT DE SCENES MARQUANTES
CONFINEMENT, DECONFINEMENT, RE-CONFINEMENT, COUVRE-FEU… LONGTEMPS (TROP LONGTEMPS !) ES SALLES DE CINEMA ONT TIRE LE RIDEAU…
POUR ATTENDRE LE PLAISIR DE RETROUVER LES SALLES OBSCURES, EXTERIEUR-JOUR A EVOQUE DES MOMENTS MARQUANTS DU 7E ART… ON LES RETROUVE, ICI, POUR MEMOIRE.
LA ROSE POURPRE DU CAIRE.- S’installer dans une salle de cinéma et savourer des images qui vous transportent dans un monde différent de celui du quotidien, quoi de plus enivrant ? Justement, le quotidien de Cécilia, petite serveuse dans le Brooklyn des années trente, pendant la Grande Dépression, n’a rien de joyeux. Son patron lui mène la vie dure et Monk, son mari chômeur, est un tire-au-flanc qui force sur la bouteille autant que sur des conquêtes d’un soir. Alors Cécilia (Mia Farrow) se console en se réfugiant dans l’obscurité complice du Jewel Palace. En 1985, Woody Allen donne The Purple Rose of Cairo. Le cinéaste, qui a souvent déclaré que c’était son film favori, a tourné les scènes de cinéma au Kent Theater, sur Coney Island Avenue à Brooklyn, dans le quartier de son enfance…
 La scène la plus fameuse est celle où Tom Baxter, le héros de La rose pourpre du Caire, s’interrompt dans son texte, fixe Cécilia dans la salle et lui lance : « Mon Dieu, que vous devez l’aimer ce film ! C’est déjà la cinquième fois que vous le voyez ! » Cécilia est interloquée : « Moi ? » Et soudain, le héros sort de l’écran, passant du noir et blanc à la couleur de la vie réelle. Baxter : « Je dois vous parler ! Je veux voir comment c’est ici ! » Cécilia : « Vous êtes dans le film ! » Mais Tom Baxter (Jeff Daniels) est décidé à choisir la liberté après « 2000 séances identiques et d’une parfaite monotonie ». Pas question de retourner dans le film, au grand dam de ses collègues comédiens… Comme Cécilia, Allen rêve les yeux ouverts et nous entraîne dans la poésie des images de cinéma. Magique !
La scène la plus fameuse est celle où Tom Baxter, le héros de La rose pourpre du Caire, s’interrompt dans son texte, fixe Cécilia dans la salle et lui lance : « Mon Dieu, que vous devez l’aimer ce film ! C’est déjà la cinquième fois que vous le voyez ! » Cécilia est interloquée : « Moi ? » Et soudain, le héros sort de l’écran, passant du noir et blanc à la couleur de la vie réelle. Baxter : « Je dois vous parler ! Je veux voir comment c’est ici ! » Cécilia : « Vous êtes dans le film ! » Mais Tom Baxter (Jeff Daniels) est décidé à choisir la liberté après « 2000 séances identiques et d’une parfaite monotonie ». Pas question de retourner dans le film, au grand dam de ses collègues comédiens… Comme Cécilia, Allen rêve les yeux ouverts et nous entraîne dans la poésie des images de cinéma. Magique !
LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS.- Qui incarne le panache cinématographique par excellence ? Robin des Bois, assurément ! D’ailleurs, le 7e art l’a mis à tous les régimes. Du muet à l’animation Disney en passant par la parodie façon Mel Brooks, l’avatar italien où il bataille avec des pirates ou les grosses productions pour mettre en vedette Russell Crowe ou Kevin Costner. Mais indiscutablement, le meilleur de tous les Robin des Bois est celui que Michael Curtiz tourna en 1938 dans un Technicolor aussi flamboyant que l’était l’interprète de Robin de Locksley. On a nommé le magnifique Errol Flynn ! Jeune seigneur saxon, Robin de Locksley est fidèle au roi Richard Cœur de Lion, retenu prisonnier en Autriche alors que le prince Jean, son frère, règne, en despote, sur l’Angleterre. Avec ses amis hors-la-loi réunis dans la forêt de Sherwood, Robin va affronter Jean et son âme damnée Gisbourne.
 Michael Curtiz installe d’emblée une grande séquence d’action. Un cerf sur les épaules, Robin vient au château de Nottingham provoquer le prince Jean et ses sbires. Souriant, Robin affronte une impressionnante troupe. Une lance qui se fiche, en gros plan, à côté de sa tête lance les hostilités. Bondissant en diable, Robin renverse les tables, les bancs, se bat à l’épée, se sort d’une mêlée hostile, escalade des escaliers et se montre brillant archer. Plein de malice, il se fait enfin ouvrir la porte du château pour filer à cheval en compagnie de frère Tuck et L’Ecarlate. Présente à Nottingham, Lady Marian est désormais sous le charme de Robin…
Michael Curtiz installe d’emblée une grande séquence d’action. Un cerf sur les épaules, Robin vient au château de Nottingham provoquer le prince Jean et ses sbires. Souriant, Robin affronte une impressionnante troupe. Une lance qui se fiche, en gros plan, à côté de sa tête lance les hostilités. Bondissant en diable, Robin renverse les tables, les bancs, se bat à l’épée, se sort d’une mêlée hostile, escalade des escaliers et se montre brillant archer. Plein de malice, il se fait enfin ouvrir la porte du château pour filer à cheval en compagnie de frère Tuck et L’Ecarlate. Présente à Nottingham, Lady Marian est désormais sous le charme de Robin…
LA REINE CHRISTINE.- Et Greta Garbo devint la Divine… Ou comment une petite boulotte de Stockholm nommée Greta Lovisa Gustaffson, accéda par la magie d’Hollywood au rang de mythe absolu. Bien sûr, il y a eu Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, Ava Gardner, Rita Hayworth mais Garbo qui disait : « Je veux qu’on me laisse tranquille », avait quelque chose d’autre. Une prédilection pour le secret qui fit qu’elle fut, for ever, belle, lointaine et inaccessible. Du milieu des années vingt à 1941, la Divine tourna au total une petite trentaine de films avant de tirer définitivement sa révérence en refusant catégoriquement de paraître en public, même si ses promenades incognito dans New York sont restées fameuses.
C’est sur le tournage d’Anna Christie (1929) que Garbo et son amie Salka Viertel parlent de Christine de Suède, atypique souveraine du 17e siècle qui, dernière de sa lignée, décida d’abdiquer pour pouvoir épouser celui qu’elle aime. Une reine à la liberté de mœurs exceptionnelles que Queen Christina (1933) ne gomme pas et qui contribua à faire de Garbo une icône très moderne de l’androgynie décomplexée…
 Devant la caméra de Rouben Mamoulian et en compagnie de son ami John Gilbert, Greta Garbo va composer l’un de ses plus beaux personnages et la séquence finale est un moment de pure émotion tragique. Christine, les cheveux dans le vent, s’avance et demeure debout à la proue d’un bateau en partance, le regard dans le lointain. Travelling avant sur un sublime visage en très gros plan qui est comme une feuille immaculée où chacun peut écrire sa propre fin du film. Fondu au noir. The End.
Devant la caméra de Rouben Mamoulian et en compagnie de son ami John Gilbert, Greta Garbo va composer l’un de ses plus beaux personnages et la séquence finale est un moment de pure émotion tragique. Christine, les cheveux dans le vent, s’avance et demeure debout à la proue d’un bateau en partance, le regard dans le lointain. Travelling avant sur un sublime visage en très gros plan qui est comme une feuille immaculée où chacun peut écrire sa propre fin du film. Fondu au noir. The End.
L’AMANT.- Sur une proposition de Claude Berri, Jean-Jacques Annaud, au début des années 90, lit L’amant, l’autofiction de Marguerite Duras primée par le prix Goncourt en 1984. Dans un premier temps, le cinéaste refuse le projet puis finira par s’attacher à ce récit au féminin où Duras narre, au milieu des années vingt, son adolescence dans l’Indochine française et notamment sa découverte du plaisir physique au cœur d’une liaison sulfureuse avec un riche Chinois. Le cinéaste sent que dans ce film, il pourra déployer ses thèmes favoris, notamment son goût pour le passé, les beaux lieux exotiques et les récits initiatiques. Déçue par le film d’Annaud, Duras reviendra sur cette période adolescente en réécrivant L’amant sous le titre de L’amant de la Chine du Nord.
 Si cette aventure intime et sensuelle contient moultes séquences torrides de sexe (qui ont probablement contribué à son imposant succès populaire), la scène de la limousine distille, elle, un érotisme subtil mais puissant. Une belle limousine file à travers la campagne vietnamienne. A bord, la jeune fille au chapeau d’homme (Jane March) et le Chinois (Tony Leung Ka-fai) bavardent. Le véhicule franchit un pont. Cahotés, les passagers posent leurs mains sur la banquette. Annaud filme alternativement la nymphette inexpérimentée et le Chinois fébrile mais distingué et leurs mains en gros plan. Les auriculaires se frôlent. Les yeux de la fille se ferment, le Chinois transpire. Les doigts s’enlacent de plus en plus fortement. A travers un paysages d’arbres, la limousine, dans le fond du plan, fonce en travelling…
Si cette aventure intime et sensuelle contient moultes séquences torrides de sexe (qui ont probablement contribué à son imposant succès populaire), la scène de la limousine distille, elle, un érotisme subtil mais puissant. Une belle limousine file à travers la campagne vietnamienne. A bord, la jeune fille au chapeau d’homme (Jane March) et le Chinois (Tony Leung Ka-fai) bavardent. Le véhicule franchit un pont. Cahotés, les passagers posent leurs mains sur la banquette. Annaud filme alternativement la nymphette inexpérimentée et le Chinois fébrile mais distingué et leurs mains en gros plan. Les auriculaires se frôlent. Les yeux de la fille se ferment, le Chinois transpire. Les doigts s’enlacent de plus en plus fortement. A travers un paysages d’arbres, la limousine, dans le fond du plan, fonce en travelling…
OUT OF AFRICA.- Lorsqu’on a vu la savane s’étendre à l’infini du côté du Masaï Mara et le soleil s’y coucher dans une formidable flamboyance orange, on retrouve parfois, dans l’oreille, les accents somptueux de l’adagio du concerto K.622 de Mozart. Comme si, à cause du film de Sydney Pollack, l’unique concerto pour clarinette du divin Amadeus était indissociablement lié à la belle histoire de Karen Blixen, femme libre, pionnière mais désemparée et de Denys Finch Hatton, aventurier solitaire incapable d’abandonner sa liberté. Quintessence du film d’amour, Out of Africa s’ouvre sur les mots de Karen Blixen qui, au soir de sa vie, se souvient de son aventure kenyane : « J’avais une ferme en Afrique, au pied de la montagne du Ngong. » S’appuyant sur le roman autobiographique de l’écrivaine danoise, Pollack a construit une œuvre d’un absolu lyrisme portée par Meryl Streep et Robert Redford, couple de stars au sommet de la séduction.
 Si les belles scènes ne manquent pas dans ce film sept fois couronnés par les Oscars, celle du vol du biplan jaune De Havilland intègre superbement les deux héros de ce mélodrame à l’ancienne dans la réalité de la nature africaine. Sans dialogue mais avec l’ample musique de l’oscarisé John Barry, le cinéaste filme, en plans d’ensemble, la course des buffles dans la savane, les méandres d’une rivière, une chute d’eau au cœur de la forêt ou encore le passage du petit avion au-dessus d’un imposant banc de flamants roses… Seul plan serré dans l’avion, celui, où, les cheveux au vent, Karen, radieuse, tend la main à Denys qui la serre longuement…
Si les belles scènes ne manquent pas dans ce film sept fois couronnés par les Oscars, celle du vol du biplan jaune De Havilland intègre superbement les deux héros de ce mélodrame à l’ancienne dans la réalité de la nature africaine. Sans dialogue mais avec l’ample musique de l’oscarisé John Barry, le cinéaste filme, en plans d’ensemble, la course des buffles dans la savane, les méandres d’une rivière, une chute d’eau au cœur de la forêt ou encore le passage du petit avion au-dessus d’un imposant banc de flamants roses… Seul plan serré dans l’avion, celui, où, les cheveux au vent, Karen, radieuse, tend la main à Denys qui la serre longuement…
LES AILES DU DESIR.- Lorsqu’au mitan des années 80, Wim Wenders sollicite son ami Peter Handke pour son prochain film, il lui explique que son histoire ne tient qu’en quelques mots, celle d’un ange gardien (ou plutôt de deux, afin qu’ils puissent échanger) qui tombe amoureux et qui veut revêtir la condition humaine. Wenders qui rentre des USA, où il a tourné Paris Texas (1984), veut faire un film dans et sur Berlin, sur le passé de la ville et sur celui de l’Allemagne, sur la langue allemande et sa poésie, sur la destruction de la ville, sur le « comment vivre ? »
 Der Himmel über Berlin –prix de la mise en scène à Cannes 1987- est une fable allégorique et aussi le conte moral d’un cinéaste étranger chez lui qui s’interroge sur le Mal et la mort de Dieu. Dans le Berlin d’avant la chute du Mur, les anges Damiel et Cassiel s’intéressent au monde des mortels. Ils entendent tout, même les secrets les plus intimes, et voient tout, croisant notamment Peter Falk venu à Berlin tourner un film ou Marion (Solveig Dommartin), une trapéziste de cirque pour laquelle Damiel éprouvera un désir inconnu. Invisibles aux autres (sauf aux enfants), les anges ne le sont pas pour le spectateur. Wenders a confié à Bruno Ganz et Otto Sander, deux acteurs qui se sont connus sur la scène de la Schaubühne, le soin d’incarner ces esprits au look banal. Cependant leur errance dans Berlin les amène en des lieux inaccessibles pour l’humain. Ainsi ces images où, pour observer le ballet des mortels en contrebas, Damiel se tient à côté de la tête de la statue dorée au sommet de la Siegessäulle du Tiergarten…
Der Himmel über Berlin –prix de la mise en scène à Cannes 1987- est une fable allégorique et aussi le conte moral d’un cinéaste étranger chez lui qui s’interroge sur le Mal et la mort de Dieu. Dans le Berlin d’avant la chute du Mur, les anges Damiel et Cassiel s’intéressent au monde des mortels. Ils entendent tout, même les secrets les plus intimes, et voient tout, croisant notamment Peter Falk venu à Berlin tourner un film ou Marion (Solveig Dommartin), une trapéziste de cirque pour laquelle Damiel éprouvera un désir inconnu. Invisibles aux autres (sauf aux enfants), les anges ne le sont pas pour le spectateur. Wenders a confié à Bruno Ganz et Otto Sander, deux acteurs qui se sont connus sur la scène de la Schaubühne, le soin d’incarner ces esprits au look banal. Cependant leur errance dans Berlin les amène en des lieux inaccessibles pour l’humain. Ainsi ces images où, pour observer le ballet des mortels en contrebas, Damiel se tient à côté de la tête de la statue dorée au sommet de la Siegessäulle du Tiergarten…
M*A*S*H*.- En 1970, le Festival de Cannes attribue sa Palme d’or à une farce antimilitariste unique en son genre… Robert Altman, alors âgé de 45 ans, lance ainsi sa carrière avec un imposant succès. Du côté de la Fox, on avait établi une belle liste de réalisateurs à même de mettre en scène cette aventure peu banale. Mankiewicz, Lean, Penn ou Nichols refusèrent de se frotter à un projet sujet à controverses. Engagé, Altman met les choses au clair : son film est une occasion d’agresser le public et, plus généralement, la race humaine qu’il tient pour responsable de toutes les atrocités commises à travers le monde. M*A*S*H*, c’est l’histoire de quelques chirurgiens d’une unité de campagne pendant la guerre de Corée en 1951. Parmi eux, les capitaines « Hawkeye » Pierce (Donald Sutherland) et « Trapper John » McIntyre (Elliot Gould), remarquables praticiens mais fêtards invétérés rebelles à toute autorité.
 L’une des scènes les plus connues de cette tonique pochade met aux prises le groupe de médecins et l’infirmière-major Margaret O’Houlihan (Sally Kellermann). Surnommée « Lèvres en feu » (Hot Lips), elle est spécialement coincée mais Hawkeye constate, au bloc, « Tu es une emmerdeuse mais une sacrée infirmière ». Pour s’assurer qu’elle est une vraie blonde, les paris sont pris. Un piège est organisé pendant la douche de Hot Lips. Les parieurs s’installent alors comme au théâtre avec boissons et jumelles. Un lourd contrepoids arrache brutalement la bâche de la douche et dévoile Hot Lips dans le plus simple appareil. Elle se jette au sol en hurlant tandis que le public applaudit !
L’une des scènes les plus connues de cette tonique pochade met aux prises le groupe de médecins et l’infirmière-major Margaret O’Houlihan (Sally Kellermann). Surnommée « Lèvres en feu » (Hot Lips), elle est spécialement coincée mais Hawkeye constate, au bloc, « Tu es une emmerdeuse mais une sacrée infirmière ». Pour s’assurer qu’elle est une vraie blonde, les paris sont pris. Un piège est organisé pendant la douche de Hot Lips. Les parieurs s’installent alors comme au théâtre avec boissons et jumelles. Un lourd contrepoids arrache brutalement la bâche de la douche et dévoile Hot Lips dans le plus simple appareil. Elle se jette au sol en hurlant tandis que le public applaudit !
LE ROMAN D’UN TRICHEUR.- Pour résumer l’épatant film qu’il tire, en 1936, de son propre roman, Sacha Guitry écrit : « Quarante ans de la vie d’un homme auquel ses mauvaises actions portent bonheur et que la chance abandonne aussitôt qu’il veut s’amender ». Assis à la terrasse d’un café, un homme mûr –Sacha Guitry, lui-même- rédige ses mémoires : il raconte comment son destin fut définitivement scellé lorsque, à l’âge de douze ans, parce qu’il avait volé dans le tiroir-caisse de l’épicerie familiale pour s’acheter des billes, il fut privé de dîner. Le soir même, toute sa famille meurt empoisonnée en mangeant un plat de champignons. François Truffaut, alors critique, observe que Le roman… est l’unique film de fiction de l’histoire du cinéma qui soit commenté en voix off à 90% et qui réussit, avec maestria, à faire oublier cette singularité. Du coup, tout en jouant les voix de tous les personnages, Guitry peut donner toute sa dimension d’acteur et goûter le bonheur des maquillages, des postiches, des fausses calvities. Et il se régale !
 Le film s’ouvre sur l’évocation du drame et la présentation dans un rapide travelling des membres de la famille nombreuse. Une plongée montre les mêmes douze à table puis un gros plan sur une cocotte fumante de champignons, enfin un plan d’ensemble, toujours en plongée, sur le gamin seul à table. Suivront les cadavres sur les lits, le passage du médecin et du curé, les obsèques tandis que le gamin constate : « J’étais vivant parce que j’avais volé. De là à en conclure que les autres étaient morts parce qu’ils étaient honnêtes… »
Le film s’ouvre sur l’évocation du drame et la présentation dans un rapide travelling des membres de la famille nombreuse. Une plongée montre les mêmes douze à table puis un gros plan sur une cocotte fumante de champignons, enfin un plan d’ensemble, toujours en plongée, sur le gamin seul à table. Suivront les cadavres sur les lits, le passage du médecin et du curé, les obsèques tandis que le gamin constate : « J’étais vivant parce que j’avais volé. De là à en conclure que les autres étaient morts parce qu’ils étaient honnêtes… »
PARAMATTA, BAGNE DE FEMMES.- A la fin des années vingt, Detlef Sierck est déjà un metteur en scène de théâtre reconnu en Allemagne mais c’est en rejoignant les célèbres studios de l’UFA à Berlin qu’il va entrer dans l’univers du cinéma et s’imposer définitivement grâce à Zu neuen Ufern, un mélodrame (1937) qui aura aussi le mérite de voir naître la plus grande star du Troisième Reich. Zarah Leander (1907-1981) est une chanteuse et comédienne suédoise que Sierck découvre sur une scène viennoise. Il est aussitôt frappé par cette grande Nordique charpentée et blonde à l’air mélancolique et au visage lisse. Comme l’UFA est en quête de têtes d’affiche (Marlène Dietrich a « fui » aux USA), Zarah Leander et sa voix très grave vont faire merveille. Elle décroche ainsi son premier grand rôle dans ce mélodrame où elle incarne Gloria Vane qui, par amour pour un aristocrate anglais ruiné, s’accusera de faux et sera déportée au bagne de Paramatta en Australie…
 Le futur Douglas Sirk (qui brillera à Hollywood avec Le mirage de la vie ou Tout ce que le ciel permet) filme avec délices une Leander passant de chanteuse londonienne au matricule 218 du bagne de Sidney mais continuant toujours à chanter. L’une des scènes les plus étonnantes est celle où les détenues, tel du bétail, défilent, dans une salle de la prison, devant des colons en quête de fiancées. Car, pour les prisonnières, convoler, seul, permet d’échapper à la peine. Les yeux baissés, Gloria Vane suit le mouvement. Un rustaud la choisit brutalement mais Henry Hoyer, un fermier du bush, s’interpose et la demande en mariage…
Le futur Douglas Sirk (qui brillera à Hollywood avec Le mirage de la vie ou Tout ce que le ciel permet) filme avec délices une Leander passant de chanteuse londonienne au matricule 218 du bagne de Sidney mais continuant toujours à chanter. L’une des scènes les plus étonnantes est celle où les détenues, tel du bétail, défilent, dans une salle de la prison, devant des colons en quête de fiancées. Car, pour les prisonnières, convoler, seul, permet d’échapper à la peine. Les yeux baissés, Gloria Vane suit le mouvement. Un rustaud la choisit brutalement mais Henry Hoyer, un fermier du bush, s’interpose et la demande en mariage…
ENTREE DES ARTISTES.- « Mettre un peu d’art dans sa vie et un peu de vie dans son art », c’est le conseil que le professeur Lambertin donne à ses élèves à la fin d’Entrée des artistes. En 1938, Marc Allégret raconte l’histoire d’élèves comédiens au Conservatoire de Paris dans une belle défense et illustration du métier de comédien. Qui mieux que l’immense Louis Jouvet pouvait incarner ce Lambertin qui lui ressemble comme un double !
 La scène la plus enlevée de cette comédie dramatique reposant sur les dialogues brillants d’Henri Jeanson, se déroule dans un atelier de blanchisserie. Lambertin a reçu une lettre qui contient « dix fautes d’orthographe, quatre de syntaxe et une protestation ». L’auteur, oncle d’Isabelle, apprentie-comédienne, veut qu’elle abandonne le Conservatoire. Songeant à son père qui voulait l’empêcher de faire du théâtre, Lambertin décide d’aller voir l’oncle… Dans la boutique, il lance à M. Grenaison : « Vous ressemblez furieusement à votre écriture. » Devant un café, Lambertin commence : « Ai-je l’air d’un excentrique, d’un dément ou d’un hors-la-loi ? Je suis officier de la Légion d’honneur. Cet attribut me donne le privilège d’être écouté respectueusement par les imbéciles. » Il prend alors la défense d’Isabelle et obtient que les Grenaison respectent son choix. Traversant la boutique, Lambertin conclut : « Je serai comédien quoi que vous en disiez. Je ne finirai pas mes jours entre une pile de mouchoirs et une douzaine de chemises de plastron. Voilà ce que j’aurai dû dire à mon père quand j’avais 17 ans, il y a un peu plus de 30 ans. » Fondu au noir.
La scène la plus enlevée de cette comédie dramatique reposant sur les dialogues brillants d’Henri Jeanson, se déroule dans un atelier de blanchisserie. Lambertin a reçu une lettre qui contient « dix fautes d’orthographe, quatre de syntaxe et une protestation ». L’auteur, oncle d’Isabelle, apprentie-comédienne, veut qu’elle abandonne le Conservatoire. Songeant à son père qui voulait l’empêcher de faire du théâtre, Lambertin décide d’aller voir l’oncle… Dans la boutique, il lance à M. Grenaison : « Vous ressemblez furieusement à votre écriture. » Devant un café, Lambertin commence : « Ai-je l’air d’un excentrique, d’un dément ou d’un hors-la-loi ? Je suis officier de la Légion d’honneur. Cet attribut me donne le privilège d’être écouté respectueusement par les imbéciles. » Il prend alors la défense d’Isabelle et obtient que les Grenaison respectent son choix. Traversant la boutique, Lambertin conclut : « Je serai comédien quoi que vous en disiez. Je ne finirai pas mes jours entre une pile de mouchoirs et une douzaine de chemises de plastron. Voilà ce que j’aurai dû dire à mon père quand j’avais 17 ans, il y a un peu plus de 30 ans. » Fondu au noir.
LE FESTIN DE BABETTE.- Force est de reconnaître que les danois pramdragergryde, sakkuk ou ølben ne figurent pas au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. C’est pourtant un film danois qui célèbre magnifiquement la grande cuisine… française. En 1987, Gabriel Axel s’inspire d’une nouvelle de sa compatriote Karen Blixen pour mettre en scène Babettes Gaestebud. Voici l’odyssée de Babette Hersant qui, fuyant la répression de la Commune, se réfugie dans un petit village du Jutland. Un soir de tempête, exténuée, elle frappe à la porte de deux soeurs et leur propose ses services comme servante… Mais Babette n’est pas une servante ordinaire. A Paris, elle dirigea les cuisines du Café anglais et régalait ses clients de mets succulents. Un jour, elle gagne 10.000 francs à une loterie en France. Elle propose alors d’organiser un dîner de douze couverts. A condition que les convives ne fassent aucun commentaire sur les plats.
 Dans une belle séquence, Axel filme alternativement Babette dans sa cuisine, assurant avec maîtrise ses préparations et les austères convives découvrant, tour à tour des blinis Demidoff ou des cailles en sarcophage farcies de foie gras et sauce aux truffes. Parmi les attablés, le général Löwenhielm reconnaît des mets qu’il dégusta un jour au Café anglais et n’en croit pas ses yeux. Autour de lui, on ne dit mot mais, par la grâce des saveurs et de la Veuve Cliquot 1860 ou du Clos Vougeot 1845, les visages luthériens s’éclairent à une forme nouvelle de félicité. Babette a utilisé tous ses 10.000 francs mais son bonheur à elle, est complet et intense aussi !
Dans une belle séquence, Axel filme alternativement Babette dans sa cuisine, assurant avec maîtrise ses préparations et les austères convives découvrant, tour à tour des blinis Demidoff ou des cailles en sarcophage farcies de foie gras et sauce aux truffes. Parmi les attablés, le général Löwenhielm reconnaît des mets qu’il dégusta un jour au Café anglais et n’en croit pas ses yeux. Autour de lui, on ne dit mot mais, par la grâce des saveurs et de la Veuve Cliquot 1860 ou du Clos Vougeot 1845, les visages luthériens s’éclairent à une forme nouvelle de félicité. Babette a utilisé tous ses 10.000 francs mais son bonheur à elle, est complet et intense aussi !
EN QUATRIEME VITESSE.- Avec effroi, le monde a observé, à l’été 1945 du côté d’Hiroshima, les conséquences de la catastrophe nucléaire. Dans le cinéma, l’apocalypse nucléaire devient un thème répandu, de Docteur Folamour (1964) de Kubrick à Hiroshima mon amour (1959) de Resnais en passant par la saga Godzilla, le dinosaure réveillé par une explosion atomique dans le Pacifique… En 1955, Robert Aldrich adapte un roman de Mickey Spillane et embarque Mike Hammer, détective privé brutal et immoral dans un thriller transformé en cauchemar apocalyptique nucléaire (avec, en sous-texte, une condamnation du maccarthysme) et qui deviendra, par son âpre pessimisme, un tournant dans l’histoire du film noir.
 Parce qu’une femme qu’il a pris à bord de sa voiture, une nuit, sera torturée à mort par des malfrats, Hammer (Ralph Meeker) décide de mener l’enquête. Au cœur de toutes les convoitises, se trouve une caisse, contenant un métal radioactif, qui doit demeurer absolument close. Evidemment, ce ne sera pas le cas. La dernière séquence de Kiss Me Deadly est célèbre. Dans une villa sur la plage de Malibu, Lily Carver (Gaby Rogers) a retrouvé la caisse. Pour s’en emparer, elle tue un scientifique véreux et tire sur Mike Hammer. Blessé, celui-ci réussit à quitter les lieux non sans avoir libéré Velda, sa fidèle secrétaire, retenue prisonnière dans la villa. Lily Carver ouvre alors la boîte de Pandore. Une violente lumière apparaît. Bientôt des flammes enveloppent Lily… Sur la plage, Hammer et Velda s’éloignent rapidement tandis qu’un incendie embrase la villa avant une explosion comparable à celle d’une bombe A.
Parce qu’une femme qu’il a pris à bord de sa voiture, une nuit, sera torturée à mort par des malfrats, Hammer (Ralph Meeker) décide de mener l’enquête. Au cœur de toutes les convoitises, se trouve une caisse, contenant un métal radioactif, qui doit demeurer absolument close. Evidemment, ce ne sera pas le cas. La dernière séquence de Kiss Me Deadly est célèbre. Dans une villa sur la plage de Malibu, Lily Carver (Gaby Rogers) a retrouvé la caisse. Pour s’en emparer, elle tue un scientifique véreux et tire sur Mike Hammer. Blessé, celui-ci réussit à quitter les lieux non sans avoir libéré Velda, sa fidèle secrétaire, retenue prisonnière dans la villa. Lily Carver ouvre alors la boîte de Pandore. Une violente lumière apparaît. Bientôt des flammes enveloppent Lily… Sur la plage, Hammer et Velda s’éloignent rapidement tandis qu’un incendie embrase la villa avant une explosion comparable à celle d’une bombe A.
LE NOM DES GENS.- Le 7e art français propose parfois des figures de président de la République, ainsi Michel Bouquet incarnant François Mitterrand dans Le promeneur du Champ de Mars (2005) ou Denis Podalydès se glissant dans la peau de Sarkozy dans La conquête (2011). Lionel Jospin, lui, n’a jamais été président de la République et on se souvient du désespoir des socialistes au soir du premier tour de 2002 lorsque Chirac et Le Pen se retrouvèrent au second tour.
 Dans Le nom des gens que Michel Leclerc tourne en 2010, ce moment politique est bien présent. On voit le personnage d’Arthur Martin, jospiniste bon teint (Jacques Gamblin), se désoler devant le journal télé de 20h. Cette savoureuse comédie politique met en scène Bahia Benmahmoud (Sara Forestier) qui couche avec les hommes de droite pour les faire changer d’opinion. Un soir, Bahia est en compagnie d’Arthur lorsqu’on sonne à la porte. « Je t’ai fait un cadeau. Vas-y, ouvre ! » Plan sur le visage ahuri d’Arthur. Contre-champ sur Lionel Jospin, souriant : « Vous ne me faites pas entrer ? » La séquence dure à peine quelques minutes. Jospin découvre un canard mandarin dans une vitrine, s’assied pour boire un verre tandis qu’Arthur demande l’origine du nom Jospin. Mais aussi comment Bahia a réussi à convaincre Jospin de venir. L’œil malicieux, il évoque les « irrésistibles méthodes politiques » de Bahia mais, « étant de gauche, elle n’a pas eu à me séduire… » Bahia lui ayant parlé de son ami jospiniste, Jospin s’est décidé à lui rendre visite: « Je me suis dit, un jospiniste aujourd’hui, c’est aussi rare qu’un canard mandarin sur l’île de Ré » !
Dans Le nom des gens que Michel Leclerc tourne en 2010, ce moment politique est bien présent. On voit le personnage d’Arthur Martin, jospiniste bon teint (Jacques Gamblin), se désoler devant le journal télé de 20h. Cette savoureuse comédie politique met en scène Bahia Benmahmoud (Sara Forestier) qui couche avec les hommes de droite pour les faire changer d’opinion. Un soir, Bahia est en compagnie d’Arthur lorsqu’on sonne à la porte. « Je t’ai fait un cadeau. Vas-y, ouvre ! » Plan sur le visage ahuri d’Arthur. Contre-champ sur Lionel Jospin, souriant : « Vous ne me faites pas entrer ? » La séquence dure à peine quelques minutes. Jospin découvre un canard mandarin dans une vitrine, s’assied pour boire un verre tandis qu’Arthur demande l’origine du nom Jospin. Mais aussi comment Bahia a réussi à convaincre Jospin de venir. L’œil malicieux, il évoque les « irrésistibles méthodes politiques » de Bahia mais, « étant de gauche, elle n’a pas eu à me séduire… » Bahia lui ayant parlé de son ami jospiniste, Jospin s’est décidé à lui rendre visite: « Je me suis dit, un jospiniste aujourd’hui, c’est aussi rare qu’un canard mandarin sur l’île de Ré » !
LE CAVALIER ELECTRIQUE.- Héros américain par excellence, le cowboy est un personnage mythique du cinéma. Mais, en 1979, le temps du western classique est passé depuis belle lurette. Le cowboy de The Electric Horseman a beau avoir été cinq fois champion du monde de rodéo, il fait peine à voir… Pourtant, Sydney Pollack va faire de Sonny Steele un personnage foncièrement émouvant. Retraité du rodéo, Steele en est réduit à travailler pour Ranch Breakfast, une marque de céréales qui reproduit son image sur ses emballages. Noyant son mal-être dans l’alcool, Sonny arrive titubant là où il doit se produire dans un rutilant costume violet et vert orné de petites ampoules lumineuses clignotantes. Lors d’un show à Las Vegas, Sonny craque. Il n’en peut plus de cet univers artificiel et clinquant et il se dégoûte d’être devenu le jouet d’une compagnie capitaliste sans états d’âme.
 Dans ce film qui s’ouvre et se ferme sur les grands espaces du western, Robert Redford et Jane Fonda portent une aventure intime qui retrouve la veine élégiaque du Jeremiah Johnson (1972) de Pollack pour une réflexion nostalgique sur les derniers restes d’un Ouest finissant. La séquence où, monté sur le pur-sang Rising Star, Sonny, dans son dérisoire habit de lumière, quitte la scène du Caesar’s Palace, traverse les salles de jeux et s’éloigne, sur un Strip saturé de néons, est magnifique et pathétique. Pathétique parce qu’elle illustre la chanson Mamas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys que chante Willie Nelson et magnifique parce que Steele n’est plus une marionnette mais un homme à nouveau libre.
Dans ce film qui s’ouvre et se ferme sur les grands espaces du western, Robert Redford et Jane Fonda portent une aventure intime qui retrouve la veine élégiaque du Jeremiah Johnson (1972) de Pollack pour une réflexion nostalgique sur les derniers restes d’un Ouest finissant. La séquence où, monté sur le pur-sang Rising Star, Sonny, dans son dérisoire habit de lumière, quitte la scène du Caesar’s Palace, traverse les salles de jeux et s’éloigne, sur un Strip saturé de néons, est magnifique et pathétique. Pathétique parce qu’elle illustre la chanson Mamas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys que chante Willie Nelson et magnifique parce que Steele n’est plus une marionnette mais un homme à nouveau libre.
BANCS PUBLICS.- Rares sont, dans le cinéma français, les cinéastes qui pratiquent avec autant de bonheur que Bruno Podalydès, une forme d’absurde poétique ou de délire burlesque qui fait la part belle aux mots et aux objets… On peut notamment le constater dans ce film tourné en 2007 et sorti en 2009 dans lequel le cinéaste s’amuse avant de divertir le spectateur. En appelant à la rescousse le gratin des comédiens français – dans de petits ou de grands rôles- Bruno Podalydès dépeint une galerie de personnages vivant ou travaillant à Versailles (le titre complet ajoute Versailles Rive-Droite à Bancs publics), entre l’immeuble de bureaux avec ses employés, le square du quartier avec ses habitués ou le magasin de bricolage avec ses vendeurs et ses clients.
 Si cette comédie humaine foutraque écrite sous la forme de sketches est forcément inégale, la séquence dans le magasin de bricolage Gifarep est un pur bonheur digne des grandes heures de Jacques Tati. Une dame (Catherine Deneuve, savoureuse) arrive avec, dans les bras, une petite armoire en train de rendre l’âme. Autour du chef de rayon (Bruno Podalydès), deux puis trois employés en blouse « à nuages » s’activent dans un… massage cardiaque vain. Une cloison craque et on emporte, sur un chariot, façon Urgences, l’armoire sous le regard éploré de la cliente. Après lui avoir vanté les mérites de la colle Cyanochiolate, le chef de rayon entraine la cliente vers un espace Environnement « très sympa » pour lui proposer une tisane déstressante tandis qu’ils se lancent dans une évocation nostalgique des outils et des objets…
Si cette comédie humaine foutraque écrite sous la forme de sketches est forcément inégale, la séquence dans le magasin de bricolage Gifarep est un pur bonheur digne des grandes heures de Jacques Tati. Une dame (Catherine Deneuve, savoureuse) arrive avec, dans les bras, une petite armoire en train de rendre l’âme. Autour du chef de rayon (Bruno Podalydès), deux puis trois employés en blouse « à nuages » s’activent dans un… massage cardiaque vain. Une cloison craque et on emporte, sur un chariot, façon Urgences, l’armoire sous le regard éploré de la cliente. Après lui avoir vanté les mérites de la colle Cyanochiolate, le chef de rayon entraine la cliente vers un espace Environnement « très sympa » pour lui proposer une tisane déstressante tandis qu’ils se lancent dans une évocation nostalgique des outils et des objets…
GARE CENTRALE.- Lorsqu’en 1957, Youssef Chahine s’attelle à Gare centrale, il n’est plus tout à fait un débutant. Celui qui va devenir, au fil du temps, le plus grand cinéaste égyptien, a déjà dix films à son actif dont Le démon du désert (1954) qui lance la carrière d’un certain Omar Sharif… Mais, avec Bab al-Hadid, Chahine passe pour la première fois devant la caméra. Il incarne Kenaoui, mendiant analphabète et obsédé sexuel, qui parcourt dans tous les sens la gare du Caire. Avec ce personnage, le cinéaste (qui jouera dans six films) tient le rôle le plus beau et le plus puissant de sa carrière… Dans le foisonnement permanent de cette gare cairote, Kenaoui, désespérément fou amoureux de la belle Hanouma (Hind Rostom, la Marilyn Monroe égyptienne), apparaît peu à peu comme un bouffon tragique, intime des plus grandes misères humaines…
 L’odyssée tragique de l’émouvant Kenaoui culmine dans une sublime et ultime séquence où Chahine semble transformer la gare en plateau de cinéma. Le visage à moitié noirci par de la graisse –métaphore du Bien et du Mal- Kenaoui tient Hanouma sous le menace d’un grand couteau. Les deux sont allongés sur les rails tandis qu’autour d’eux la foule se presse. Tandis qu’Abou Serib réussit à désarmer Kenaoui en tenant à pleine main la lame (symbole sexuel… inoffensif) sans se couper, le vieux Madbouli raisonne doucement le malheureux et l’amène à enfiler une galabeya immaculée, vêtement de fête pour son mariage avec Hanouma… Lorsque Kenaoui comprend qu’il s’agit d’une camisole de force, il est trop tard…
L’odyssée tragique de l’émouvant Kenaoui culmine dans une sublime et ultime séquence où Chahine semble transformer la gare en plateau de cinéma. Le visage à moitié noirci par de la graisse –métaphore du Bien et du Mal- Kenaoui tient Hanouma sous le menace d’un grand couteau. Les deux sont allongés sur les rails tandis qu’autour d’eux la foule se presse. Tandis qu’Abou Serib réussit à désarmer Kenaoui en tenant à pleine main la lame (symbole sexuel… inoffensif) sans se couper, le vieux Madbouli raisonne doucement le malheureux et l’amène à enfiler une galabeya immaculée, vêtement de fête pour son mariage avec Hanouma… Lorsque Kenaoui comprend qu’il s’agit d’une camisole de force, il est trop tard…
MAMMA ROMA.- « Ma seule idole est la réalité. Si j’ai choisi d’être cinéaste (…), c’est que plutôt que d’exprimer cette réalité par des symboles que sont les mots, j’ai préféré le moyen d’expression qu’est le cinéma, exprimer la réalité par la réalité. » En 1962, dans les décors de la Ville éternelle, Pier-Paolo Pasolini tourne son second film après Accatone, l’année précédente. Il évoque l’histoire de Mamma Roma, prostituée romaine de la quarantaine (Anna Magnani), qui pense enfin être libérée de son souteneur. Elle décide de refaire sa vie, reprend avec elle Ettore, son fils de 16 ans, qui ignore tout de son passé. Ils s’installent dans une cité nouvelle près de Rome. Mamma Roma travaille désormais sur un marché, pleine d’espoir dans une vie nouvelle. Ettore, lui, traîne avec des adolescents désoeuvrés…
 Si PPP reprend, ici, les thèmes du néoréalisme (errance, terrains vagues, sort des prolétaires), son travail a toujours une origine picturale. C’est notamment le cas dans les plans où Ettore, après un larcin, est enfermé en prison. Comme son état physique et mental se dégrade, on l’attache sur un lit de contention. Dans une succession de travellings arrière, réalisés à la grue, alternant avec des gros plans du visage suant d’Ettore (Ettore Garofalo), PPP filme son agonie. Le dernier travelling arrière sur Ettore mort, par la position même du corps et la tête de côté, est une référence directe au tableau d’Andrea Mantegna La lamentation sur le Christ mort… Le dernier cri de l’adolescent appelant sa mère a de fait valeur christique…
Si PPP reprend, ici, les thèmes du néoréalisme (errance, terrains vagues, sort des prolétaires), son travail a toujours une origine picturale. C’est notamment le cas dans les plans où Ettore, après un larcin, est enfermé en prison. Comme son état physique et mental se dégrade, on l’attache sur un lit de contention. Dans une succession de travellings arrière, réalisés à la grue, alternant avec des gros plans du visage suant d’Ettore (Ettore Garofalo), PPP filme son agonie. Le dernier travelling arrière sur Ettore mort, par la position même du corps et la tête de côté, est une référence directe au tableau d’Andrea Mantegna La lamentation sur le Christ mort… Le dernier cri de l’adolescent appelant sa mère a de fait valeur christique…
UN SINGE EN HIVER.- Un film comme un passage de relais ? Pendant l’hiver 1961-1962, sur la côte normande, notamment à Villerville (qui apparaît, dans le film, sous le nom de Tigreville), Henri Verneuil tourne ce qui sera l’un de ses grands succès. C’est aussi la seule et unique rencontre sur un écran entre Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Gueule d’amour est dans la dernière partie de sa carrière et Bebel est l’acteur vedette de la Nouvelle vague. De là à parler de passation de pouvoir, il n’y a qu’un pas que les chroniqueurs franchissent volontiers. Dans une vidéo disponible sur le site de l’INA, l’interprète de Pierrot le fou évoque le modèle de Gabin : « Savoir si je suis le Gabin jeune ? Je préfère être Belmondo » dit-il dans un sourire.
 Sur une adaptation du roman éponyme d’Antoine Blondin et sur des dialogues enlevés de Michel Audiard, Un singe en hiver met en scène Albert Quentin, ancien fusilier marin en Chine et grand buveur, qui a tiré un trait sur son passé pour jouer les hôteliers. Un soir, débarque Gabriel Fouquet, jeune type qui boit pour oublier l’échec de sa vie sentimentale. Fouquet est passionné de tauromachie et Verneuil le gratifie de deux séquences brillantes. Dans la première, bien ivre, il accomplit furieusement, dans sa chambre, des passes avec un couvre-lit pour muleta. Albert observe la scène en silence avant de dire qu’il aime, chez Gabriel, sa façon de voyager et de rêver. Plus loin, ce sont des voitures qui passent sur la grand’route qui jouent pour Fouquet les taureaux déroutés mais lancés à vive allure…
Sur une adaptation du roman éponyme d’Antoine Blondin et sur des dialogues enlevés de Michel Audiard, Un singe en hiver met en scène Albert Quentin, ancien fusilier marin en Chine et grand buveur, qui a tiré un trait sur son passé pour jouer les hôteliers. Un soir, débarque Gabriel Fouquet, jeune type qui boit pour oublier l’échec de sa vie sentimentale. Fouquet est passionné de tauromachie et Verneuil le gratifie de deux séquences brillantes. Dans la première, bien ivre, il accomplit furieusement, dans sa chambre, des passes avec un couvre-lit pour muleta. Albert observe la scène en silence avant de dire qu’il aime, chez Gabriel, sa façon de voyager et de rêver. Plus loin, ce sont des voitures qui passent sur la grand’route qui jouent pour Fouquet les taureaux déroutés mais lancés à vive allure…
NEW YORK – MIAMI.- Quand la morosité vous gagne, rien ne vaut la fréquentation des films de Frank Capra. A cet égard, New York Miami est un pur régal. Sorti en 1934, It Happened One Night est l’archétype de la pure comédie brillamment rythmée dans laquelle un homme et une femme s’opposent pendant la majeure partie du film avant de tomber dans les bras l’un de l’autre. Rien de bien original sinon que nous avons là deux beaux personnages avec, d’une part, Ellie Andrews, jeune femme gâtée et parfois odieuse, de l’autre Peter Warne, journaliste au chômage et type content de lui et plutôt mufle. Si le film est une réussite, les choses ne furent pas faciles pour le cinéaste avec un Clark Gable, furieux d’avoir été puni par la MGM en étant prêté à la Columbia et une Claudette Colbert alignant les caprices… Mais on se souvient surtout du brio avec lequel Capra aligne les séquences d’anthologie comme celle de l’auto-stop.
 Ellie et Peter sont en rade sur une route de campagne. Le journaliste explique comme arrêter une voiture. « Tout est dans le pouce ». Et de détailler trois méthodes lorsqu’Ellie s’écrie : « Voilà une voiture ! ». Au bord de la chaussée, Peter se propose d’utiliser la méthode n°1. Sans succès. Avant de faire n’importe quoi tandis que les voitures défilent à vive allure. Ellie : « Je peux essayer ? J’arrêterai une voiture sans utiliser mon pouce ! » Peter ricane. Au bord de la route, Ellie relève sa jupe et dévoile largement une cuisse galbée et le haut de son bas. Crissement de pneus et très gros plan sur une main qui tire violemment le frein à main d’une auto.
Ellie et Peter sont en rade sur une route de campagne. Le journaliste explique comme arrêter une voiture. « Tout est dans le pouce ». Et de détailler trois méthodes lorsqu’Ellie s’écrie : « Voilà une voiture ! ». Au bord de la chaussée, Peter se propose d’utiliser la méthode n°1. Sans succès. Avant de faire n’importe quoi tandis que les voitures défilent à vive allure. Ellie : « Je peux essayer ? J’arrêterai une voiture sans utiliser mon pouce ! » Peter ricane. Au bord de la route, Ellie relève sa jupe et dévoile largement une cuisse galbée et le haut de son bas. Crissement de pneus et très gros plan sur une main qui tire violemment le frein à main d’une auto.
L’ARMEE DES OMBRES.- De La bataille du rail (1946) à Lucie Aubrac (1997) en passant par La grande vadrouille (1966) ou Lacombe Lucien (1974), le cinéma français s’est régulièrement penché sur la Résistance. Ancien résistant lui-même, Jean-Pierre Melville a apporté sa pierre à l’édifice avec pas moins de trois films : Le silence de la mer (1947), Léon Morin, prêtre (1961) et L’armée des ombres (1969) qu’il met en scène à la fin de sa carrière après avoir porté le projet durant 25 ans… Hommage tragique, le film ne met pas en avant l’aspect héroïque de la Résistance mais plutôt la réalité quotidienne d’hommes et de femmes ordinaires qui risquent leur vie en distribuant des tracts, en transportant du matériel, en cachant des hommes recherchés par la Gestapo…
 Ce qui frappe dans cette histoire des activités puis du démantèlement d’un réseau dans la France occupée de 1942, c’est, au-delà des problèmes de conscience des uns des autres, l’épure de la mise en scène, la stylisation et le choix des couleurs froides. Le trait est net mais le sens peut être en suspens, ainsi dans le regard stupéfait et perplexe de Simone Signoret dans la séquence de la mort de Mathilde. En 18 plans, Melville filme la voiture qui tourne le coin d’une rue de Lyon, successivement les quatre occupants à bord, Mathilde marchant sur le trottoir puis s’arrêtant en ayant vu la voiture, une main tenant une arme qui avance, le regard de Mathilde, le tir, Mathilde qui tombe à terre, Jardie, le chef du réseau (Paul Meurisse) qui dit simplement : « Vite ! », enfin un long travelling rapide qui s’éloigne du corps de Mathilde…
Ce qui frappe dans cette histoire des activités puis du démantèlement d’un réseau dans la France occupée de 1942, c’est, au-delà des problèmes de conscience des uns des autres, l’épure de la mise en scène, la stylisation et le choix des couleurs froides. Le trait est net mais le sens peut être en suspens, ainsi dans le regard stupéfait et perplexe de Simone Signoret dans la séquence de la mort de Mathilde. En 18 plans, Melville filme la voiture qui tourne le coin d’une rue de Lyon, successivement les quatre occupants à bord, Mathilde marchant sur le trottoir puis s’arrêtant en ayant vu la voiture, une main tenant une arme qui avance, le regard de Mathilde, le tir, Mathilde qui tombe à terre, Jardie, le chef du réseau (Paul Meurisse) qui dit simplement : « Vite ! », enfin un long travelling rapide qui s’éloigne du corps de Mathilde…
VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU.- Lorsqu’en 1968, Milos Forman est contraint d’émigrer aux Etats-Unis à cause de la répression du Printemps de Prague, il est déjà un cinéaste reconnu grâce à ses trois satires sociales (L’as de pique, Les amours d’une blonde et Au feu les pompiers !) dont les autorités soviétiques diront qu’elles sont le symptôme de « la dégénérescence du système socialiste qui sévit en Tchécoslovaquie », obligeant à l’intervention militaire dans le pays. Installé aux USA (dont il prendra la nationalité en 1977), Forman vit d’abord une rude galère. Taking Off, son premier film en 1971, est un gros échec commercial qui le ruine. Il attendra plusieurs années avant de retourner derrière la caméra. Cette fois, le succès est au rendez-vous. Adapté du roman éponyme de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo’s Nest va rafler, en 1976, les cinq Oscars majeurs dont celui de meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario.
 Accusé de viol sur mineure, McMurphy, pour échapper à la prison, se fait interner dans un hôpital psychiatrique. En attendant qu’on évalue sa santé mentale, il assiste aux « thérapies » de Miss Ratched (Louise Fletcher, oscarisée pour le rôle). Rapidement, le rebelle désinvolte va se heurter à l’inflexible et cynique infirmière et remettre en cause ses méthodes répressives. D’abord dans le jeu, McMurphy (Jack Nicholson, également oscarisé) va entrer dans un vrai combat. Il culminera, après le suicide du fragile Billy, dans une agression où McMurphy étrangle Miss Ratched, soldant un affrontement aussi émouvant que perdu d’avance.
Accusé de viol sur mineure, McMurphy, pour échapper à la prison, se fait interner dans un hôpital psychiatrique. En attendant qu’on évalue sa santé mentale, il assiste aux « thérapies » de Miss Ratched (Louise Fletcher, oscarisée pour le rôle). Rapidement, le rebelle désinvolte va se heurter à l’inflexible et cynique infirmière et remettre en cause ses méthodes répressives. D’abord dans le jeu, McMurphy (Jack Nicholson, également oscarisé) va entrer dans un vrai combat. Il culminera, après le suicide du fragile Billy, dans une agression où McMurphy étrangle Miss Ratched, soldant un affrontement aussi émouvant que perdu d’avance.
LA GRAINE ET LE MULET.- Remarqué dès son premier long-métrage (La faute à Voltaire en 2000), Abdellatif Kechiche connaîtra la reconnaissance critique et publique avec L’esquive (2004) et surtout La graine et le mulet (2007), les Cahiers du cinéma n’hésitant pas à voir dans le film, la jonction entre les cinéma d’auteur et populaire, laissé vacant par Maurice Pialat. Ouvrier sur un chantier naval de Sète, Slimane Beijii, 61 ans, se retrouve au chômage. Père de famille divorcée, il vit avec la patronne d’un petit hôtel et sa fille Rym tout en restant très lié à ses enfants et à son ex-épouse. Avec son indemnité de licenciement, il envisage d’ouvrir un restaurant spécialisé dans le couscous de poisson (la graine et le mulet du titre) sur un vieux bateau amarré dans le port…
 La dernière séquence du film a largement marqué les esprits à la fois par sa durée (10 minutes) et par sa dimension dramatique. Sur le bateau, les convives sont venus nombreux mais le couscous n’est pas arrivé. Slimane s’est fait voler son cyclo et jusqu’à l’épuisement, il tente de rattraper les jeunes voleurs. Pour faire patienter la salle, Rym (Hafsia Herzi) entame, en compagnie d’un orchestre oriental, une danse du ventre qui prend vite la tournure d’une transe. En intercalant des plans sur la salle et la course de Slimane, le cinéaste filme, souvent en très gros plan, le ventre rond de Rym, ses déhanchements, ses vibrations chaloupées, ses rapides coups de hanche, ses mains dans sa crinière noire… Les yeux clos, le visage ruisselant, le corps en sueur, Hafsia Herzi réussit une singulière performance érotique…
La dernière séquence du film a largement marqué les esprits à la fois par sa durée (10 minutes) et par sa dimension dramatique. Sur le bateau, les convives sont venus nombreux mais le couscous n’est pas arrivé. Slimane s’est fait voler son cyclo et jusqu’à l’épuisement, il tente de rattraper les jeunes voleurs. Pour faire patienter la salle, Rym (Hafsia Herzi) entame, en compagnie d’un orchestre oriental, une danse du ventre qui prend vite la tournure d’une transe. En intercalant des plans sur la salle et la course de Slimane, le cinéaste filme, souvent en très gros plan, le ventre rond de Rym, ses déhanchements, ses vibrations chaloupées, ses rapides coups de hanche, ses mains dans sa crinière noire… Les yeux clos, le visage ruisselant, le corps en sueur, Hafsia Herzi réussit une singulière performance érotique…
THELMA ET LOUISE.- Comment un film a failli ne jamais voir le jour (à cause de la méfiance des producteurs) et comment il finit par devenir une œuvre culte du féminisme… En 1991, Ridley Scott va mettre en scène l’histoire de deux femmes, Thelma Dickinson (Geena Davis) et Louise Sawyer (Susan Sarandon) qui décident de s’offrir un week-end à la montagne. Sur le parking d’un bar, Thelma est sur le point de se faire violer. Louise survient in extremis, sort une arme et empêche le viol. Devant la vulgarité et l’agressivité du type, Louise l’abat. Elle refuse de se rendre à la police. Commence alors une grande cavale…
À sa sortie aux USA, Thelma and Louise a suscité la polémique parce qu’il mettait en scène deux héroïnes répondant par les armes à la violence masculine. Ce road-movie tragique est devenu un classique, notamment à cause d’une séquence finale d’anthologie.
 Au volant de sa Thunderbird 1966 verte, Louise a réussi à provisoirement semer la police avant de l’arrêter au bord du Grand Canyon. Un hélicoptère surgit devant elles tandis que derrière elles, les forces de l’ordre leur bloquent la retraite. L’inspecteur Hal Slocombe (Harvey Keitel) tente de ramener les deux femmes à la raison. Dans la voiture, Louise et Thelma décident de ne pas se rendre et de partir droit devant. Elles s’embrassent brièvement sur la bouche, échangent un sourire, se donnent la main. Louise appuie sur l’accélérateur. La Thunderbird fonce vers le canyon. En contre-plongée et au ralenti, elle « plane » dans le ciel. Arrêt sur image sur la voiture au centre de l’écran. Fondu au blanc et générique de fin.
Au volant de sa Thunderbird 1966 verte, Louise a réussi à provisoirement semer la police avant de l’arrêter au bord du Grand Canyon. Un hélicoptère surgit devant elles tandis que derrière elles, les forces de l’ordre leur bloquent la retraite. L’inspecteur Hal Slocombe (Harvey Keitel) tente de ramener les deux femmes à la raison. Dans la voiture, Louise et Thelma décident de ne pas se rendre et de partir droit devant. Elles s’embrassent brièvement sur la bouche, échangent un sourire, se donnent la main. Louise appuie sur l’accélérateur. La Thunderbird fonce vers le canyon. En contre-plongée et au ralenti, elle « plane » dans le ciel. Arrêt sur image sur la voiture au centre de l’écran. Fondu au blanc et générique de fin.
IL DIVO.- « A part les guerres puniques, j’ai été accusé de tout ce qui s’est passé en Italie ». En 2008, Paolo Sorrentino consacre une charge assassine à Giulio Andreotti, figure emblématique de la Démocratie chrétienne. Celui qui fut surnommé Le divin Giulio, la salamandre, Moloch, le pape noir ou encore Belzébuth, est au cœur d’un pamphlet politique où le cinéaste napolitain ausculte l’exercice du pouvoir à travers un personnage qui fut, à sept reprises, entre 1972 et 1992, président du Conseil italien. C’est Toni Servillo, complice au long cours de Sorrentino qui se glisse, après maquillage, dans le personnage ambigu et invulnérable d’Andreotti qui affirmait posséder le sens de l’humour autant que des… archives : « Chaque fois que je parle de ces archives, ceux qui doivent se taire, comme par enchantement, se taisent ».
 Prix du jury au festival de Cannes 2008, Il Divo est un regard sans fard sur 50 années d’histoire de l’Italie et une métaphore sur le pouvoir conçue comme un ballet stylisé. C’est le cas dans le rituel quotidien qu’est la promenade nocturne d’Andreotti. Dans la Via del Corso à Rome, aux accents de la Pavane pour une infante défunte de Gabriel Fauré, trois voitures noires avancent au pas. De multiples policiers armés marchent en scrutant les toits. Le long d’un mur, une silhouette noire et rigide, les mains dans le dos, se glisse, telle un Nosferatu, dans l’aube. Soudain, Andreotti se fige, sans une expression, devant un grand graffiti « Massacres et complots sont signés Craxi et Andreotti ». Puis l’homme reprend sa marche vers une église où l’attend son confesseur…
Prix du jury au festival de Cannes 2008, Il Divo est un regard sans fard sur 50 années d’histoire de l’Italie et une métaphore sur le pouvoir conçue comme un ballet stylisé. C’est le cas dans le rituel quotidien qu’est la promenade nocturne d’Andreotti. Dans la Via del Corso à Rome, aux accents de la Pavane pour une infante défunte de Gabriel Fauré, trois voitures noires avancent au pas. De multiples policiers armés marchent en scrutant les toits. Le long d’un mur, une silhouette noire et rigide, les mains dans le dos, se glisse, telle un Nosferatu, dans l’aube. Soudain, Andreotti se fige, sans une expression, devant un grand graffiti « Massacres et complots sont signés Craxi et Andreotti ». Puis l’homme reprend sa marche vers une église où l’attend son confesseur…
TU NE TUERAS POINT.- Comme l’amour, la mort au cinéma est omniprésente. Parce qu’il fixe le temps, le 7e art capte le passage de la vie à la mort. André Bazin observait que « la mort est un des rares événements qui justifie le terme de spécificité cinématographique ». On songe à tous ces westerners abattus en pleine course et arrachés à leurs chevaux, à tous ces malfrats flingués de nuit, sur des pavés humides. Le cinéma fait le grand écart entre Viggo Mortensen massacrant ses agresseurs dans le restaurant de A History of Violence de Cronenberg et Hitchcock se contentant, dans Frenzy (voir plus bas) de filmer la façade derrière laquelle se déroule le crime.
En 1988, Krzysztof Kieslowski donne Krotki film o zabijaniu, adaptation (plus longue de 36 minutes) pour le cinéma du volume 5 de son Décalogue. Jacek Lazar, 21, ans erre dans une Varsovie hivernale. Il va croiser le chemin de Waldemar Rekowski, chauffeur de taxi quadragénaire peu sympathique. Dans un coin isolé, au bord d’un fleuve, Jacek assassine sauvagement le taxi. Condamné à mort, Jacek sera pendu.
 La dernière séquence montre, dans une lumière glauque jaune et verte, une exécution capitale dont la violence renvoie à celle du meurtre commis par Jacek. Son avocat affirme d’ailleurs que « le châtiment n’est qu’une vengeance ». Kieslowski filme d’ailleurs des détails morbides généralement occultés. Présenté en compétition officielle à Cannes (où il remporta le Grand prix du jury), le film a laissé, pendant un long moment après la fin de la projection, les festivaliers muets et tétanisés.
La dernière séquence montre, dans une lumière glauque jaune et verte, une exécution capitale dont la violence renvoie à celle du meurtre commis par Jacek. Son avocat affirme d’ailleurs que « le châtiment n’est qu’une vengeance ». Kieslowski filme d’ailleurs des détails morbides généralement occultés. Présenté en compétition officielle à Cannes (où il remporta le Grand prix du jury), le film a laissé, pendant un long moment après la fin de la projection, les festivaliers muets et tétanisés.
LORD OF WAR.- Venu de la publicité, le Néo-zélandais Andrew Niccol est revélé, en 1997, par l’excellent Bienvenue à Gattaca, un film de SF élégant et très maîtrisé. En 2005, il s’attaque à la vente d’armes à travers le monde… Né en Ukraine soviétique, Yuri Olov a émigré aux USA avec sa famille en se faisant passer pour des Juifs persécutés. Fin négociateur, il se fait une place dans le trafic d’armes. Parallèlement à une vie de mari et de père idéal, Orlov (Nicolas Cage) devient l’un des plus gros vendeurs d’armes clandestins du monde…
 La spectaculaire séquence d’ouverture a marqué les esprits. La caméra avance en travelling, au ras du sol, sur un tapis de balles et s’arrête sur Orlov, de dos. Celui-ci se tourne et s’adresse à la caméra : « On estime à environ 550 millions le nombre d’armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur douze qui est armé sur cette planète. La seule question c’est, comment armer les onze autres ? » Tandis que le générique (réalisé entre images réelles et effets numériques par le studio français E.S.T) se déroule, on suit le parcours d’une balle depuis la plaque de métal usinée dans un complexe industriel jusqu’à la mise en caissettes de bois des projectiles. Sur l’entraînante chanson For What It’s Worth de Buffalo Springfield, on suit la livraison des balles dans un pays en guerre. Le générique s’achève en « bullet-cam » autrement dit avec une image filmée du point de vue de la balle qui, depuis l’intérieur du canon, file, rectiligne, pour s’approcher du front d’un enfant. Fondu brutal au noir.
La spectaculaire séquence d’ouverture a marqué les esprits. La caméra avance en travelling, au ras du sol, sur un tapis de balles et s’arrête sur Orlov, de dos. Celui-ci se tourne et s’adresse à la caméra : « On estime à environ 550 millions le nombre d’armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur douze qui est armé sur cette planète. La seule question c’est, comment armer les onze autres ? » Tandis que le générique (réalisé entre images réelles et effets numériques par le studio français E.S.T) se déroule, on suit le parcours d’une balle depuis la plaque de métal usinée dans un complexe industriel jusqu’à la mise en caissettes de bois des projectiles. Sur l’entraînante chanson For What It’s Worth de Buffalo Springfield, on suit la livraison des balles dans un pays en guerre. Le générique s’achève en « bullet-cam » autrement dit avec une image filmée du point de vue de la balle qui, depuis l’intérieur du canon, file, rectiligne, pour s’approcher du front d’un enfant. Fondu brutal au noir.
RECHERCHE SUSAN DESESPEREMENT.- Pour être honnête, Louise Ciccone, plus connue sous le nom de Madonna, n’est pas la comédienne la plus fameuse que le 7e art a pu mettre à l’image… D’ailleurs, Madonna est la personnalité la plus récompensée de l’histoire des Razzie Awards, cérémonie américaine primant annuellement « le pire du cinéma ». Cela dit, ce n’est pas sur le grand écran que la Queen of Pop a fait le meilleur de sa carrière. Cependant, en 1985, on la remarque dans une agréable comédie où elle partage le haut de l’affiche avec Rosanna Arquette et Aidan Quinn. La réalisatrice Susan Seidelman y met en scène l’histoire de Roberta (Rosanna Arquette), jeune bourgeoise un peu coincée du New Jersey, qui s’ennuie ferme dans sa luxueuse maison. Quand elle découvre dans les petites annonces le sibyllin « Desperately Seeking Susan », elle décide d’enquêter pour découvrir qui est cette fameuse Susan. Surtout, elle va se métamorphoser in fine en s’appropriant son style.
 Alors au sommet de sa gloire, la chanteuse s’amuse clairement avec cette Susan qui va très rapidement devenir l’incarnation de la bad girl dans la culture populaire. Madonna compose son look en laissant Santo Loquasto, le designer et costumier du film, puiser dans son propre dressing. Et lance ainsi la mode avec mitaines, crucifix, tenue léopard et bijoux clinquants sans oublier un blazer mordoré à revers tigré… La scène la plus iconique se passe dans des toilettes publiques. En débardeur rose sur un soutien-gorge noir apparent, Susan lève nonchalamment les bras et passe ses aisselles au-dessus d’’un sèche-mains…
Alors au sommet de sa gloire, la chanteuse s’amuse clairement avec cette Susan qui va très rapidement devenir l’incarnation de la bad girl dans la culture populaire. Madonna compose son look en laissant Santo Loquasto, le designer et costumier du film, puiser dans son propre dressing. Et lance ainsi la mode avec mitaines, crucifix, tenue léopard et bijoux clinquants sans oublier un blazer mordoré à revers tigré… La scène la plus iconique se passe dans des toilettes publiques. En débardeur rose sur un soutien-gorge noir apparent, Susan lève nonchalamment les bras et passe ses aisselles au-dessus d’’un sèche-mains…
LA FIANCEE DU PIRATE.- Née à Buenos Aires dans une famille d’origine juive russe d’Odessa et Kiev, Nelly Kaplan (1931-2020) met, en 1969, un grand coup de pied dans la comédie française… Amie d’André Breton et d’Abel Gance, elle réalise son premier long-métrage avec La fiancée du pirate dont elle dit que c’est « l’histoire d’une sorcière des temps modernes qui n’est pas brûlée par les inquisiteurs, car c’est elle qui les brûle. » Marie est arrivée avec sa mère dans le village de Tellier. Lorsque la mère est écrasée par un chauffard et que les notables décident que la mort est « naturelle », Marie décide de se venger.
Actrice fétiche de la Nouvelle Vague, Bernadette Lafont se glisse avec délices dans cette pochade outrancière qui prend un tour érotique puisque les mâles alentour (mais aussi la riche propriétaire terrienne) ne peuvent s’empêcher de céder aux charmes de Marie.
 Pamphlet contre la France profonde où une prolétaire sauvage lutte contre la bêtise crasse, cette fable grinçante et grotesque (qui échappa de peu à la censure) décrit une femme qui accomplit son émancipation par une prostitution non subie.
Pamphlet contre la France profonde où une prolétaire sauvage lutte contre la bêtise crasse, cette fable grinçante et grotesque (qui échappa de peu à la censure) décrit une femme qui accomplit son émancipation par une prostitution non subie.
A l’écart du village, Marie vit dans un misérable gourbi en lisière de forêt où elle amasse, aux dépens de ceux qui l’oppriment, une petite fortune pour s’offrir des objets modernes et frivoles. Sorte de temple de l’art brut où une chauve-souris empaillée voisine des montres, des saucisses ou des reproductions d’art, ce cabinet des curiosités partira en fumée lorsque Marie, sa vengeance accomplie, décidera, pieds nus et l’âme en paix, de s’éloigner de ce coin de France rancie…
LA NUIT DU CHASSEUR.- Immense comédien britannique, Charles Laughton (1899-1962) a marqué de son talent (et aussi de son apparence physique) des œuvres comme La vie privée d’Henry VIII (1933), Les révoltés du Bounty (1935) ou encore Témoin à charge (1957)… Laughton est entré dans la légende du 7e art en 1955 avec le seul film qu’il a réalisé entièrement (en 1949, il a tourné des plans de L’homme de la tour Eiffel) où il raconte le parcours criminel du révérend Harry Powell, faux prédicateur et vrai tueur en série. Powell débarque en Virginie-Occidentale pour retrouver l’épouse et les deux jeunes enfants de Ben Harper, un condamné à mort avec lequel il a partagé une cellule de prison… Powell sait que Harper a conservé une grosse somme d’argent et il est prêt pour la récupérer à séduire la jeune veuve (Shelley Winters) et ses petits John et Pearl.
 Lors de la première rencontre, dans la boutique du glacier Spoon, entre Powell (Robert Mitchum dans l’un de ses grands rôles) et la famille Harper, John observe fixement le prédicateur qui porte, sur les phalanges, LOVE (amour) et HATE (haine). Au gamin, Powell lance : « Veux-tu que je te raconte l’histoire de la droite et de la gauche ? Du bien et du mal ? » Entremêlant ses doigts, Powell, entre dans une transe inquiétante : « Ces doigts sont toujours en lutte… » Et de mimer la haine écrasant l’amour. « Mais la chaleur de l’amour vaincra ! » En extase devant les Harper et les Spoon, il termine : « Oui, Seigneur, c’est l’amour qui l’emporte ! » Une terrifiante mécanique criminelle se met alors en marche.
Lors de la première rencontre, dans la boutique du glacier Spoon, entre Powell (Robert Mitchum dans l’un de ses grands rôles) et la famille Harper, John observe fixement le prédicateur qui porte, sur les phalanges, LOVE (amour) et HATE (haine). Au gamin, Powell lance : « Veux-tu que je te raconte l’histoire de la droite et de la gauche ? Du bien et du mal ? » Entremêlant ses doigts, Powell, entre dans une transe inquiétante : « Ces doigts sont toujours en lutte… » Et de mimer la haine écrasant l’amour. « Mais la chaleur de l’amour vaincra ! » En extase devant les Harper et les Spoon, il termine : « Oui, Seigneur, c’est l’amour qui l’emporte ! » Une terrifiante mécanique criminelle se met alors en marche.
NOUS IRONS TOUS AU PARADIS.- Typographe puis pâtissier, Yves Robert se découvre une passion pour le théâtre puis pour le cinéma où il intervient d’abord comme acteur avant de passer à la réalisation. Dans les années 60-70, Yves Robert (1920-2002) va s’imposer comme un spécialiste de la comédie française. Il signe ainsi La guerre des boutons (1961), Alexandre le bienheureux (1967) avant d’atteindre les hauteurs du box-office en 1976 et 77 avec, successivement, Un éléphant, ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis.
 Pour le scénariste Jean-Loup Dabadie, il s’agit de la « chronique très agitée des démêlés de certains hommes avec certaines femmes qui ne sont pas nécessairement les leurs ». Le film raconte l’amitié de quatre quadragénaires, tous confrontés à une situation difficile dans leur vie privée. Le quatuor est composé de Jean Rochefort, Claude Brasseur, Victor Lanoux et Guy Bedos. Ce dernier incarne Simon Messina, médecin étouffé par sa mère juive d’Algérie. Pour le rôle de Mouchy, cette génitrice très possessive, le cinéaste a choisi Marthe Villalonga qui va devenir la tonique spécialiste française de la mère juive au grand écran. La séquence où Mouchy débarque, en manteau de fourrure, sur le court de tennis où Simon joue en double, est excellente. Simon reproche à sa mère de le déranger. Mouchy : « S’il faut payer pour te voir, dis-le ! » Simon hurle : « Arrête ! Arrête ! Mais qu’est-ce que j’ai fait… » Le plus savoureux, c’est que Marthe Villalonga, également mère juive dans Le coup de sirocco (1979), a confié qu’elle était « ni mère, ni juive »…
Pour le scénariste Jean-Loup Dabadie, il s’agit de la « chronique très agitée des démêlés de certains hommes avec certaines femmes qui ne sont pas nécessairement les leurs ». Le film raconte l’amitié de quatre quadragénaires, tous confrontés à une situation difficile dans leur vie privée. Le quatuor est composé de Jean Rochefort, Claude Brasseur, Victor Lanoux et Guy Bedos. Ce dernier incarne Simon Messina, médecin étouffé par sa mère juive d’Algérie. Pour le rôle de Mouchy, cette génitrice très possessive, le cinéaste a choisi Marthe Villalonga qui va devenir la tonique spécialiste française de la mère juive au grand écran. La séquence où Mouchy débarque, en manteau de fourrure, sur le court de tennis où Simon joue en double, est excellente. Simon reproche à sa mère de le déranger. Mouchy : « S’il faut payer pour te voir, dis-le ! » Simon hurle : « Arrête ! Arrête ! Mais qu’est-ce que j’ai fait… » Le plus savoureux, c’est que Marthe Villalonga, également mère juive dans Le coup de sirocco (1979), a confié qu’elle était « ni mère, ni juive »…
LE LAUREAT.- Le succès considérable de The Graduate constitue une surprise en 1967 : personne ne croyait à ce film qui réunissait des acteurs peu connus autour d’un scénario scabreux… Et pourtant ! Souvent considéré comme le premier opus notable du Nouvel Hollywood, le film va instantanément faire de Dustin Hoffman une star tandis que la chanson Mrs Robinson, écrite par le duo Simon et Garfunkel, va largement contribuer à la notoriété de cette histoire anticonformiste reflétant l’Amérique des sixties entre puritanisme et libération sexuelle. Mike Nichols raconte, ici, l’histoire de Benjamin Braddock, 21 ans, récemment diplômé de l’université, qui rentre chez ses parents en Californie pour les vacances. Bientôt Benjamin sera aspiré dans une liaison vénéneuse, séduisant Mme Robinson (Anne Bancroft) et sa fille (Katharine Ross)…
 Le lauréat s’ouvre sur un gros plan de Benjamin qu’on découvre, par un travelling arrière, dans l’avion qui le ramène en Californie. Ensuite un mémorable travelling latéral droite-gauche suit Benjamin (bord cadre à droite) sur un tapis roulant plat de l’aéroport. Tandis que le générique se déroule sur The Sound of Silence, autre titre fameux de Simon et Garfunkel, on suit le personnage principal supposé, à cet instant de son existence, faire face à l’avenir. Le travelling droite-gauche évoque cependant le fait que Braddock n’est pas prêt à se projeter vers cet avenir. Le personnage n’avance d’ailleurs pas. Ce sont le tapis et les voyageurs autour de lui qui sont en mouvement. Dans sa tête comme à l’image, Benjamin ne bouge pas. Pas encore…
Le lauréat s’ouvre sur un gros plan de Benjamin qu’on découvre, par un travelling arrière, dans l’avion qui le ramène en Californie. Ensuite un mémorable travelling latéral droite-gauche suit Benjamin (bord cadre à droite) sur un tapis roulant plat de l’aéroport. Tandis que le générique se déroule sur The Sound of Silence, autre titre fameux de Simon et Garfunkel, on suit le personnage principal supposé, à cet instant de son existence, faire face à l’avenir. Le travelling droite-gauche évoque cependant le fait que Braddock n’est pas prêt à se projeter vers cet avenir. Le personnage n’avance d’ailleurs pas. Ce sont le tapis et les voyageurs autour de lui qui sont en mouvement. Dans sa tête comme à l’image, Benjamin ne bouge pas. Pas encore…
PERSONA.- Célèbre actrice de théâtre, Elizabeth Vogler joue Electre lorsqu’elle s’interrompt brusquement au milieu d’une tirade. Elle ne parlera plus. D’abord soignée dans une clinique, son médecin l’envoie se reposer, sous la surveillance d’Alma, une jeune infirmière, dans sa demeure de l’île de Fårö. Les deux femmes se lient d’amitié. Le silence permanent d’Elizabeth conduit Alma à parler et à se confier. La découverte d’une lettre dans laquelle Elizabeth divulgue à son médecin les confessions d’Alma va provoquer une crise profonde.
« Je sens aujourd’hui, déclare Ingmar Bergman, que dans Persona je suis arrivé aussi loin que je peux aller. Et que j’ai touché là, en toute liberté, à des secrets sans mots que seul le cinéma peut découvrir. » Le titre premier du film (Cinématographe) résonne comme une sorte de testament d’un cinéaste alors que Persona (1966) va, au contraire, installer Bergman au sommet du 7e art. Le cinéaste suédois songe aux premières images du film alors qu’il délire sur son lit, frappé d’une grosse pneumonie.
 Parmi les images les plus frappantes de Persona, on remarque, lors de la dernière confrontation entre les deux femmes, que Bergman filme successivement le visage d’Elisabeth (Liv Ullmann) écoutant Alma (Bibi Andersson) puis cette dernière. Comme elles n’ont pas le même rapport au monde, il n’y a pas d’échange. Bergman imagine alors d’achever la séquence en « fusionnant » une moitié de deux gros plans des ses actrices, créant un visage hybride perturbant. Le décalage entre les deux personnages est d’autant plus étrange qu’à l’image, ils ne font qu’un.
Parmi les images les plus frappantes de Persona, on remarque, lors de la dernière confrontation entre les deux femmes, que Bergman filme successivement le visage d’Elisabeth (Liv Ullmann) écoutant Alma (Bibi Andersson) puis cette dernière. Comme elles n’ont pas le même rapport au monde, il n’y a pas d’échange. Bergman imagine alors d’achever la séquence en « fusionnant » une moitié de deux gros plans des ses actrices, créant un visage hybride perturbant. Le décalage entre les deux personnages est d’autant plus étrange qu’à l’image, ils ne font qu’un.
FRENZY.- En 1972, Alfred Hitchcock a 72 ans et il est fatigué par les échecs du Rideau déchiré (1966) et L’étau (1969). Il lit beaucoup de scénarios mais rien ne l’emballe. Jusqu’au moment où il repère une histoire de tueur à la cravate londonien. Hitch est ravi de quitter la Californie pour retrouver Londres et, plus encore, Covent Garden, le quartier de son enfance où il accompagnait parfois son père, marchand de fruits et légumes. Comme l’est le tueur à la cravate de Frenzy. Content d’être à Londres, Hitch est aussi heureux de travailler avec des comédiens anglais de théâtre dont il loue le talent. Même si le maître donnait toujours l’impression de s’occuper davantage des mouvements de caméra que des acteurs…
 De fait, ce 56e (et avant-dernier) film porte clairement la touche de Sir Alfred. La maîtrise des mouvements de caméra est impressionnante et surtout elle est au service du suspense. Il en va ainsi du long plan-séquence (1’17) de l’escalier. On a suivi la serveuse Babs (Anna Massey) que Robert Rusk (Barry Foster) amène dans son appartement. Les deux entrent et l’on se doute bien que la pauvre Babs vit ses derniers instants. Plutôt que de filmer le meurtre, Hitch fait le choix de quitter les lieux. Un superbe travelling arrière descend l’escalier, traverse le hall puis la rue pour arriver sur le trottoir d’en face, découvrant la façade de l’immeuble et les fenêtres derrière lesquelles le crime se déroule ou a déjà eu lieu. Une véritable (et dramatique) réussite technique commencée en studio (pour les intérieurs) et achevée dans le décor naturel de Covent Garden… Brillant !
De fait, ce 56e (et avant-dernier) film porte clairement la touche de Sir Alfred. La maîtrise des mouvements de caméra est impressionnante et surtout elle est au service du suspense. Il en va ainsi du long plan-séquence (1’17) de l’escalier. On a suivi la serveuse Babs (Anna Massey) que Robert Rusk (Barry Foster) amène dans son appartement. Les deux entrent et l’on se doute bien que la pauvre Babs vit ses derniers instants. Plutôt que de filmer le meurtre, Hitch fait le choix de quitter les lieux. Un superbe travelling arrière descend l’escalier, traverse le hall puis la rue pour arriver sur le trottoir d’en face, découvrant la façade de l’immeuble et les fenêtres derrière lesquelles le crime se déroule ou a déjà eu lieu. Une véritable (et dramatique) réussite technique commencée en studio (pour les intérieurs) et achevée dans le décor naturel de Covent Garden… Brillant !
LA REGLE DU JEU.- Pour François Truffaut, c’est tout simplement « le credo des cinéphiles, le film des films ». En 1939, Jean Renoir, après avoir mis en scène La grande illusion (1937), La Marseillaise et La bête humaine (1938) signe son chef d’œuvre. Parlant de « drame gai » ou de « fantaisie dramatique », le cinéaste donne une peinture de mœurs de l’aristocratie et de ses domestiques, à la fin des années 1930. En s’inspirant du théâtre de Musset ou de Marivaux et en parlant d’un « monde romantique et pourri », Renoir observe, avec une lucidité teintée d’humanisme, une société où tout le monde ment alors que s’organisent des intrigues amoureuses multiples et compliquées. Avec un vrai brio dans la mise en scène et une volonté de faire « surjouer » ses comédiens pour obtenir un effet commedia dell’arte, Renoir filme le ballet d’un monde aristocratique essoufflé et en fin de vie qui se révèle hypocrite et cruel.
 Le marquis Robert de la Chesnaye (Marcel Dalio) a invité des amis pour un week-end de chasse dans sa propriété de La Colinière en Sologne. La séquence de la chasse s’ouvre par du gibier filant dans le sous-bois. Puis s’approchent des domestiques en blouses blanches qui rabattent les animaux en tapant sur le sol et les arbres avec des bâtons. Plans rapides sur les chasseurs qui attendent, les fusils au poing. Soudain un coup de feu éclate, suivi par beaucoup d’autres. Dans le ciel comme à terre, lapins, lièvres, faisans tombent en abondance. Une forte séquence quasiment muette mais bruyante qui révèle la pulsion de violence d’une caste en déliquescence.
Le marquis Robert de la Chesnaye (Marcel Dalio) a invité des amis pour un week-end de chasse dans sa propriété de La Colinière en Sologne. La séquence de la chasse s’ouvre par du gibier filant dans le sous-bois. Puis s’approchent des domestiques en blouses blanches qui rabattent les animaux en tapant sur le sol et les arbres avec des bâtons. Plans rapides sur les chasseurs qui attendent, les fusils au poing. Soudain un coup de feu éclate, suivi par beaucoup d’autres. Dans le ciel comme à terre, lapins, lièvres, faisans tombent en abondance. Une forte séquence quasiment muette mais bruyante qui révèle la pulsion de violence d’une caste en déliquescence.
TARZAN L’HOMME SINGE.- Le roi de la jungle imaginé en 1912 par Edgar Rice Burroughs, est l’un des personnages de fiction les plus connus dans le monde. Cet enfant sauvage archétypal élevé par les grands singes d’Afrique est devenu un mythe exotico-hollywoodien dès 1918 lorsque Elmo Lincoln fut le premier acteur à enfiler le pagne de Tarzan. Mais c’est Johnny Weissmuller, premier Tarzan du cinéma parlant, qui est entré dans la légende. En 1932, dans Tarzan the Ape Man, Weissmuller va aussi pousser le fameux cri qui appartient de plein droit à l’imaginaire hollywoodien. La destinée de Johnny Weissmuller (1904-1984) relève elle-même de la légende. Né en Hongrie, il émigre, encore bébé, avec ses parents aux USA. A 9 ans, il contracte la polio et un médecin suggère la natation pour l’aider à guérir. Ca lui réussit puisqu’il sera, aux JO de 1924 et 1928, champion olympique à cinq reprises.
 Le cinéma s’intéresse évidemment à ce bel athlète à la musculature avantageuse qui sera Tarzan dans douze films qui contiennent de nombreuses séquences sous-marines. Johnny Weissmuller, le premier, fit entendre le fameux cri qui annonce l’arrivée du roi de la jungle. On a dit que ce cri serait dû à l’enregistrement d’un yodel autrichien monté à l’envers et en accéléré. En réalité, il serait « le produit d’un mixage composé du hurlement d’une hyène, de l’aboiement d’un chien, d’un ut poussé à l’aigu par la cantatrice Lorraine Bridge et de la vibration d’une corde sol de violon ». Qu’importe, Johnny Weissmuller, avec Jane (Maureen O’Sullivan) dans les bras, reste définitivement associé à ce cri.
Le cinéma s’intéresse évidemment à ce bel athlète à la musculature avantageuse qui sera Tarzan dans douze films qui contiennent de nombreuses séquences sous-marines. Johnny Weissmuller, le premier, fit entendre le fameux cri qui annonce l’arrivée du roi de la jungle. On a dit que ce cri serait dû à l’enregistrement d’un yodel autrichien monté à l’envers et en accéléré. En réalité, il serait « le produit d’un mixage composé du hurlement d’une hyène, de l’aboiement d’un chien, d’un ut poussé à l’aigu par la cantatrice Lorraine Bridge et de la vibration d’une corde sol de violon ». Qu’importe, Johnny Weissmuller, avec Jane (Maureen O’Sullivan) dans les bras, reste définitivement associé à ce cri.
A BOUT DE SOUFFLE.- « Plus belle avenue du monde », les Champs-Elysées ont souvent servi de décor au cinéma. Mais c’est indiscutablement Jean-Luc Godard qui a donné ses lettres de noblesse aux Champs. En 1959, JLG tourne son premier long-métrage et raconte les aventures de Michel Poiccard, jeune voyou insolent (Jean-Paul Belmondo), qui a tué un gendarme motocycliste en remontant en voiture de Marseille à Paris… Dans la capitale, Michel retrouve Patricia Franchini, une étudiante américaine, avec laquelle il a eu une liaison avant de partir pour Marseille. De retour à Paris, il retrouve Patricia qui veut étudier à la Sorbonne et qui, pour se faire un peu d’argent, vend le New York Herald Tribune sur les Champs…
 Dans la séquence mythique sur les Champs (où le chef opérateur Raoul Coutard tourne à la sauvette avec une caméra dissimulée aux regards des passants dans une poussette de bébé), Michel, chapeau mou et cigarette au bec, cherche Patricia alors que, sur la contre-allée, passent encore les voitures… Michel veut l’entraîner à Rome et lui déclare son amour : « Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir ». Il lui achète un journal avant de lui rendre : « Il n’y a pas d’horoscope ! » Ces plans en noir et blanc magnifient Jean Seberg. La comédienne américaine a 21 ans. Elle n’est plus une inconnue au cinéma puisqu’elle fut, en 57, la Jeanne d’Arc de Preminger et, en 58, la Cécile de Bonjour Tristesse. Mais Godard va l’inscrire dans la légende du 7e art avec ses ballerines, son fuseau noir, son tee-shirt publicitaire du Herald et sa coupe courte de piaf…
Dans la séquence mythique sur les Champs (où le chef opérateur Raoul Coutard tourne à la sauvette avec une caméra dissimulée aux regards des passants dans une poussette de bébé), Michel, chapeau mou et cigarette au bec, cherche Patricia alors que, sur la contre-allée, passent encore les voitures… Michel veut l’entraîner à Rome et lui déclare son amour : « Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir ». Il lui achète un journal avant de lui rendre : « Il n’y a pas d’horoscope ! » Ces plans en noir et blanc magnifient Jean Seberg. La comédienne américaine a 21 ans. Elle n’est plus une inconnue au cinéma puisqu’elle fut, en 57, la Jeanne d’Arc de Preminger et, en 58, la Cécile de Bonjour Tristesse. Mais Godard va l’inscrire dans la légende du 7e art avec ses ballerines, son fuseau noir, son tee-shirt publicitaire du Herald et sa coupe courte de piaf…
LES ENCHAINÉS.- Dans ce monument de la littérature de cinéma qu’est le Hitchcock/Truffaut (paru en 1967), le réalisateur de La nuit américaine note avec enthousiasme que Notorious constitue la quintessence du cinéma de Sir Alfred. Lorsque le film sort sur les écrans en août 1946, la critique plébiscite cette histoire atypique d’une relation à trois mêlant amour, politique et espionnage avec un couple de têtes d’affiche glamour à souhait. Ingrid Bergman et Cary Grant y échangent le « plus long baiser de l’histoire du cinéma » (2’30) alors que les censeurs de l’époque n’autorisent que… trois secondes. Hitch, au bout des dites trois secondes, demanda à ses acteurs d’improviser leur texte bouche contre bouche en répétant quelques baisers de deux secondes…
 Le moment techniquement le plus brillant de Notorious est la key scene qui se passe lors d’une soirée donnée par Sebastian (Claude Rains), chef d’un groupuscule nazi, pour Alicia (Bergman), sa nouvelle épouse. D’un panoramique en vue d’ensemble de cette réunion mondaine, Hitchcock, dans un imposant travelling réalisé à la grue, plonge lentement vers le couple Sebastian/Alicia pour aller cadrer, en très gros plan, une clé qu’Alicia serre dans sa main. Largement analysé, ce modèle de plan (précieux aussi pour l’intrigue : la clé donne accès à une cave qui contient de l’uranium que les nazis destinent à la fabrication d’une bombe atomique) a été compliqué à réaliser car les caméras ne disposaient pas alors de visée reflex. On remarque bien que, lorsque le cadreur arrive sur la main d’Alicia, celle-ci n’est pas centrée mais décadrée à droite…
Le moment techniquement le plus brillant de Notorious est la key scene qui se passe lors d’une soirée donnée par Sebastian (Claude Rains), chef d’un groupuscule nazi, pour Alicia (Bergman), sa nouvelle épouse. D’un panoramique en vue d’ensemble de cette réunion mondaine, Hitchcock, dans un imposant travelling réalisé à la grue, plonge lentement vers le couple Sebastian/Alicia pour aller cadrer, en très gros plan, une clé qu’Alicia serre dans sa main. Largement analysé, ce modèle de plan (précieux aussi pour l’intrigue : la clé donne accès à une cave qui contient de l’uranium que les nazis destinent à la fabrication d’une bombe atomique) a été compliqué à réaliser car les caméras ne disposaient pas alors de visée reflex. On remarque bien que, lorsque le cadreur arrive sur la main d’Alicia, celle-ci n’est pas centrée mais décadrée à droite…
L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES.- C’est sur le tournage de Rencontres du 3e type où Spielberg lui confia un rôle de scientifique français, que François Truffaut, profitant des heures d’attente, peaufina le scénario de ce drame de l’amour et de la mort. Au cœur du 17e long-métrage (1977) de Truffaut, on trouve, avec Bertrand Morane, un magnifique personnage de don juan qui ressemble comme un frère à Antoine Doinel, Pierre Lachenay, Montag ou… Truffaut lui-même. Scientifique spécialisé dans l’aérodynamique, Morane – auquel l’immense Charles Denner apporte une fièvre sublime et inquiète- voue aux femmes une passion inconditionnelle. C’est à toutes ces femmes admirées, séduites et aimées que Bertrand va dédier le roman de sa vie et de son obsession.
 Le film s’ouvre sur une longue et émouvante séquence dans le cimetière de Montpellier, au lendemain de Noël 1976. On porte en terre Bertrand Morane. On constate que ce sont exclusivement des femmes qui sont venues assister aux obsèques. Parmi elles, Geneviève, l’éditrice de Morane (Brigitte Fossey) dont la voix off observe : « Voilà le moment de vérité ! D’où il est maintenant, Bertrand est bien placé pour regarder une dernière fois ce qu’il aimait le plus en nous ». Alors que des pelletées de terre tombent sur le cercueil, Truffaut filme, en gros plan, des jambes de femmes qui passent devant la tombe. Voix de Geneviève : « Je me souviens d’une phrase de Bertrand… » Enchaînement avec la voix off de Charles Denner : « Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. »
Le film s’ouvre sur une longue et émouvante séquence dans le cimetière de Montpellier, au lendemain de Noël 1976. On porte en terre Bertrand Morane. On constate que ce sont exclusivement des femmes qui sont venues assister aux obsèques. Parmi elles, Geneviève, l’éditrice de Morane (Brigitte Fossey) dont la voix off observe : « Voilà le moment de vérité ! D’où il est maintenant, Bertrand est bien placé pour regarder une dernière fois ce qu’il aimait le plus en nous ». Alors que des pelletées de terre tombent sur le cercueil, Truffaut filme, en gros plan, des jambes de femmes qui passent devant la tombe. Voix de Geneviève : « Je me souviens d’une phrase de Bertrand… » Enchaînement avec la voix off de Charles Denner : « Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. »
FRANKENSTEIN.- En 1930, alors que l’Amérique subit de plein fouet la crise financière et sociale qui suit le fameux Jeudi Noir, Universal va contribuer à l’âge d’or des films d’épouvante hollywoodiens. Après Dracula, le studio, songe à Frankenstein, un classique de la littérature fantastique britannique. En 1931, la réalisation est confiée au jeune James Whale. Pour incarner la créature, le comédien doit être grand, massif, inquiétant et expressif car le monstre ne s’exprime que par des gestes et des grognements. Maquillé (très longuement chaque jour) par le génial Jack Pierce, le Britannique Boris Karloff, 44 ans, va devenir un acteur mythique.
 Portant les stigmates de ses origines morbides et poussant des grognements bestiaux, le comportement de la créature est cependant celui d’un être qui s’éveille à la vie, à la fois curieux et apeuré par ce qu’il découvre… Tandis que Frankenstein fuit les conséquences de son acte, sa créature sème la mort sur son passage. Ainsi lorsque le monstre arrive (45e minute) à proximité de la maison d’un menuisier et de sa fillette. Tandis que le père s’absente brièvement, la petite Maria aperçoit la créature. Nullement effrayée, elle l’invite à jouer en lançant des fleurs dans l’eau. Ravie, la créature partage ce moment innocent. Hélas, n’ayant plus de fleurs, la créature jette Maria dans l’eau où elle se noie. Terrifiée, la créature s’enfuit en poussant des grognements douloureux… A l’origine, la scène a été censurée par une coupe intervenant juste avant que la créature saisisse Maria. Elle a été réintroduite bien des années plus tard…
Portant les stigmates de ses origines morbides et poussant des grognements bestiaux, le comportement de la créature est cependant celui d’un être qui s’éveille à la vie, à la fois curieux et apeuré par ce qu’il découvre… Tandis que Frankenstein fuit les conséquences de son acte, sa créature sème la mort sur son passage. Ainsi lorsque le monstre arrive (45e minute) à proximité de la maison d’un menuisier et de sa fillette. Tandis que le père s’absente brièvement, la petite Maria aperçoit la créature. Nullement effrayée, elle l’invite à jouer en lançant des fleurs dans l’eau. Ravie, la créature partage ce moment innocent. Hélas, n’ayant plus de fleurs, la créature jette Maria dans l’eau où elle se noie. Terrifiée, la créature s’enfuit en poussant des grognements douloureux… A l’origine, la scène a été censurée par une coupe intervenant juste avant que la créature saisisse Maria. Elle a été réintroduite bien des années plus tard…
LA LISTE DE SCHINDLER.- En 1982, Steven Spielberg triomphe avec E.T. lorsqu’on lui parle du livre que Thomas Keneally consacre à Oskar Schindler. Surpris par l’histoire de l’industriel allemand (incarné par Liam Neeson) qui réussit à sauver la vie de quelque 1200 Juifs promis aux camps de la mort, le cinéaste américain ne sent pourtant « pas prêt émotionnellement » à réaliser un film sur la Shoah. De plus en plus impliqué par ses origines juives, Spielberg décidera finalement de réaliser le film après avoir entendu parler notamment des négationnistes de l’Holocauste. C’est seulement en 1993 que le réalisateur passe à l’acte après avoir mis en scène, à la demande du producteur Sid Sheinberg, Jurassic Park. « Il savait, dira Spielberg, qu’une fois que j’aurais tourné La liste de Schindler, je n’aurais pas été capable de faire Jurassic Park… »
 Même si Universal n’était pas emballée par un film en noir et blanc de plus de 3h, Spielberg obtint cependant gain de cause. Il introduit quelques rares scènes en couleurs, les plus bouleversantes concernent celles d’une fillette juive au manteau rouge. On la voit à deux reprises marchant parmi les siens au milieu des nazis et on aperçoit, une dernière fois, le manteau rouge sur une charrette dont on imagine sans peine qu’elle brinqueballe vers une fosse commune… Accusé de sentimentalisme pour ces touches de couleur, Spielberg, indigné, dira que ces scènes qui crèvent autant les yeux qu’une petite fille en manteau rouge, sont l’essence même du propos en reflétant l’échec des Alliés à empêcher l’extermination des Juifs d’Europe.
Même si Universal n’était pas emballée par un film en noir et blanc de plus de 3h, Spielberg obtint cependant gain de cause. Il introduit quelques rares scènes en couleurs, les plus bouleversantes concernent celles d’une fillette juive au manteau rouge. On la voit à deux reprises marchant parmi les siens au milieu des nazis et on aperçoit, une dernière fois, le manteau rouge sur une charrette dont on imagine sans peine qu’elle brinqueballe vers une fosse commune… Accusé de sentimentalisme pour ces touches de couleur, Spielberg, indigné, dira que ces scènes qui crèvent autant les yeux qu’une petite fille en manteau rouge, sont l’essence même du propos en reflétant l’échec des Alliés à empêcher l’extermination des Juifs d’Europe.
CARTOUCHE.- Bagarreur, charmeur et avec un cœur gros comme ça, Louis-Dominique Bourguignon dit Cartouche est un brigand qui vécut au 18e siècle et qui volait les riches pour donner aux pauvres… En 1962, le personnage convient comme un gant à Jean-Paul Belmondo. Le virevoltant comédien, alors âgé de 28 ans, travaille pour la première fois avec Philippe de Broca. Entre Bebel et le cinéaste, le courant passe à merveille. Le duo se retrouvera à six reprises pour, notamment, L’homme de Rio (1964) ou L’incorrigible (1975).
Avec Cartouche, De Broca signe aussi la première réussite commerciale de sa carrière, le film réunissant plus de 3,5 millions de spectateurs en France.
 Dans ce pétillant film d’aventures, Cartouche ferraille à plaisir et brave la police du roi en compagnie de ses acolytes La Taupe (Jean Rochefort) et La Douceur (Jess Hahn) tout en s’amusant à séduire une belle noble. C’est pourtant la gracieuse bohémienne Vénus (Claudia Cardinale) qui se sacrifiera pour lui sauver la vie. Vénus morte dans ses bras, Cartouche entre dans la salle de bal du château des Ferrussac et l’allonge sur une table. Sa bande dépouille les aristocrates de leurs bijoux. Dont on couvre le corps de Vénus… Extérieur nuit. Une carrosse doré avance au bord d’une eau noire. Dans le carrosse, Dominique effleure le visage de son aimée et sert le poing. Il dételle les chevaux. Plan ensemble. A la lueur des flambeaux, Cartouche pousse le carrosse vers l’eau où il s’enfonce lentement. La Taupe murmure : « Nous allons avoir des nuits froides… » Pour Cartouche désormais, il s’agit d’en finir vite.
Dans ce pétillant film d’aventures, Cartouche ferraille à plaisir et brave la police du roi en compagnie de ses acolytes La Taupe (Jean Rochefort) et La Douceur (Jess Hahn) tout en s’amusant à séduire une belle noble. C’est pourtant la gracieuse bohémienne Vénus (Claudia Cardinale) qui se sacrifiera pour lui sauver la vie. Vénus morte dans ses bras, Cartouche entre dans la salle de bal du château des Ferrussac et l’allonge sur une table. Sa bande dépouille les aristocrates de leurs bijoux. Dont on couvre le corps de Vénus… Extérieur nuit. Une carrosse doré avance au bord d’une eau noire. Dans le carrosse, Dominique effleure le visage de son aimée et sert le poing. Il dételle les chevaux. Plan ensemble. A la lueur des flambeaux, Cartouche pousse le carrosse vers l’eau où il s’enfonce lentement. La Taupe murmure : « Nous allons avoir des nuits froides… » Pour Cartouche désormais, il s’agit d’en finir vite.
BARRY LYNDON.- D’une grande beauté visuelle, ce chef d’œuvre du film d’époque (mal reçu par le public à sa sortie) se développe en deux parties et un épilogue… Dans l’Irlande des années 1750, on voit d’abord « comment Redmond Barry a acquis la manière et le titre de Barry Lyndon » puis, dans l’Angleterre de 1773, on suit la « relation des malheurs et désastres qui menèrent Barry Lyndon à sa chute » tandis que l’épilogue précise : « Ce fut sous le règne du roi George III que ces personnages vécurent et se querellèrent ; bons ou mauvais, beaux ou laids, riches ou pauvres, ils sont tous égaux maintenant ».
Depuis 1969 et la préparation d’un Napoléon inachevé, Kubrick désirait tourner avec pour seul éclairage des bougies. Longtemps, la chose fut impossible. En 1975, moyennant un objectif Zeiss initialement conçu pour la NASA, le cinéaste perfectionniste obtint enfin cet éclairage qui confère à Barry Lyndon une esthétique particulière dans l’esprit des peintures de genre de l’époque…
 Ce modèle de réalisme historique contient une belle scène de séduction autour d’une table de jeu éclairée par des candélabres. Face à Lady Lyndon (Marisa Berenson), Barry (Ryan O’Neal) semble littéralement hypnotisé. On entend la musique de Schubert et une voix qui dit : « Faites vos jeux. Rien ne va plus ». Pour le reste, la scène –muette- repose sur des échanges de regards. Enfin Lady Lyndon, confiant ses gains à son voisin, quitte la table. Elle attend sur un balcon. Travelling qui suit Barry avançant derrière elle. Elle se tourne, Il lui prend les mains et l’embrasse lentement sur la bouche…
Ce modèle de réalisme historique contient une belle scène de séduction autour d’une table de jeu éclairée par des candélabres. Face à Lady Lyndon (Marisa Berenson), Barry (Ryan O’Neal) semble littéralement hypnotisé. On entend la musique de Schubert et une voix qui dit : « Faites vos jeux. Rien ne va plus ». Pour le reste, la scène –muette- repose sur des échanges de regards. Enfin Lady Lyndon, confiant ses gains à son voisin, quitte la table. Elle attend sur un balcon. Travelling qui suit Barry avançant derrière elle. Elle se tourne, Il lui prend les mains et l’embrasse lentement sur la bouche…
TITANIC.- Même s’il est talonné par deux productions françaises (Bienvenue chez les Chtis et Intouchables), le film de James Cameron, sorti en 1997, figure toujours, avec 20,63 millions de spectateurs, au sommet du box-office français de tous les temps. Il est vrai que cette aventure –dont on connaît quand même la fin dramatique- réunit tous les ingrédients qui font la meilleure des comédies romantiques.
En avril 1912 à Southampton, Rose DeWitt, passagère de première classe et Jack Dawson, vagabond embarqué à la dernière minute en troisième classe, montent à bord du HMS Titanic, direction New York. Etouffée par son entourage, Rose a des envies de suicide. Au moment où elle s’apprête à passer à l’acte, Jack survient. Ils vont vivre une merveilleuse histoire d’amour vite troublée par la rencontre tragique avec l’iceberg puis le naufrage du paquebot.
 Porté par Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, couple hollywoodien flamboyant, Titanic contient une succession de scènes légendaires mais celle qui est assurément la plus culte s’ouvre, en plongée, sur Jack à la proue du Titanic. Il est songeur lorsque Rose apparaît derrière lui… Il l’invite à avancer vers la proue, à fermer les yeux et à grimper sur le bastingage. Tandis que Jack se tient derrière elle, Rose écarte les bras et ouvre les yeux. « Je vole… » souffle-t-elle. Cameron engage alors un vaste travelling autour de la proue du Titanic. Dans un ciel éclatant de rose, de bleu et de jaune orangé, Rose et Jack s’embrassent. Fondu-enchaîné sur le bastingage de l’épave du bateau au fond de l’océan.
Porté par Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, couple hollywoodien flamboyant, Titanic contient une succession de scènes légendaires mais celle qui est assurément la plus culte s’ouvre, en plongée, sur Jack à la proue du Titanic. Il est songeur lorsque Rose apparaît derrière lui… Il l’invite à avancer vers la proue, à fermer les yeux et à grimper sur le bastingage. Tandis que Jack se tient derrière elle, Rose écarte les bras et ouvre les yeux. « Je vole… » souffle-t-elle. Cameron engage alors un vaste travelling autour de la proue du Titanic. Dans un ciel éclatant de rose, de bleu et de jaune orangé, Rose et Jack s’embrassent. Fondu-enchaîné sur le bastingage de l’épave du bateau au fond de l’océan.
JOURNAL INTIME.- Au même titre que New York, Paris, Berlin et Londres, Rome est un fameux décor de cinéma. De la via Veneto aussi chère à Fellini que la fontaine de Trevi au banc du Colisée sur lequel s’endort la princesse Audrey Hepburn de Vacances romaines en passant par le Trastevere du Voleur de bicyclette, la Ville éternelle n’a cessé d’inspirer les cinéastes. S’il est né dans le Haut-Adige, Nanni Moretti a fait sienne la capitale italienne… On le mesure aisément dans Caro Diario (1993), sorte d’essai cinématographique composé de trois épisodes dans lesquels le cinéaste joue son propre rôle dans une sorte de dialogue avec son journal intime.
 Intitulé En Vespa, le premier volet est une belle déambulation, fondée sur de multiples travellings, des voix off et une bonne play-list, à travers les quartiers d’une Rome estivale et à moitié déserte… Tandis que Moretti, casqué, roule dans la ville, la photographie des beautés du paysage architectural et monumental accompagne les réflexions du cinéaste sur le cinéma hollywoodien, la critique, les salles obscures, la sociologie, l’urbanisme ou la danse. A un passant, Moretti explique qu’il fait des repérages pour un musical sur un pâtissier trotskyste dans la Rome des années 50. Tournée en équipe très réduite, cette promenade romaine entraîne Moretti du quartier de Garbatella, en passant par Spinaceto et Casal Palocco jusqu’à la plage d’Ostie où le cinéaste s’arrête devant le monument érigé à l’endroit où Pier Paolo Pasolini a été assassiné tandis qu’on entend les accents émouvants du Concert à Cologne de Keith Jarrett…
Intitulé En Vespa, le premier volet est une belle déambulation, fondée sur de multiples travellings, des voix off et une bonne play-list, à travers les quartiers d’une Rome estivale et à moitié déserte… Tandis que Moretti, casqué, roule dans la ville, la photographie des beautés du paysage architectural et monumental accompagne les réflexions du cinéaste sur le cinéma hollywoodien, la critique, les salles obscures, la sociologie, l’urbanisme ou la danse. A un passant, Moretti explique qu’il fait des repérages pour un musical sur un pâtissier trotskyste dans la Rome des années 50. Tournée en équipe très réduite, cette promenade romaine entraîne Moretti du quartier de Garbatella, en passant par Spinaceto et Casal Palocco jusqu’à la plage d’Ostie où le cinéaste s’arrête devant le monument érigé à l’endroit où Pier Paolo Pasolini a été assassiné tandis qu’on entend les accents émouvants du Concert à Cologne de Keith Jarrett…
LA PRISONNIERE DU DESERT.- Grand maître du western devant l’éternel, John Ford (1894-1973) a réalisé une suite de chefs d’œuvre qui célébraient le mythe de l’Amérique. On songe à La poursuite infernale (1946), La charge héroïque (1949) ou encore L ‘homme qui tua Liberty Valance (1962). Cependant le film qui les dépasse probablement tous, c’est La prisonnière du désert avec lequel le cinéaste borgne met littéralement le western en abyme. En ce milieu des années cinquante, le genre est à son apogée et il occupe largement les écrans américains et The Searchers (1956) s’impose comme un jalon important dans la manière dont le western considère la place de l’Indien…
En 1868, dans le désert de l’Ouest américain, Ethan Edwards, revenu de la Guerre de Sécession, s’installe chez son frère… Comme des Comanches auraient volé du bétail, Ethan et son neveu Martin partent pour récupérer les bêtes. Pendant ce temps, les Indiens incendient le ranch, tue la famille et enlève la jeune Debbie. Désormais, pour Ethan, commence une interminable quête pour retrouver sa nièce…
 En écho quasi-parfait à celui de l’ouverture, le film s’achève sur un plan magnifique. Dans le beau décor de Monument Valley, Ethan (John Wayne dans l’un de ses plus beaux rôles) ramène enfin Debbie aux siens. Descendu de cheval, il la porte dans ses bras jusque sur le pas de la porte. Travelling arrière avec la famille qui disparaît du cadre tandis qu’Ethan reste seul sur le seuil, les regardant pensivement. Lentement, il se tourne et repart dans la poussière. Cadre dans le cadre, la porte se referme. Noir final.
En écho quasi-parfait à celui de l’ouverture, le film s’achève sur un plan magnifique. Dans le beau décor de Monument Valley, Ethan (John Wayne dans l’un de ses plus beaux rôles) ramène enfin Debbie aux siens. Descendu de cheval, il la porte dans ses bras jusque sur le pas de la porte. Travelling arrière avec la famille qui disparaît du cadre tandis qu’Ethan reste seul sur le seuil, les regardant pensivement. Lentement, il se tourne et repart dans la poussière. Cadre dans le cadre, la porte se referme. Noir final.
EN CAS DE MALHEUR.- Fauchée, la jeune Yvette Maudet trame un mauvais coup. Avec une amie, elle repère une bijouterie de quartier. Armées d’un pistolet factice, elles braquent le vieux bijoutier lorsque sa femme surgit. Affolée, Yvette assomme la dame… En 1958, Pierre Bost et Jean Aurenche adaptent le roman éponyme (1956) de Georges Simenon. Claude Autant-Lara est chargé de la réalisation par le producteur Raoul Lévy qui a déjà produit, en 1956, Et Dieu créa la femme qui fit de Brigitte Bardot une star planétaire. Ce n’est donc pas une surprise de retrouver BB en tête d’affiche. Face à elle, un autre monstre sacré. Jean Gabin, après son retour des USA où il séjourna pendant la guerre, était devenu une véritable « institution française », imposant la silhouette massive d’un homme mûr aux cheveux blancs. Ici, il incarne André Gobillot, grand avocat parisien auquel Yvette demande de l’aide. Séduit par sa sensualité, il obtient son acquittement (au prix d’un faux témoignage) et entame une liaison avec elle…
 Une scène est restée dans les mémoires. Pour convaincre l’avocat de la défendre, Yvette l’aguiche en se dénudant. Plan d’ensemble d’un grand bureau cossu. De dos, Yvette relève sa jupe, découvre ses fesses et ses cuisses et s’assied sur l’angle d’un bureau Empire. Plan rapproché sur Gabin. Planté immobile sur ses deux jambes, Gobillot, en costume sombre, les mains dans les poches, a le mâchoire crispée et les lèvres serrées. Son regard descend furtivement… Plan d’ensemble, BB se laisse aller en arrière… A la sortie du film, quelques images des fesses de BB furent coupées par la censure.
Une scène est restée dans les mémoires. Pour convaincre l’avocat de la défendre, Yvette l’aguiche en se dénudant. Plan d’ensemble d’un grand bureau cossu. De dos, Yvette relève sa jupe, découvre ses fesses et ses cuisses et s’assied sur l’angle d’un bureau Empire. Plan rapproché sur Gabin. Planté immobile sur ses deux jambes, Gobillot, en costume sombre, les mains dans les poches, a le mâchoire crispée et les lèvres serrées. Son regard descend furtivement… Plan d’ensemble, BB se laisse aller en arrière… A la sortie du film, quelques images des fesses de BB furent coupées par la censure.
ROCKY.- Dire que la boxe est le plus cinématographique des sports est un truisme ! Quasiment depuis les origines, 7e art et noble art ont partie liée. Le cinéma, notamment américain, n’a cessé de considérer le ring comme une métaphore du monde… C’est sans doute Rocky, véritable succès planétaire de 1977, qui incarne le mieux le film de boxe à travers le rêve américain, celui d’un boxeur de seconde zone qui va réussir à prendre l’ascenseur social. Auteur de scénario (inspiré par le combat entre Mohamed Ali et Chuck Wepner), Sylvester Stallone est Rocky Balboa, un gaucher des bas-fonds de Philadelphie. Cet inconnu va monter sur le ring pour affronter Apollo Creed, le champion en titre, avec, dit-il, pour ambition de simplement tenir la distance…
 La scène finale du film de John G. Avildsen est puissante et réaliste. Creed et Balboa en sont au 15e et dernier round. Creed (Carl Weathers) est allé au tapis à l’entame du match et est contraint de prendre la mesure d’un adversaire coriace qui vacille mais ne jette jamais l’éponge. En plan d’ensemble, on voit les boxeurs, le visage tuméfié, se porter coup sur coup. Le gong final retentit. Les adversaires n’arrivent pas à se lâcher. Tandis que les juges vont donner Creed vainqueur par décision partagée, Rocky, assailli par les reporters sportifs, hurle : « Adrian ! ». Coiffée de son béret rouge, Adrian (Talia Shire) fend la foule et grimpe sur le ring. Gros plan : ils sont dans les bras l’un de l’autre et se disent « Je t’aime ». Rocky a perdu le match mais il a gagné. Le moins-que-rien n’est plus et l’amour a triomphé.
La scène finale du film de John G. Avildsen est puissante et réaliste. Creed et Balboa en sont au 15e et dernier round. Creed (Carl Weathers) est allé au tapis à l’entame du match et est contraint de prendre la mesure d’un adversaire coriace qui vacille mais ne jette jamais l’éponge. En plan d’ensemble, on voit les boxeurs, le visage tuméfié, se porter coup sur coup. Le gong final retentit. Les adversaires n’arrivent pas à se lâcher. Tandis que les juges vont donner Creed vainqueur par décision partagée, Rocky, assailli par les reporters sportifs, hurle : « Adrian ! ». Coiffée de son béret rouge, Adrian (Talia Shire) fend la foule et grimpe sur le ring. Gros plan : ils sont dans les bras l’un de l’autre et se disent « Je t’aime ». Rocky a perdu le match mais il a gagné. Le moins-que-rien n’est plus et l’amour a triomphé.
LE TROISIEME HOMME.- Ecrit directement pour le cinéma par Graham Greene, The Third Man est une œuvre emblématique de la Guerre froide. Modeste écrivain américain, Holly Martins est venu retrouver son ami Harry Lime dans la Vienne dévastée de l’après-guerre. Mais Lime a été écrasé par une voiture. Martins veut mener sa propre enquête pour démasquer les assassins de son ami. Des surprises l’attendent… Porté par la fameuse musique jouée à la cithare par Anton Karas, ce thriller valut, en 1949, une notoriété internationale au cinéaste Carol Reed même si l’on eut parfois tendance à attribuer une partie de la mise en scène à Orson Welles qui trouve l’un des mythiques personnages de sa carrière avec cet Harry Lime, trafiquant de pénicilline et sinistre crapule au visage poupin.
 Par son esthétique romanesque et crépusculaire, Le troisième homme rappelle autant l’expressionnisme allemand que le film noir américain. Parmi d’autres, il est une séquence superbe avec ses cadrages en biais. Martins (Joseph Cotten) déambule de nuit dans la ville. Dans la sombre entrée d’un immeuble, il croit remarquer quelqu’un avec un chat à ses pieds. Légèrement ivre, il l’apostrophe pour qu’il se montre… Ses cris réveillent une habitante. Furieuse, elle apparaît à sa fenêtre et éclaire, de la sorte, le visage… d’Harry Lime. Rapide travelling avant. Martins est abasourdi. La fenêtre s’est refermée. Le noir est revenu. Martins s’apprête à traverser la rue. Une voiture passant à vive allure, manque de le renverser. Lorsqu’il atteint le porche, plus personne. Harry Lime est insaisissable…
Par son esthétique romanesque et crépusculaire, Le troisième homme rappelle autant l’expressionnisme allemand que le film noir américain. Parmi d’autres, il est une séquence superbe avec ses cadrages en biais. Martins (Joseph Cotten) déambule de nuit dans la ville. Dans la sombre entrée d’un immeuble, il croit remarquer quelqu’un avec un chat à ses pieds. Légèrement ivre, il l’apostrophe pour qu’il se montre… Ses cris réveillent une habitante. Furieuse, elle apparaît à sa fenêtre et éclaire, de la sorte, le visage… d’Harry Lime. Rapide travelling avant. Martins est abasourdi. La fenêtre s’est refermée. Le noir est revenu. Martins s’apprête à traverser la rue. Une voiture passant à vive allure, manque de le renverser. Lorsqu’il atteint le porche, plus personne. Harry Lime est insaisissable…
L’AFFAIRE THOMAS CROWN.- Séduisant banquier divorcé, Thomas Crown estime que sa luxueuse existence ne lui procure plus de satisfaction. Pour goûter à nouveau des frissons, il prépare minutieusement l’audacieux casse de sa propre banque… Alors qu’il va cacher son butin en Suisse, Crown constate que la compagnie d’assurance de la banque lui a dépêché une ravissante mais redoutable enquêtrice. Entre la belle Vicky Anderson et un Thomas Crown sûr de lui, un jeu pervers commence… En 1968, Norman Jewison orchestre un polar chic dans lequel il oppose Steve McQueen et Faye Dunaway révélée par Bonnie and Clyde. Michel Legrand signe sa première composition pour Hollywood et gagne d’emblée l’Oscar de la meilleure bande originale pour la chanson The Windmills of Your Mind.
 Si la scène du baiser, avec ses 55 secondes, est l’une des plus longues de l’histoire du cinéma, une autre séquence de The Thomas Crown Affair brille par son érotisme. Dans un salon feutré, Vicky Anderson et Thomas Crown jouent aux échecs. Hormis deux plans larges sur le salon et deux plongées sur l’échiquier, Jewison privilégie les gros plans, voire les très gros plans, tour à tour sur le mouvement des pièces ou sur les regards des deux joueurs. Et puis la partie prend un tour différent lorsque Vicky commence à jouer avec son décolleté, passe un doigt sur ses lèvres ou se caresse le bras. Face à elle, Crown tente de se concentrer. En vain. Sous le table, les jambes se frôlent. Autour de l’échiquier, les mains s’effleurent. La musique habille entièrement la séquence. Pas un mot n’est prononcé. Sinon le « Check » final qui marque la défaite de Thomas Crown.
Si la scène du baiser, avec ses 55 secondes, est l’une des plus longues de l’histoire du cinéma, une autre séquence de The Thomas Crown Affair brille par son érotisme. Dans un salon feutré, Vicky Anderson et Thomas Crown jouent aux échecs. Hormis deux plans larges sur le salon et deux plongées sur l’échiquier, Jewison privilégie les gros plans, voire les très gros plans, tour à tour sur le mouvement des pièces ou sur les regards des deux joueurs. Et puis la partie prend un tour différent lorsque Vicky commence à jouer avec son décolleté, passe un doigt sur ses lèvres ou se caresse le bras. Face à elle, Crown tente de se concentrer. En vain. Sous le table, les jambes se frôlent. Autour de l’échiquier, les mains s’effleurent. La musique habille entièrement la séquence. Pas un mot n’est prononcé. Sinon le « Check » final qui marque la défaite de Thomas Crown.
TANT QU’IL Y AURA DES HOMMES.- Le baiser au grand écran est-il incontournable ? Sans doute. Le cinéma est, par essence, un art voyeur ! En 1953, Fred Zinnemman met en scène les aventures de trois militaires sur la base de Schofield à Hawaii : les 2e classe Prewitt (Monty Clift) et Maggio (Frank Sinatra) et l’adjudant Warden (Burt Lancaster) à l’heure de l’attaque japonaise sur Pearl Harbour. En 1954, From Here to Eternity remportera huit Oscars dont ceux de meilleur film et de meilleur réalisateur, Sinatra et Donna Reed étant récompensés comme meilleurs seconds rôles.
 Tant qu’il y aura des hommes est réputé pour sa scène du baiser sur la plage, symbole de la passion. Bref plan large sur le Pacifique et les vagues. Panoramique sur une vague qui avance rapidement sur le sable pour passer sur Warden et Karen, l’épouse du capitaine Holmes, chef de la base. Les deux sont allongés, enlacés et s’embrassent… En maillot noir, Karen (la magnifique Deborah Kerr) se lève et part s’allonger sur sa serviette. Warden la suit, s’arrête, debout, au-dessus d’elle. Il tombe à genoux et l’embrasse. Plan sur la main de Karen avec son alliance au doigt. « Personne ne m’a jamais embrassé comme ça ! » Mais, entre les deux, le ton se durcit. Warden évoque les nombreux amants de Karen. Celle-ci tente de le gifler puis tombe devant lui. « Tu ne me fais grâce de rien ». En gros plan, ses cheveux blonds courts mouillés, Karen raconte sa vie d’épouse bafouée et le drame de la perte d’un enfant. « Si tu étais venu plus tôt, conclut-elle, bien des choses ne se seraient pas passées… »
Tant qu’il y aura des hommes est réputé pour sa scène du baiser sur la plage, symbole de la passion. Bref plan large sur le Pacifique et les vagues. Panoramique sur une vague qui avance rapidement sur le sable pour passer sur Warden et Karen, l’épouse du capitaine Holmes, chef de la base. Les deux sont allongés, enlacés et s’embrassent… En maillot noir, Karen (la magnifique Deborah Kerr) se lève et part s’allonger sur sa serviette. Warden la suit, s’arrête, debout, au-dessus d’elle. Il tombe à genoux et l’embrasse. Plan sur la main de Karen avec son alliance au doigt. « Personne ne m’a jamais embrassé comme ça ! » Mais, entre les deux, le ton se durcit. Warden évoque les nombreux amants de Karen. Celle-ci tente de le gifler puis tombe devant lui. « Tu ne me fais grâce de rien ». En gros plan, ses cheveux blonds courts mouillés, Karen raconte sa vie d’épouse bafouée et le drame de la perte d’un enfant. « Si tu étais venu plus tôt, conclut-elle, bien des choses ne se seraient pas passées… »
DILLINGER EST MORT.- Quand on évoque le nom de Marco Ferreri, on songe à La grande bouffe, imposant scandale au Festival Cannes 1973 où, derrière le fameux suicide gastronomique, le cinéaste italien disait son dégoût de la société de consommation et son angoisse devant l’évolution de la société tout court. Ferreri (1928-1997) a toujours été un observateur lucide et attentif de l’aliénation de l’homme moderne. En 1969, il signe Dillinger est mort, une fable noire et certainement l’une des plus impressionnantes représentations de la fascination pour le vide. Concepteur de masques à gaz, l’ingénieur Glauco (Michel Piccoli, pour la première fois chez Ferreri) rentre chez lui après une journée de travail. Sa femme (Anita Pallenberg) est couchée avec une grosse migraine. Affamé, il se prépare un dîner. Dans un tiroir, il découvre un revolver enveloppé dans un journal qui relate la mort du gangster américain John Dillinger. Il remet l’arme en état, la peint en rouge et la décore de pois blancs. Il regarde Fausto Coppi à la télé, fait le pitre devant des films de vacances et s’amuse à des jeux érotiques avec Ginette, sa bonne (Annie Girardot)…
 Après avoir longuement joué avec son arme, Glauco entre dans la chambre conjugale. Sa femme dort profondément. Il fait mine de se tirer dans la tempe puis met en joue deux tableaux à la tête du lit. Torse nu, une serviette autour de la taille, il monte alors le son d’un transistor, pose deux coussins sur la tête de sa femme et tire à trois reprises. Ferreri vient de mettre en scène le meurtre le plus absurde et le plus gratuit qui soit. Malaise garanti.
Après avoir longuement joué avec son arme, Glauco entre dans la chambre conjugale. Sa femme dort profondément. Il fait mine de se tirer dans la tempe puis met en joue deux tableaux à la tête du lit. Torse nu, une serviette autour de la taille, il monte alors le son d’un transistor, pose deux coussins sur la tête de sa femme et tire à trois reprises. Ferreri vient de mettre en scène le meurtre le plus absurde et le plus gratuit qui soit. Malaise garanti.
A L’OMBRE DE LA HAINE.- Quand deux solitudes se rencontrent en pleine dérive… Hank Grotowski est gardien dans le couloir de la mort d’une prison américaine. Leticia Musgrove est l’épouse de Lawrence qui va être exécuté dans les prochaines heures. Hank a perdu son fils qui s’est suicidé, trop fragile pour son travail à la prison. Leticia a perdu, elle, son fils Tyrell, gamin obèse, renversé un soir par une voiture…
En 2001, le réalisateur germano-suisse Marc Forster met en scène Monster’s Ball qui vaudra à Halle Berry d’obtenir un Oscar à Hollywood. Egalement récompensée à la Berlinale, Halle Berry est toujours à ce jour, la seule actrice afro-américaine à avoir obtenu la fameuse statuette de la meilleure actrice.
 En compagnie de Billy Bob Thornton, Halle Berry a défrayé la chronique en tournant l’une des scènes de sexe les plus « hot » du cinéma. Par hasard, Hank était passé sur les lieux de l’accident de Tyrell. Il avait secouru la mère et son fils. Et les deux s’étaient peu à peu rapprochés. Hank qui a ramené Leticia de son travail, est invité à entrer chez elle. Assis sur un canapé, ils boivent plus que de raison tandis qu’elle rit nerveusement. Hank : « Je ne comprends pas ce que vous attendez de moi… » En dégageant un sein de son tee-shirt, Leticia supplie : « Aidez-moi à me sentir bien ». En quatre minutes, Forster va filmer, en alternant gros plans et plans larges « à la dérobé » sur les corps nus, une rencontre charnelle torride et pathétique dans un abandon complet au désir. « J’avais tellement besoin de toi » dit Leticia et Hank : « Je n’avais pas ressenti cela depuis longtemps… »
En compagnie de Billy Bob Thornton, Halle Berry a défrayé la chronique en tournant l’une des scènes de sexe les plus « hot » du cinéma. Par hasard, Hank était passé sur les lieux de l’accident de Tyrell. Il avait secouru la mère et son fils. Et les deux s’étaient peu à peu rapprochés. Hank qui a ramené Leticia de son travail, est invité à entrer chez elle. Assis sur un canapé, ils boivent plus que de raison tandis qu’elle rit nerveusement. Hank : « Je ne comprends pas ce que vous attendez de moi… » En dégageant un sein de son tee-shirt, Leticia supplie : « Aidez-moi à me sentir bien ». En quatre minutes, Forster va filmer, en alternant gros plans et plans larges « à la dérobé » sur les corps nus, une rencontre charnelle torride et pathétique dans un abandon complet au désir. « J’avais tellement besoin de toi » dit Leticia et Hank : « Je n’avais pas ressenti cela depuis longtemps… »
LE CORBEAU.- Réalisé durant l’Occupation sous l’égide de la Continental, la société de production allemande dirigée par le francophile Alfred Greven, Le corbeau (1943) est devenu un film emblématique d’une époque très sombre. Le film, lui-même, est très noir. Inspiré d’un fait-divers qui s’était déroulé à Tulle à la fin des années 20, Le Corbeau raconte l’aventure de Rémy Germain, médecin dans une petite ville de province. Il est la victime d’un corbeau, qui, dans une série de lettres anonymes envoyés aux habitants, accuse Germain d’adultère et de pratiquer des avortements clandestins… Quand un malade, atteint d’un cancer, reçoit une lettre et se suicide, le climat de tension dégénère et la foule se cherche un coupable. Pour les détracteurs du réalisateur Henri-Georges Clouzot, le film est un acte de collaboration qui donne des Français une image déplorable. A la Libération, Clouzot est banni à vie du métier de cinéaste et le film interdit. Les deux interdictions seront levées en 1947.
 Dans une scène brillante, Germain (Pierre Fresnay) discute avec son confrère Vorzet (Pierre Larquey). Celui-ci s’étonne : « Vous êtes formidable ! Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais ! Que le bien, c’est la lumière et que l’ombre, c’est le mal. » Le psychiatre fait alors se balancer l’ampoule d’une lampe de gauche à droite, faisant ainsi bouger la lumière. Il observe : « Mais où est l’ombre ? Où est la lumière ? » Germain grince : « Quelle littérature ! Y’a qu’à arrêter la lampe… » Il le fait et se brûle les doigts. « Vous vous êtes brûlé… » sourit Vorzet en ajoutant : « L’expérience est concluante. »
Dans une scène brillante, Germain (Pierre Fresnay) discute avec son confrère Vorzet (Pierre Larquey). Celui-ci s’étonne : « Vous êtes formidable ! Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais ! Que le bien, c’est la lumière et que l’ombre, c’est le mal. » Le psychiatre fait alors se balancer l’ampoule d’une lampe de gauche à droite, faisant ainsi bouger la lumière. Il observe : « Mais où est l’ombre ? Où est la lumière ? » Germain grince : « Quelle littérature ! Y’a qu’à arrêter la lampe… » Il le fait et se brûle les doigts. « Vous vous êtes brûlé… » sourit Vorzet en ajoutant : « L’expérience est concluante. »
PRETTY WOMAN.- En 1990, l’Américain Garry Marshall signe le plus gros succès de sa carrière (plus de 4 millions de spectateurs en France) avec l’histoire d’Edward Lewis, richissime (et antipathique) homme d’affaires, spécialiste du démembrement d’entreprises en difficulté… De passage à Los Angeles, il quitte une soirée chic, emprunte la voiture de son avocat pour rentrer à son hôtel et se perd dans la ville. Sur Hollywood Boulevard, il demande son chemin à des prostituées. Il propose à l’une d’elles, Vivian Ward, de prendre le volant de la Lotus. Arrivés à l’hôtel, Lewis engage « Viv », le temps qu’il doit rester en ville, pour jouer le rôle de sa petite amie. On s’en doute, Lewis va se transformer en prince charmant et Vivian en Cendrillon.
 Cette comédie romantique culte compte nombre de bonnes scènes mais la plus fameuse est sans doute celle du collier… Dans sa suite du Regent Beverly Wilshire, Edward Lewis (Richard Gere) observe « Viv » qui apparaît dans un superbe fourreau rouge très décolleté et note : « Il manque quelque chose ? » Ce quelque chose est dans un écrin à bijoux qu’il ouvre devant Vivian. La jeune femme (Julia Roberts dans le rôle qui va la faire star) regarde le magnifique collier de rubis et avance la main vers lui… lorsque Lewis claque rapidement le couvercle de l’écrin sur ses doigts. Vivian Ward retire vivement sa main et éclate de rire. On a appris par la suite que la scène a été improvisée. Le rire éclatant et spontané de Julia Roberts a convaincu le réalisateur de conserver au montage la plaisanterie imaginée par Richard Gere.
Cette comédie romantique culte compte nombre de bonnes scènes mais la plus fameuse est sans doute celle du collier… Dans sa suite du Regent Beverly Wilshire, Edward Lewis (Richard Gere) observe « Viv » qui apparaît dans un superbe fourreau rouge très décolleté et note : « Il manque quelque chose ? » Ce quelque chose est dans un écrin à bijoux qu’il ouvre devant Vivian. La jeune femme (Julia Roberts dans le rôle qui va la faire star) regarde le magnifique collier de rubis et avance la main vers lui… lorsque Lewis claque rapidement le couvercle de l’écrin sur ses doigts. Vivian Ward retire vivement sa main et éclate de rire. On a appris par la suite que la scène a été improvisée. Le rire éclatant et spontané de Julia Roberts a convaincu le réalisateur de conserver au montage la plaisanterie imaginée par Richard Gere.
BELLE DE JOUR.- Au milieu des années soixante, Luis Bunuel vient successivement d’adapter Octave Mirbeau (Le journal d’une femme de chambre, 1964) et Garcia Lorca (Simon du désert, 1965) et il n’est pas spécialement emballé par la proposition des frères Hakim de réaliser Belle de jour d’après un livre de Joseph Kessel paru en 1928… De plus, le cinéaste n’est pas convaincu par l’actrice choisie pour être Séverine… Catherine Deneuve a 24 ans, est presque encore une débutante (malgré ses rôles dans Les parapluies de Cherbourg et La vie de château) mais elle va brillamment s’imposer en bourgeoise sexuellement frustrée, se prostituant l’après-midi dans une maison close parisienne où elle décline toutes les perversions et prend son plaisir dans la soumission. Juste avant la grande vague du X qui va secouer la France du début des seventies, Belle de jour (1967) va impressionner par son érotisme chaste mais fortement suggestif.
 Le film s’ouvre sur un couple faisant une promenade romantique dans les bois à bord d’une calèche. Alors que Séverine et son mari Pierre (Jean Sorel) se disent leur amour, le fiacre s’arrête et Pierre donne l’ordre aux deux cochers de sortir manu militari sa femme du véhicule. Malgré sa résistance, elle est bâillonnée, traînée à terre puis, les mains attachées, accrochée à un arbre. « N’ayez pas peur de la secouer, cette petite salope » lâche Pierre qui lui arrache ses vêtements (créés par Yves Saint Laurent). Les deux cochers cravachent le dos nu de Séverine. « Elle est à vous » ajoute Pierre. L’un des valets de pied tombe la veste, s’approche et embrasse la nuque de Séverine dont le visage reflète le plaisir…
Le film s’ouvre sur un couple faisant une promenade romantique dans les bois à bord d’une calèche. Alors que Séverine et son mari Pierre (Jean Sorel) se disent leur amour, le fiacre s’arrête et Pierre donne l’ordre aux deux cochers de sortir manu militari sa femme du véhicule. Malgré sa résistance, elle est bâillonnée, traînée à terre puis, les mains attachées, accrochée à un arbre. « N’ayez pas peur de la secouer, cette petite salope » lâche Pierre qui lui arrache ses vêtements (créés par Yves Saint Laurent). Les deux cochers cravachent le dos nu de Séverine. « Elle est à vous » ajoute Pierre. L’un des valets de pied tombe la veste, s’approche et embrasse la nuque de Séverine dont le visage reflète le plaisir…
BARFLY.- Du Poison (1945) de Wilder à Un singe en hiver (1962) de Verneuil, le cinéma a souvent traité de l’alcoolisme avec des ivrognes tour à tour comiques ou tragiques. Le thème a aussi permis d’évoquer l’impuissance créatrice de l’artiste, la déchéance physique, morale, l’autodestruction, la mort ou la rédemption par l’amour… Parmi les personnages d’alcooliques flamboyants, figure le romancier américain Charles Bukowski (1920-1994) auquel le grand écran a consacré plusieurs films dont Conte de la folie ordinaire (1981) de Marco Ferreri ou Barfly (1987) dans lequel l’écrivain est incarné par Mickey Rourke dans l’une de ses meilleures prestations. Barbet Schroeder y raconte l’histoire d’un auteur, Henry Chinaski (le nom choisi par Bukowski pour son alter ego dans ses nombreux romans autobiographiques) qui hante surtout les bars dans les faubourgs miteux de Los Angeles. C’est là qu’il croise Wanda Wilcox, une femme solitaire en instance de divorce qui, elle aussi, s’adonne à l’alcool.
 Dans Barfly (où, pour la première fois, Bukowski écrivait pour le cinéma), le cinéaste a tourné en décors naturels, notamment dans différents rades de La cité des anges. 40e minute : Chinaski et Wanda (Faye Dunaway) sont accoudés au bar où un vieux poivrot tente d’avaler un verre d’alcool. Mais sa main tremble tellement qu’il en renverse le contenu. L’homme prend alors une écharpe, l’entoure autour du poignet de la main qui tient le verre, la passe derrière la tête et de l’autre main, tire lentement pour amener le verre à ses lèvres… C’est à peine si Chinaski et Wanda prêtent attention à lui…
Dans Barfly (où, pour la première fois, Bukowski écrivait pour le cinéma), le cinéaste a tourné en décors naturels, notamment dans différents rades de La cité des anges. 40e minute : Chinaski et Wanda (Faye Dunaway) sont accoudés au bar où un vieux poivrot tente d’avaler un verre d’alcool. Mais sa main tremble tellement qu’il en renverse le contenu. L’homme prend alors une écharpe, l’entoure autour du poignet de la main qui tient le verre, la passe derrière la tête et de l’autre main, tire lentement pour amener le verre à ses lèvres… C’est à peine si Chinaski et Wanda prêtent attention à lui…
PIERROT LE FOU.- Ferdinand Griffon est au bout du rouleau. Un soir, après une désolante soirée chez ses beaux-parents, il décide de tout plaquer et part avec la belle Marianne dans le sud de la France. En 1965, Jean-Luc Godard réalise Pierrot le fou, road-movie poétique et coloré où l’on rencontre la Seine de nuit et la Méditerranée de jour, un perroquet, les Pieds nickelés, Samuel Fuller, Picasso, Van Gogh, Rimbaud et surtout Jean-Paul Belmondo et Anna Karina dont le « Qu’est-ce que j’peux faire, j’sais pas quoi faire… » est devenu culte.
 A la Mostra de Venise où le film est en compétition, Louis Chauvet, critique du Figaro, n’est pas tendre avec Godard dont le film serait « imprégné d’un surréalisme de pacotille ». Chauvet ne retient que la prestation de Raymond Devos. Une séquence unique et courte (moins de 4 mn), en plan moyen, au bord de la mer. Jean-Paul Belmondo s’approche d’un homme qui chante. « Cet air-là, c’est toute ma vie ! » Mais Bebel n’entend rien. L’homme lui raconte trois rencontres autour d’une chanson qui dit « Est-ce que vous m’aimez ? ». La première avec une femme magnifique dont il caresse la main au-dessus, la seconde avec une femme moins belle dont il caresse la main en-dessous « pour changer un peu » et la troisième dont il caresse la main « dans les deux sens. Pour en finir ». Et l’homme chante encore. Bebel n’entend toujours rien : « Dites tout de suite que je suis fou ! » Pierrot : « Vous êtes fou ». L’homme : « Et bien, je préfère ». Du pur, du grand Devos ! Là-dessus, Chauvet avait raison.
A la Mostra de Venise où le film est en compétition, Louis Chauvet, critique du Figaro, n’est pas tendre avec Godard dont le film serait « imprégné d’un surréalisme de pacotille ». Chauvet ne retient que la prestation de Raymond Devos. Une séquence unique et courte (moins de 4 mn), en plan moyen, au bord de la mer. Jean-Paul Belmondo s’approche d’un homme qui chante. « Cet air-là, c’est toute ma vie ! » Mais Bebel n’entend rien. L’homme lui raconte trois rencontres autour d’une chanson qui dit « Est-ce que vous m’aimez ? ». La première avec une femme magnifique dont il caresse la main au-dessus, la seconde avec une femme moins belle dont il caresse la main en-dessous « pour changer un peu » et la troisième dont il caresse la main « dans les deux sens. Pour en finir ». Et l’homme chante encore. Bebel n’entend toujours rien : « Dites tout de suite que je suis fou ! » Pierrot : « Vous êtes fou ». L’homme : « Et bien, je préfère ». Du pur, du grand Devos ! Là-dessus, Chauvet avait raison.
LE SILENCE DES AGNEAUX.- Hannibal Lecter est une quintessence dans le domaine du Mal. Rien d’étonnant alors qu’il fascine Clarice Starling, jeune analyste du FBI, qui n’a pas encore fini ses études à l’école de police… Adaptant un roman de Thomas Harris, le cinéaste Jonathan Demme raconte, dans le cadre d’une enquête sur un tueur en série, la rencontre entre Clarice (Jodie Foster) et le docteur Lecter, éminent psychiatre incarcéré dans un hôpital psychiatrique pour des faits de cannibalisme. Sorti en 1991, The Silence of the Lambs (1991) a obtenu, en 1992, les cinq Oscars majeurs (meilleurs film, réalisateur, scénario adapté, acteur et actrice), parfaite récompense pour une réussite exemplaire du film de terreur.
 L’admirable comédien britannique Anthony Hopkins est à la fois suave et inquiétant, imprévisible et déroutant, intelligent et machiavélique en Hannibal Lecter. La scène où il « reçoit » Clarice Starling, venue lui soutirer des informations, est un superbe moment de cinéma. Pour déstabiliser son interlocutrice, Lecter, qui se déplace souplement dans sa cage de verre, l’agresse verbalement, la traitant de « fille de ferme endimanchée ». Alors que l’agent du FBI lui suggère d’appliquer sa faculté d’analyse à lui-même, Lecter confie : « J’ai été interrogé par un agent du recensement. J’ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent chianti ». Filmé en plan fixe et en gros plan, appuyé à la vitre de sa cellule, le sourire carnassier et le regard dément, le cannibale achève sa phrase par un petit bruit de bouche sifflant, gourmand et terrifiant!
L’admirable comédien britannique Anthony Hopkins est à la fois suave et inquiétant, imprévisible et déroutant, intelligent et machiavélique en Hannibal Lecter. La scène où il « reçoit » Clarice Starling, venue lui soutirer des informations, est un superbe moment de cinéma. Pour déstabiliser son interlocutrice, Lecter, qui se déplace souplement dans sa cage de verre, l’agresse verbalement, la traitant de « fille de ferme endimanchée ». Alors que l’agent du FBI lui suggère d’appliquer sa faculté d’analyse à lui-même, Lecter confie : « J’ai été interrogé par un agent du recensement. J’ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent chianti ». Filmé en plan fixe et en gros plan, appuyé à la vitre de sa cellule, le sourire carnassier et le regard dément, le cannibale achève sa phrase par un petit bruit de bouche sifflant, gourmand et terrifiant!
JOUE-LA COMME BECKHAM.- Le football est rarement bien servi par le cinéma. A l’exception notable de Looking for Eric (2009) de Ken Loach. C’est également d’Angleterre que vient Joue-la comme Beckham, un feelgood movie réalisé en 2002 par Gurunder Chadha qui raconte les aventures de Jessminder –Jess- Bhamra, une adolescente d’origine indienne demeurant avec sa famille à Londres. Contrairement à ses amies qui n’attendent que le mariage, Jess est folle de foot et idolâtre David Beckham, la star de Manchester United. Remarquée par Juliet Jules (Keira Knightley dans l’un de ses tout premiers rôles), une jeune fille de son âge, issue d’un milieu très différent, Jess est invitée à rejoindre son équipe de foot féminin. Jess va alors mentir à ses parents, très à cheval sur les principes d’éducation de leur milieu, pour jouer.
 La scène d’ouverture du film se déroule à Old Trafford où MU affronte Anderlecht en coupe UEFA. Dans les rangs des Rouges jouent Scholes, Giggs, Silvestre et Beckham qui, au terme d’une chevauchée, délivre un centre parfait dans la surface belge. Grâce à un habile trucage, Bhamra s’élève et marque de la tête. Elle fête son but dans un stade en liesse et est félicitée par Beckham. Retour sur le plateau d’une émission de télé où Gary Linecker et ses invités commentent sa performance. Linecker demande à la mère, invitée de l’émission, si elle est fière de sa Jess : « Pas du tout ! » Coloré et savoureux, Bend It like Bechkam allie la culture du foot à l’anglaise à la culture indienne. C’est une petite bulle de fraîcheur qui illustre la lutte de Jess pour aller au bout de ses rêves.
La scène d’ouverture du film se déroule à Old Trafford où MU affronte Anderlecht en coupe UEFA. Dans les rangs des Rouges jouent Scholes, Giggs, Silvestre et Beckham qui, au terme d’une chevauchée, délivre un centre parfait dans la surface belge. Grâce à un habile trucage, Bhamra s’élève et marque de la tête. Elle fête son but dans un stade en liesse et est félicitée par Beckham. Retour sur le plateau d’une émission de télé où Gary Linecker et ses invités commentent sa performance. Linecker demande à la mère, invitée de l’émission, si elle est fière de sa Jess : « Pas du tout ! » Coloré et savoureux, Bend It like Bechkam allie la culture du foot à l’anglaise à la culture indienne. C’est une petite bulle de fraîcheur qui illustre la lutte de Jess pour aller au bout de ses rêves.
LE DIABLE AU CORPS.- Récit d’une liaison entre un garçon de 15 ans et une femme dont le mari se bat sur le front durant la Première Guerre mondiale, Le diable au corps de Raymond Radiguet paraît en 1923 et provoque une levée des boucliers des anciens combattants. La mort prématurée, à 20 ans, de son auteur contribua à l’élaboration d’un mythe autour du livre… Plusieurs fois adapté à l’écran, on se souvient de la version sulfureuse de 1947 avec Gérard Philipe et Micheline Presle. Plus près de nous, l’Italien Marco Bellochio, avec Il diavolo in corpo, inscrit son récit dans l’Italie troublée des années de plomb. Pendant la tentative de suicide d’une femme, Andrea remarque Giulia, qui regarde la scène assise à une terrasse de café. Immédiatement amoureux de Giulia, il la suit jusqu’au tribunal où elle vient assister au procès de son fiancé Giacomo, un membre repenti des Brigades Rouges.
 A la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 1986, le film fait scandale. En cause une séquence de fellation réalisée par Maruschka Detmers, la première pour un film non pornographique « grand public ». Dans l’appartement où elle doit s’installer avec son fiancée à sa sortie de prison, la belle Giulia et Andrea (Federico Pitzalis) se poursuivent. Andrea finit sur le lit, rejoint par Giulia. Tandis qu’il disserte sur un voyage de Lénine en Suisse et sur le rôle de l’horlogerie helvétique, elle ouvre sa baguette en riant de manière hystérique… Les 45 secondes de la scène ont alimenté la polémique classique entre provocation gratuite et respect de la liberté artistique…
A la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 1986, le film fait scandale. En cause une séquence de fellation réalisée par Maruschka Detmers, la première pour un film non pornographique « grand public ». Dans l’appartement où elle doit s’installer avec son fiancée à sa sortie de prison, la belle Giulia et Andrea (Federico Pitzalis) se poursuivent. Andrea finit sur le lit, rejoint par Giulia. Tandis qu’il disserte sur un voyage de Lénine en Suisse et sur le rôle de l’horlogerie helvétique, elle ouvre sa baguette en riant de manière hystérique… Les 45 secondes de la scène ont alimenté la polémique classique entre provocation gratuite et respect de la liberté artistique…
CHANTONS SOUS LA PLUIE.- Classé première plus grande comédie musicale du cinéma par l’American Film Institute, Singin’ in the Rain fut confié, en 1951, par le producteur Arthur Freed au duo Stanley Donen – Gene Kelly qui venaient de réussir Un jour à New York (1949). Mais Chantons sous la pluie n’eut qu’un succès modeste et n’acquit son statut de monument du musical que plus tard. Située après la sortie du fameux Chanteur de jazz (1927), premier film parlant de l’histoire du 7e art, cette joyeuse évocation des coulisses des studios hollywoodiens met en scène le parcours de trois artistes (Gene Kelly, Debbie Reynolds et Donald O’Connor) aux prises avec les problèmes de la transition du muet au parlant.
 De nombreux beaux moments marquent le film. Mais le plus fameux est celui où, sur la chanson du titre écrite par Arthur Freed, Don chante et danse dans la rue sous une pluie battante. Il vient de ramener chez elle son amie Kathy et, amoureux, il s’en va dans la rue, jouant avec son parapluie, passant sous une grosse gouttière avant d’allègrement faire des claquettes dans les flaques. Un policier de passage interrompt le manège de Don qui s’éloigne en offrant son parapluie à un passant.
De nombreux beaux moments marquent le film. Mais le plus fameux est celui où, sur la chanson du titre écrite par Arthur Freed, Don chante et danse dans la rue sous une pluie battante. Il vient de ramener chez elle son amie Kathy et, amoureux, il s’en va dans la rue, jouant avec son parapluie, passant sous une grosse gouttière avant d’allègrement faire des claquettes dans les flaques. Un policier de passage interrompt le manège de Don qui s’éloigne en offrant son parapluie à un passant.
Globalement tourné en plan moyen avec quelques mouvements de grue, ce plan-séquence (4’35) découpé en huit parties inquiéta les actionnaires de la MGM à cause de son coût puisqu’il fallut construire un système de tuyauterie dans le studio pour le transformer en douche géante. Et dire que, selon la légende d’Hollywood, Gene Kelly avait de la fièvre quand il tourna cette séquence !
LE CORNIAUD.- Quand les temps sont moroses, rien de mieux qu’une comédie à la télé ! Dans ce domaine, Le corniaud tient le haut du pavé. Après, ne l’oublions pas, une brillante carrière dans les salles obscures. En 1965, le film réunit douze millions de spectateurs et Gérard Oury signe son plus gros succès public. Avant de récidiver l’année suivante avec les 17 millions de tickets vendus pour La grande vadrouille. Après avoir parcouru quelques dizaines de mètres sur la route des vacances, la 2 CV d’Antoine Maréchal (Bourvil) est fracassée par la Rolls de Léopold Saroyan, directeur d’une société d’import-export. D’abord de mauvaise foi, Saroyan (Louis de Funès) offre à Maréchal de poursuivre son voyage, tous frais payés, au volant d’une superbe Cadillac décapotable. Il devra conduire l’américaine de Naples à Bordeaux où elle doit partir pour les USA. Commence une aventure où l’on constatera que Maréchal n’est pas le corniaud que l’on croit.
 La fameuse scène de la collision entre la 2 CV et la Rolls, place Ste Geneviève à Paris, est située tout au début du film… même si elle fut la dernière à être tournée. Fin spécialiste des effets spéciaux, Pierre Durin avait découpé la Deuche en pas moins de 250 morceaux avant de la reconstituer en fixant les morceaux avec des crochets. Au moment opportun, 250 boulons électriques ont permis à la voiture d’exploser complètement. Au volant lors de l’unique prise, Bourvil improvise la réplique : « Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien ! » Surpris, De Funès est obligé de se tourner pour qu’on ne remarque pas son rire.
La fameuse scène de la collision entre la 2 CV et la Rolls, place Ste Geneviève à Paris, est située tout au début du film… même si elle fut la dernière à être tournée. Fin spécialiste des effets spéciaux, Pierre Durin avait découpé la Deuche en pas moins de 250 morceaux avant de la reconstituer en fixant les morceaux avec des crochets. Au moment opportun, 250 boulons électriques ont permis à la voiture d’exploser complètement. Au volant lors de l’unique prise, Bourvil improvise la réplique : « Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien ! » Surpris, De Funès est obligé de se tourner pour qu’on ne remarque pas son rire.
SCARFACE.- Libre adaptation du thriller (1932) de Howard Hawks, Scarface (1983) va devenir un film culte et l’un des plus « excessifs » de Brian de Palma, qui revendique le terme pour ce qu’il qualifie de « métaphore de la folie » autour du thème de l’avidité. Tueur cubain mégalomane, Tony Montana profite de l’ouverture des frontières par Fidel Castro en mai 1980, pour débarquer, plein d’ambition, en Floride. D’abord au service d’un caïd de la drogue, Tony va se faire sa place en tuant le caïd et en épousant sa femme. Parvenu au sommet, il devient totalement paranoïaque et succombe à la drogue.
Sur un scénario d’Oliver Stone, De Palma travaille pour la première fois avec Al Pacino. Ensemble, ils signent un vrai moment de la pop culture qui connaîtra un imposant succès mais provoquera des polémiques à cause da sa violence. Filmée sur un rythme effréné, la scène la plus fameuse du film a d’ailleurs été censuré par De Palma pour éviter le classement X pour violence.
 Dans la salle de bains d’un petit motel de Miami, Tony Montana est en mauvaise posture. Une arme enfoncée dans la joue, une chaîne autour du cou, le regard halluciné, il est aux mains de dealers colombiens. Avec une tronçonneuse, ceux-ci massacrent un complice de Montana. Le sang gicle sur les rideaux de douche (clin d’œil à Sir Alfred par un fan absolu). Dans la chambre, la télé diffuse Tremblement de terre de Mark Robson dont le bruit couvre celui de la tronçonneuse. Libéré par ses hommes au prix d’un autre bain de sang, Montana poursuit le trafiquant blessé dans la rue et l’abat d’une balle en pleine tête…
Dans la salle de bains d’un petit motel de Miami, Tony Montana est en mauvaise posture. Une arme enfoncée dans la joue, une chaîne autour du cou, le regard halluciné, il est aux mains de dealers colombiens. Avec une tronçonneuse, ceux-ci massacrent un complice de Montana. Le sang gicle sur les rideaux de douche (clin d’œil à Sir Alfred par un fan absolu). Dans la chambre, la télé diffuse Tremblement de terre de Mark Robson dont le bruit couvre celui de la tronçonneuse. Libéré par ses hommes au prix d’un autre bain de sang, Montana poursuit le trafiquant blessé dans la rue et l’abat d’une balle en pleine tête…
LE JOUR SE LEVE.- Dans un immeuble de Boulogne-Billancourt, dans la banlieue parisienne, après une discussion orageuse entre deux hommes, un coup de feu éclate… François, ouvrier sableur dans une usine, vient de tuer Valentin, artiste de cabaret et séducteur cynique. Au comble du désespoir, François se réfugie dans sa chambre sous les toits. Il refuse de se rendre. La police assiège les lieux alors que François s’est barricadé. Pendant la nuit, François (Jean Gabin) se souvient des événements qui l’ont conduit au drame…
Œuvre majeure du patrimoine français, Le jour se lève est à la fois, un fleuron du réalisme poétique et l’apogée du film de studio où tout est reconstitué pour obtenir les effets et l’émotion recherchés. Pour son dernier film d’avant guerre (1939), Marcel Carné retrouve Jacques Prévert au scénario et Jean Gabin en vedette après Quai des Brumes (1938). Du point de vue stylistique, le cinéaste innove pour ce drame de la fatalité avec une série de grands flash-backs.
 Construit par le grand Alexandre Trauner, le décor de la chambre comporte les quatre murs (et non trois comme il était de coutume) pour autoriser des plans circulaires et souligner l’enfermement. Alors que l’aube pointe, François tourne dans la chambre. Il se voit dans un miroir qu’il fracasse avec une chaise. Il va à sa fenêtre. La foule est massée devant l’immeuble. « Qu’est-ce que vous guettez, tous ? » lance-t-il. En colère, les poings fermés, il crie : « Foutez le camp. Laissez-moi seul. Foutez-moi la paix. Je suis fatigué. Y’a plus de François ! » Le drame est joué. La fin est désormais proche.
Construit par le grand Alexandre Trauner, le décor de la chambre comporte les quatre murs (et non trois comme il était de coutume) pour autoriser des plans circulaires et souligner l’enfermement. Alors que l’aube pointe, François tourne dans la chambre. Il se voit dans un miroir qu’il fracasse avec une chaise. Il va à sa fenêtre. La foule est massée devant l’immeuble. « Qu’est-ce que vous guettez, tous ? » lance-t-il. En colère, les poings fermés, il crie : « Foutez le camp. Laissez-moi seul. Foutez-moi la paix. Je suis fatigué. Y’a plus de François ! » Le drame est joué. La fin est désormais proche.
LE CUIRASSE POTEMKINE.- « Tragédie en cinq actes » selon les propres termes de Serge Eisenstein, le second film du réalisateur russe (1898-1948) est à l’origine une commande destinée à commémorer le 20e anniversaire de la révolution en relatant un grand nombre d’événements de l’année 1905. S’il s’agit donc d’une œuvre didactique, le cinéaste a gardé une grande liberté de création artistique. Comme Eisenstein eut quatre mois pour tourner et monter son film, il décida de réduire son scénario de départ, une copieuse « monographie d’une époque », en centrant l’action sur un seul épisode : la mutinerie des matelots d’un navire de guerre en mer Noire, près du port d’Odessa, le 27 juin 1905.
 Figurant dans différents classements comme « le meilleur film de tous les temps », Le cuirassé Potemkine, drame historique muet, sorti en 1925 est célèbre pour la séquence (six minutes) du massacre de civils sur les marches de l’escalier monumental d’Odessa. Eisenstein alterne les plans larges de la foule dévalant l’escalier et des soldats en rang tirant sur eux. Il y introduit des gros plans de victimes et notamment celui d’une jeune femme au foulard noir, blessée au ventre, qui, dans sa chute, lâche le landau de son bébé sur les marches. Un travelling avant en plongée, révolutionnaire pour l’époque. Longtemps interdit dans de nombreux pays occidentaux pour cause de « propagande bolchevique », Potemkine est entré dans la légende du 7e art. Le landau dévalant l’escalier appartient à la culture populaire. Brian de Palma lui rendit, par exemple, un bel hommage dans Les incorruptibles (1987).
Figurant dans différents classements comme « le meilleur film de tous les temps », Le cuirassé Potemkine, drame historique muet, sorti en 1925 est célèbre pour la séquence (six minutes) du massacre de civils sur les marches de l’escalier monumental d’Odessa. Eisenstein alterne les plans larges de la foule dévalant l’escalier et des soldats en rang tirant sur eux. Il y introduit des gros plans de victimes et notamment celui d’une jeune femme au foulard noir, blessée au ventre, qui, dans sa chute, lâche le landau de son bébé sur les marches. Un travelling avant en plongée, révolutionnaire pour l’époque. Longtemps interdit dans de nombreux pays occidentaux pour cause de « propagande bolchevique », Potemkine est entré dans la légende du 7e art. Le landau dévalant l’escalier appartient à la culture populaire. Brian de Palma lui rendit, par exemple, un bel hommage dans Les incorruptibles (1987).
VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER.- « Je ne m’intéresse pas à la politique. Le film ne parle pas de l’Amérique ou du Viêt Nam. C’est l’histoire d’un groupe d’un amis, d’une famille et de la façon dont ils survivent à une tragédie… » Michael Cimino (1939-2016) parle ainsi de The Deer Hunter, le premier de ses chefs d’œuvre avant La porte du paradis (1980) et L’année du dragon (1985).
Premier film américain traitant de la guerre du Viêt Nam, de son traumatisme et des impacts psychologiques qu’elle a engendrés, Voyage au bout de l’enfer (1977) raconte l’amitié de Mike, Nick et Steven, trois ouvriers américains d’origine lituanienne qui, en 1968, quittent Clairton, petite ville sidérurgique de Pennsylvanie pour aller combattre au Viêt Nam.
 Imposant succès critique et commercial, Voyage…, drame-fleuve de plus de trois heures, a également obtenu cinq Oscars dont celui de meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur dans un second rôle pour Christopher Walken. Le film a fait polémique à cause de la scène de roulette russe, critiquée car aucun cas n’aurait été attesté durant cette guerre. Dans une cabane, les geôliers vietcong, en pariant sur eux, forcent leurs prisonniers à s’affronter à la roulette russe, un revolver avec une balle dans le barillet sur la tempe. Dans une succession de champs/contre champs sur Robert de Niro (Mike) et Christopher Walken (Nick), Cimino capte une tension extrême qui se lit notamment dans les yeux des deux acteurs. D’autant que les gifles distribuées par les geôliers n’étaient pas feintes et augmentaient encore le stress sur le tournage…
Imposant succès critique et commercial, Voyage…, drame-fleuve de plus de trois heures, a également obtenu cinq Oscars dont celui de meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur dans un second rôle pour Christopher Walken. Le film a fait polémique à cause de la scène de roulette russe, critiquée car aucun cas n’aurait été attesté durant cette guerre. Dans une cabane, les geôliers vietcong, en pariant sur eux, forcent leurs prisonniers à s’affronter à la roulette russe, un revolver avec une balle dans le barillet sur la tempe. Dans une succession de champs/contre champs sur Robert de Niro (Mike) et Christopher Walken (Nick), Cimino capte une tension extrême qui se lit notamment dans les yeux des deux acteurs. D’autant que les gifles distribuées par les geôliers n’étaient pas feintes et augmentaient encore le stress sur le tournage…
JEANNE DIELMAN 23, QUAI DU COMMERCE 1080 BRUXELLES.- Installée dans un quotidien à horaire fixe, la Bruxelloise Jeanne Dielman, mère d’un garçon de 16 ans, veuve et encore jeune, se prostitue, sur rendez-vous, chez elle. Jeanne Dielman s’est enfermée dans une vie sans plaisir jusqu’au jour où il s’impose. « Je me retournais dans mon lit, inquiète. Et brusquement, en une seule minute, j’ai tout vu Jeanne Dielman… » En 1989, Chantal Ackerman (1950-2015) évoque ainsi ce film qui fera d’elle une cinéaste reconnue. Cette évocation méticuleuse d’une femme enfermée dans un rituel a été considérée comme le « premier chef-d’œuvre au féminin de l’Histoire du cinéma ». Coup de génie, la cinéaste belge engage Delphine Seyrig, grande dame du 7e art, qu’on n’avait pas l’habitude de voir faire son lit ou sa vaisselle. Si l’on sait que la relation de Chantal Ackerman au judaïsme traverse toute sa filmographie, on mesure mieux la part du rituel dans cette tragédie antique (1975). Un rituel qui apporte une sorte de paix. Car à chaque minute, elle sait ce qu’elle va faire dans la minute d’après. Jusqu’à cette heure « libre » qui va bouleverser son existence.
 Audacieux sur le plan formel, Jeanne Dielman travaille, au long de ses 201 minutes, l’illusion du temps réel. La dernière séquence est un long plan fixe, en demi-ensemble, sur Jeanne assise à la table de son salon. Sur les vitres du buffet derrière elle, on voit le mouvement bleuté des girophares de la police. Sans un mot prononcé, les yeux parfois clos, la tête penchée, Jeanne Dielman esquisse un léger sourire. De multiples émotions semblent la traverser. Restent les traces de sang sur sa chemise blanche et sa main. Cut.
Audacieux sur le plan formel, Jeanne Dielman travaille, au long de ses 201 minutes, l’illusion du temps réel. La dernière séquence est un long plan fixe, en demi-ensemble, sur Jeanne assise à la table de son salon. Sur les vitres du buffet derrière elle, on voit le mouvement bleuté des girophares de la police. Sans un mot prononcé, les yeux parfois clos, la tête penchée, Jeanne Dielman esquisse un léger sourire. De multiples émotions semblent la traverser. Restent les traces de sang sur sa chemise blanche et sa main. Cut.
INGLOURIOUS BASTERDS.- En 1941, dans une ferme tenue par Perrier Lapadite près de Nancy, le colonel SS Hans Landa débarque avec ses hommes. Surnommé « le chasseur de Juifs », Landa évoque, avec le fermier, la rumeur affirmant qu’une famille de Juifs serait cachée dans la région… Film de guerre uchronique présenté à Cannes 2009, Inglourious Basterds est, pour Quentin Tarantino, « une fable sur le thème du cinéma qui a le pouvoir de modifier le cours de l’Histoire ». Le titre, avec ses deux fautes d’orthographe volontaires, est un hommage tout à la fois à l’italien Inglorious Bastards (1978) et à l’américain Douze salopards (1967).
 La scène d’ouverture permet à Tarantino de mêler, avec un art consommé, humour, tension, violence et angoisse. Il offre aussi au comédien autrichien Christoph Waltz l’occasion d’une étonnante performance en SS cultivé, polyglotte et suave. Alternant plans d’ensemble extérieurs et gros plans en intérieur, Tarantino filme Landa s’entretenant à bâtons rompus avec Lapadite, saluant la beauté de ses filles et réclamant un verre de lait qu’il avale d’un trait avant de faire entrer ses hommes qui arrosent le sol de la ferme avec leurs mitraillettes. A travers le plancher troué, on aperçoit une jeune fille (Mélanie Laurent) qui court. Cadrée dans l’embrasure de la porte, elle fuit dans un paysage verdoyant. Contre-champ sur Landa qui sort son arme. Lentement, il vise mais renonce à tirer. Avec un sourire gourmand, il crie : « Au revoir Shochanna ! »
La scène d’ouverture permet à Tarantino de mêler, avec un art consommé, humour, tension, violence et angoisse. Il offre aussi au comédien autrichien Christoph Waltz l’occasion d’une étonnante performance en SS cultivé, polyglotte et suave. Alternant plans d’ensemble extérieurs et gros plans en intérieur, Tarantino filme Landa s’entretenant à bâtons rompus avec Lapadite, saluant la beauté de ses filles et réclamant un verre de lait qu’il avale d’un trait avant de faire entrer ses hommes qui arrosent le sol de la ferme avec leurs mitraillettes. A travers le plancher troué, on aperçoit une jeune fille (Mélanie Laurent) qui court. Cadrée dans l’embrasure de la porte, elle fuit dans un paysage verdoyant. Contre-champ sur Landa qui sort son arme. Lentement, il vise mais renonce à tirer. Avec un sourire gourmand, il crie : « Au revoir Shochanna ! »
Réfugiée à Paris sous une nouvelle identité, Shochanna Dreyfus finira par lui rendre la monnaie de sa pièce…
DRIVE.- Choisi pour être le chauffeur de Drive, Ryan Gosling se voit confier, par les producteurs, le choix du réalisateur. Il conseille Nicolas Winding Refn dont il est fan. Le cinéaste rencontre Gosling au cours d’un repas pour parler de Drive, mais Refn est grippé et son absence de conversation provoque un réel malaise. Gosling raccompagne NWR chez lui en voiture. Pendant le trajet, l’acteur allume la radio pour pallier le silence ambiant. Celle-ci passe Can’t Fight This Feeling de REO Speedwagon, Refn se met à pleurer et dit : « On va faire un film sur un type qui conduit dans Los Angeles en écoutant de la musique pop parce que c’est sa soupape émotionnelle ! »
Prix de la mise en scène à Cannes 2011, Drive lance la carrière du cinéaste danois qui a structuré son thriller à la manière d’un conte des frères Grimm, avec un début dépouillé et pur qui bascule vers du noir au ton psychotique.
 Cascadeur de cinéma le jour, il est chauffeur la nuit pour des truands. On le retrouve au volant d’une Chevrolet Impala, attendant que ses employeurs aient achevé le braquage d’un entrepôt. Il file ensuite à travers à Los Angeles. Mais, à l’inverse des poursuites classiques, le chauffeur (régulièrement filmé en gros plan, une allumette dans la bouche) est d’une prudence de sioux, respectant les feux, se cachant sous un pont pour échapper au phare d’un hélicoptère… Dans une mise en scène stylisée, avec de nombreuses plongées sur la ville la nuit, Refn installe d’emblée une atmosphère hypnotique. Qui sera contredite ensuite par une violente descente aux enfers…
Cascadeur de cinéma le jour, il est chauffeur la nuit pour des truands. On le retrouve au volant d’une Chevrolet Impala, attendant que ses employeurs aient achevé le braquage d’un entrepôt. Il file ensuite à travers à Los Angeles. Mais, à l’inverse des poursuites classiques, le chauffeur (régulièrement filmé en gros plan, une allumette dans la bouche) est d’une prudence de sioux, respectant les feux, se cachant sous un pont pour échapper au phare d’un hélicoptère… Dans une mise en scène stylisée, avec de nombreuses plongées sur la ville la nuit, Refn installe d’emblée une atmosphère hypnotique. Qui sera contredite ensuite par une violente descente aux enfers…
LA SOIF DU MAL.- Lorsqu’il tourne, en 1957, ce sommet du baroque wellesien qu’est Touch of Evil, Orson Welles ne sait pas encore que c’est là son ultime opus hollywoodien. On ignore si le cinéaste a été imposé aux studios Universal (qui craignait que le film soit un gouffre financier) par Charlton Heston qui incarne le policier mexicain Mike Vargas ou par le producteur Albert Zugsmith… Toujours est-il que Welles, lors du premier jour de tournage, met en boîte l’équivalent de quatre jours de tournage et se met Universal dans la poche. Moins surveillé par les financiers du studio, Welles peut déplacer son équipe en extérieurs. C’est à Venice (Californie) qu’il met notamment en scène la formidable séquence qui ouvre ce thriller sur un monde en déconfiture.
 Une bombe a explosé dans le secteur américain de Los Robles, ville-frontière imaginaire. En voyage de noces avec sa jeune épouse Susan (Janet Leigh), le policier mexicain Mike Vargas se lance dans l’enquête et découvre les méthodes peu recommandables de son homologue, Hank Quinlan (Welles épatant). Bientôt Vargas et Susan sont pris au piège entre une police locale corrompue et les gangs de la région… D’entrée, Welles décide de régaler le spectateur par une prouesse technique. La soif… démarre par un long plan-séquence (3 mn 20 s.) avec des mouvements de grue aussi complexes que virtuoses. On y suit une double progression dans la nuit de la cité mexicaine. D’une part, avec le trajet d’une voiture piégée vers un poste-frontière, de l’autre, avec la déambulation à pied du couple Vargas. Un plan-séquence culte !
Une bombe a explosé dans le secteur américain de Los Robles, ville-frontière imaginaire. En voyage de noces avec sa jeune épouse Susan (Janet Leigh), le policier mexicain Mike Vargas se lance dans l’enquête et découvre les méthodes peu recommandables de son homologue, Hank Quinlan (Welles épatant). Bientôt Vargas et Susan sont pris au piège entre une police locale corrompue et les gangs de la région… D’entrée, Welles décide de régaler le spectateur par une prouesse technique. La soif… démarre par un long plan-séquence (3 mn 20 s.) avec des mouvements de grue aussi complexes que virtuoses. On y suit une double progression dans la nuit de la cité mexicaine. D’une part, avec le trajet d’une voiture piégée vers un poste-frontière, de l’autre, avec la déambulation à pied du couple Vargas. Un plan-séquence culte !
PAS DE PRINTEMPS POUR MARNIE.- En 1960, après Psychose, Alfred Hitchcock s’intéresse à Marnie, un roman de Winston Graham et songe à confier le rôle de cette kleptomane frigide à Grace Kelly, la princesse de Monaco ayant manifesté son désir de revenir sur les plateaux. Mais Grace Kelly devra faire machine arrière. Hitch tourne alors Les oiseaux, y dirige Tippi Hedren et remet Marnie sur l’ouvrage…
A propos de Marnie, François Truffaut évoque un « grand film malade », parlant de « chef d’œuvre avorté, d’entreprise ambitieuse souffrant d’erreurs de parcours ». Il semble surtout que Sir Alfred se soit désintéressé du projet en cours de tournage, dès le moment où les relations ont été rompues avec Tippi Hedren à laquelle le cinéaste avait fait des avances sexuelles inadmissibles.
 Marnie (1964) contient pourtant des séquences exemplaires de la notion de suspense selon Hitchcock. Ainsi, la scène (43e) où Marnie cambriole le coffre de la société Rutland. Dans le même plan d’ensemble, Hitch réunit à droite Marnie s’affairant sur le coffre, à gauche, une femme de ménage qui arrive, tirant son seau et son balai. Pour pouvoir filer sans se faire remarquer, Marnie retire ses chaussures et les glisse dans les poches de son manteau. Gros plan sur un escarpin qui glisse doucement et tombe au sol avec un bruit retentissant. On s’attend à une réaction de la femme de ménage mais elle ne bronche pas. Marnie s’enfuit juste avant l’arrivée du veilleur de nuit qui s’approche de la femme de ménage et lui crie dans les oreilles. Elle est sourde et n’a rien entendu…
Marnie (1964) contient pourtant des séquences exemplaires de la notion de suspense selon Hitchcock. Ainsi, la scène (43e) où Marnie cambriole le coffre de la société Rutland. Dans le même plan d’ensemble, Hitch réunit à droite Marnie s’affairant sur le coffre, à gauche, une femme de ménage qui arrive, tirant son seau et son balai. Pour pouvoir filer sans se faire remarquer, Marnie retire ses chaussures et les glisse dans les poches de son manteau. Gros plan sur un escarpin qui glisse doucement et tombe au sol avec un bruit retentissant. On s’attend à une réaction de la femme de ménage mais elle ne bronche pas. Marnie s’enfuit juste avant l’arrivée du veilleur de nuit qui s’approche de la femme de ménage et lui crie dans les oreilles. Elle est sourde et n’a rien entendu…
LES DIABOLIQUES.- En ce temps-là, on ne parlait pas de spoiler… Mais il convient toujours de ne pas en dire trop sur la chute, plutôt inattendue et, quand même légèrement grandguignolesque, du film. En 1955, Henri-Georges Clouzot s’attèle à une adaptation de Celle qui n’était plus, le roman policier de Boileau et Narcejac paru chez Denoël en 1952.
Christina (Vera Clouzot) mène une existence malheureuse auprès de son mari, Michel Delasalle (Paul Meurisse), directeur tyrannique et cruel d’un pensionnat de garçons. Elle sait qu’une des institutrices, Nicole Horner (Simone Signoret) est la maîtresse officielle de Delasalle mais cela n’empêche pas les deux femmes de se rapprocher. Excédée par les humiliations publiques et les coups, Christina voit en effet en Nicole une compagne d’infortune qui partage avec elle sa haine envers Michel. Lorsque Nicole demande à Christina de l’aider à tuer leur compagnon, celle-ci, très pieuse, est réticente. Mais, minée par les abus supportés depuis trop longtemps, elle accepte. Les ennuis commencent tandis que Christina est tourmentée par d’étranges événements semblant provenir d’outre-tombe.
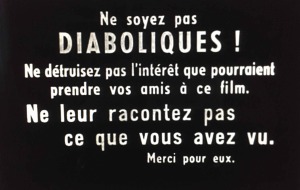 Dans ce thriller teinté de surnaturel qui sera un gros succès (3,7 millions de spectateurs), Clouzot organise un troublant suspense autour des violences conjugales. Juste après les deux retournements finaux, le cinéaste a placé, au début du générique de fin, un carton (voir ci-contre) qui invite les spectateurs à ne pas les divulgâcher. Hitchcock reprendra l’idée de l’avertissement, cinq ans plus tard, pour Psychose.
Dans ce thriller teinté de surnaturel qui sera un gros succès (3,7 millions de spectateurs), Clouzot organise un troublant suspense autour des violences conjugales. Juste après les deux retournements finaux, le cinéaste a placé, au début du générique de fin, un carton (voir ci-contre) qui invite les spectateurs à ne pas les divulgâcher. Hitchcock reprendra l’idée de l’avertissement, cinq ans plus tard, pour Psychose.
GOLDFINGER.- Plus le méchant est réussi, meilleur est le film… C’était l’avis d’Alfred Hitchcock qui en connaissait un rayon sur le sujet… Dans la grande famille des méchants de cinéma, un certain Oddjob occupe une place de choix. On le rencontre dans Goldfinger, le troisième épisode des aventures de James Bond au cinéma. C’était en 1964 et Sean Connery en 007, pouvait constater : « Il y a des choses qui ne se font pas, telles que de boire du Dom Pérignon 55 à une température au-dessus de trois degrés et écouter les Beatles sans boules Quiès. »
Oddjob, lui, n’a que faire du champagne. Le rôle de l’homme de main coréen est de veiller au bien-être d’Auric Goldfinger, milliardaire obsédé par l’or, notamment celui de Fort Knox. C’est le comédien japonais Harold Sakata (1920-1982) qui incarne le garde du corps. Les producteurs Saltzman et Broccoli avaient répéré Sakata alors qu’il était catcheur professionnel après une carrière d’haltérophile qui lui avait valu une médaille d’argent aux JO de Londres en 1948.
 La plus belle scène que le réalisateur Guy Hamilton consacre à Oddjob se déroule sur le parcours de golf où Bond et Goldfinger (Gert Froebe) s’affrontent. L’atmosphère n’est courtoise qu’en apparence. Car Goldfinger a vite compris que Bond ne lui veut pas de bien. Pour se faire comprendre, Goldfinger demande à son nervi de montrer ses talents. Oddjob enlève alors son chapeau melon cerclé de métal et, tel un boomerang, l’envoie, d’un geste sûr, décapiter une statue antique. Hélas, le couvre-chef métallique sera in fine fatal à Oddjob qui finira électrisé…
La plus belle scène que le réalisateur Guy Hamilton consacre à Oddjob se déroule sur le parcours de golf où Bond et Goldfinger (Gert Froebe) s’affrontent. L’atmosphère n’est courtoise qu’en apparence. Car Goldfinger a vite compris que Bond ne lui veut pas de bien. Pour se faire comprendre, Goldfinger demande à son nervi de montrer ses talents. Oddjob enlève alors son chapeau melon cerclé de métal et, tel un boomerang, l’envoie, d’un geste sûr, décapiter une statue antique. Hélas, le couvre-chef métallique sera in fine fatal à Oddjob qui finira électrisé…
LA DOLCE VITA.- Conçue à la demande du pape Clément XII et réalisée entre 1732 et 1762, la fontana di Trevi est la plus grande fontaine de Rome. Le cinéma lui a fait la part belle, de Vacances romaines (1953) de Wyler à Nous nous sommes tant aimés (1974) de Scola où les héros du film assistent… au tournage de la fameuse séquence du film de Fellini… Car c’est bien le maître de Rimini qui a fait entrer en 1960 la fontaine dans l’histoire du 7e art avec la séquence qui voit Anita Ekberg, alias « la bombe suédoise », se baigner dans l’eau de la claire fontaine… La sculpturale Anita n’était pas le premier choix de Fellini mais le cinéaste la choisit cependant, la jugeant « phosphorescente ».
 A travers de petits épisodes, La dolce vita suit, au fil d’une semaine de vie mondaine, le journaliste people Marcello Rubini. Sous le charme de la star Sylvia Rank, Marcello cherche vainement un lieu pour être seule avec elle. Ils finissent par errer, de nuit, dans les ruelles de Rome. Ayant recueilli un chaton blanc qu’elle promène sur sa tête, Sylvia envoie Marcello (Marcello Mastroianni) lui chercher du lait. Lorsque celui-ci revient, il voit l’actrice qui s’est avancée, toute habillée, dans la fontaine de Trevi. Elle l’appelle : « Marcello ! Come here ! » Il finit par l’y rejoindre. Devant la cascade, dans la rumeur de l’eau, elle a les yeux clos. Marcello souffle : « Qui es-tu ? », s’apprête à l’embrasser. L’eau de la cascade s’est arrêtée. Le jour se lève. Un livreur à vélo les observe au loin, quittant le bassin. La dolce vita fit scandale à sa sa sortie et remporta la Palme d’or à Cannes 1960.
A travers de petits épisodes, La dolce vita suit, au fil d’une semaine de vie mondaine, le journaliste people Marcello Rubini. Sous le charme de la star Sylvia Rank, Marcello cherche vainement un lieu pour être seule avec elle. Ils finissent par errer, de nuit, dans les ruelles de Rome. Ayant recueilli un chaton blanc qu’elle promène sur sa tête, Sylvia envoie Marcello (Marcello Mastroianni) lui chercher du lait. Lorsque celui-ci revient, il voit l’actrice qui s’est avancée, toute habillée, dans la fontaine de Trevi. Elle l’appelle : « Marcello ! Come here ! » Il finit par l’y rejoindre. Devant la cascade, dans la rumeur de l’eau, elle a les yeux clos. Marcello souffle : « Qui es-tu ? », s’apprête à l’embrasser. L’eau de la cascade s’est arrêtée. Le jour se lève. Un livreur à vélo les observe au loin, quittant le bassin. La dolce vita fit scandale à sa sa sortie et remporta la Palme d’or à Cannes 1960.
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY.- A quoi tient une bonne publicité ! Posez donc la question aux propriétaires du Katz’s Delicatessen de New York… C’est en effet dans ce (déjà) célèbre restaurant que Rob Reiner tourne en 1989, la scène sans doute la plus fameuse de son film. Et c’est là que des milliers de touristes de Big Apple sont venus contempler la table du Deli de Houston Steet où tournèrent Meg Ryan et Billy Crystal.
A la fin des années 70, Harry et Sally ont fini leurs études à Chicago. Ils partent pour New York afin d’entrer dans la vie active. Mais leur relation est conflictuelle et va le rester longtemps. Pourtant, douze ans et trois mois après leur première rencontre, ils finiront par se marier…
 When Harry Met Sally s’est imposé comme un fleuron de la comédie romantique tout en étant considéré comme l’un des films les plus drôles du cinéma américain. En train de déjeuner, les deux discutent de la capacité d’un homme à savoir quand une femme simule l’orgasme. Sally prétend que les hommes ne peuvent pas faire la différence et, pour le prouver, elle simule l’orgasme en plein restaurant. La scène s’achève lorsque Sally retourne calmement à son repas tandis qu’une cliente assez âgée attablée non loin (Estelle Reiner, la propre mère du cinéaste) lance à la serveuse : « Donnez-moi la même chose qu’elle ».
When Harry Met Sally s’est imposé comme un fleuron de la comédie romantique tout en étant considéré comme l’un des films les plus drôles du cinéma américain. En train de déjeuner, les deux discutent de la capacité d’un homme à savoir quand une femme simule l’orgasme. Sally prétend que les hommes ne peuvent pas faire la différence et, pour le prouver, elle simule l’orgasme en plein restaurant. La scène s’achève lorsque Sally retourne calmement à son repas tandis qu’une cliente assez âgée attablée non loin (Estelle Reiner, la propre mère du cinéaste) lance à la serveuse : « Donnez-moi la même chose qu’elle ».
Pour mettre ses comédiens dans l’ambiance et « décoincer » une Meg Ryan mal à l’aise, Rob Reiner mima la scène, poussant des cris, tapant sur la table. Las, cette démonstration en bonne et due forme n’a pas été mise en boîte.
PANIQUE.- De retour en Europe après une période américaine (1941-1944), Julien Duvivier doit mettre en scène Anna Karénine à Londres mais le film est retardé à la demande de Vivien Leigh. Il songe alors à se rabattre sur un projet qu’il pourra mener à bien plus vite. Il choisit d’adapter un roman noir de Georges Simenon, Les Fiançailles de M. Hire. Parce que, dit-il, il avait envie de se détourner des happy-ends hollywoodiens qu’il a connu pendant les années de guerre… De fait, Panique est un condensé des instincts les plus vils de la nature humaine… A Villejuif, aux portes de Paris, une vieille fille est retrouvée morte étranglée sur un terrain vague. La belle Alice dont l’amant, Alfred, est en réalité le coupable, fait dévier les soupçons sur le bizarre et presque inquiétant M. Hire…
Apre et amère, l’aventure tragique de cet homme solitaire reste l’œuvre la plus personnelle et la plus noire de Duvivier. Et l’un de ses échecs cuisants, accusé qu’il fut, en cette année 1946, de jouer « la carte de la défaite » !
 Au cœur d’une fête foraine (22e mn), Duvivier développe une métaphore du lynchage qui annonce la mort à venir de Hire. Celui-ci décide de faire un tour d’auto-tamponneuses. Comme pris d’une ivresse collective, tous les clients de l’attraction, sous l’impulsion d’Alice et Alfred, vont fondre sur Hire (l’immense Michel Simon), raide et impeccable dans sa voiturette au milieu de la piste. Par une accumulation de coupes de plus en plus rapides, Duvivier organise un chaos d’images et de sons qui génère une énergie de destruction. Le lynchage de Hire a déjà commencé…
Au cœur d’une fête foraine (22e mn), Duvivier développe une métaphore du lynchage qui annonce la mort à venir de Hire. Celui-ci décide de faire un tour d’auto-tamponneuses. Comme pris d’une ivresse collective, tous les clients de l’attraction, sous l’impulsion d’Alice et Alfred, vont fondre sur Hire (l’immense Michel Simon), raide et impeccable dans sa voiturette au milieu de la piste. Par une accumulation de coupes de plus en plus rapides, Duvivier organise un chaos d’images et de sons qui génère une énergie de destruction. Le lynchage de Hire a déjà commencé…
ALIEN.- « Dans les films que j’ai envie de faire, l’univers, le décor et le dépaysement ont une importance capitale. » En 1979, Ridley Scott réussit pleinement son coup avec Alien, le 8e passager, solide blockbuster (pour adultes !) et terrifiante odyssée interstellaire. En 2122, le vaisseau commercial Nostromo fait route vers la Terre lorsqu’un signal inconnu l’amène à se détourner vers une planète inconnue. L’officier Kane y sera victime d’une agression par une sorte d’arachnide qui se colle sur son visage…
 Dans le Nostromo, l’humeur est au beau fixe. Kane a été opéré et ne souffre apparemment d’aucune séquelle. L’équipage s’apprête à dîner lorsqu’une horrible créature dentée déchire brutalement le thorax de Kane avant de s’enfuir dans la coursive.
Dans le Nostromo, l’humeur est au beau fixe. Kane a été opéré et ne souffre apparemment d’aucune séquelle. L’équipage s’apprête à dîner lorsqu’une horrible créature dentée déchire brutalement le thorax de Kane avant de s’enfuir dans la coursive.
Cette séquence d’anthologie (à la 52e minute) a fait frissonner de peur les spectateurs. Les comédiens, Sigourney Weaver en tête, ne savent pas ce qu’ils s’apprêtent à tourner d’autant que le scénario ne contient que peu d’indications. Mais, sur le plateau, Ridley Scott et les techniciens portent des… imperméables. Il y a des seaux plein d’abats, « une odeur de formol effroyable » (dixit l’actrice Veronica Cartwright) et les cinq caméras sont enveloppées dans des toiles en plastique. Contrairement à la légende, la scène n’a pas été réalisée en une seule prise. De fait, elle est même très découpée et il faudra pas moins de trois bébés aliens différents pour obtenir les meilleurs effets. Enfin Scott jubile lorsque sa caméra capte les mouvements réflexes de ses comédiens abondamment aspergés, sans être prévenus, de sang (de synthèse)…
L’EXERCICE DE L’ETAT.- De Mister Smith au Sénat (1939) à Vice (2018) en passant par Les hommes du président (1976), Hollywood se penche souvent sur la vie politique américaine. En France, c’est beaucoup moins le cas, du moins dans le domaine de la fiction… C’est pourquoi le film de Pierre Schoeller a été largement remarqué à sa sortie en 2011. Sans aucune référence à une actualité politique, le film pose cependant un regard acéré et documenté sur la France contemporaine à travers le quotidien animé de Bertrand Saint-Jean, ministre des Transports (Olivier Gourmet) et de Gilles, son fidèle directeur de cabinet (Michel Blanc)…
 Le film a notamment frappé les esprits pour un impressionnant accident. Certes, les cascades automobiles ne manquent pas sur le grand écran mais Schoeller réussit une séquence forte aussi imprévisible que violente. Pour aller plus vite, la voiture du ministre a emprunté une autoroute en construction et fermée à la circulation. Sans que l’on sache pourquoi, la Peugeot qui fonce à travers une campagne paisible va faire une succession de tonneaux. On vit la scène d’abord de l’intérieur du véhicule où le ministre est ballotté dans tous les sens tandis qu’on entend des frottements de tôle, des bris de verre. Après les tonneaux, l’auto est filmée en travelling, glissant longuement sur le toit. Plan sur Gilles, qui était au téléphone, avec le ministre et qui comprend instantanément le drame. Dans la voiture, Saint-Jean semble entre la vie et la mort avant de réussir à s’extirper des tôles. Le silence règne. Plan large. Le corps, le bas de la jambe arrachée, du chauffeur, git au sol. Hagard, le ministre erre sur la route déserte.
Le film a notamment frappé les esprits pour un impressionnant accident. Certes, les cascades automobiles ne manquent pas sur le grand écran mais Schoeller réussit une séquence forte aussi imprévisible que violente. Pour aller plus vite, la voiture du ministre a emprunté une autoroute en construction et fermée à la circulation. Sans que l’on sache pourquoi, la Peugeot qui fonce à travers une campagne paisible va faire une succession de tonneaux. On vit la scène d’abord de l’intérieur du véhicule où le ministre est ballotté dans tous les sens tandis qu’on entend des frottements de tôle, des bris de verre. Après les tonneaux, l’auto est filmée en travelling, glissant longuement sur le toit. Plan sur Gilles, qui était au téléphone, avec le ministre et qui comprend instantanément le drame. Dans la voiture, Saint-Jean semble entre la vie et la mort avant de réussir à s’extirper des tôles. Le silence règne. Plan large. Le corps, le bas de la jambe arrachée, du chauffeur, git au sol. Hagard, le ministre erre sur la route déserte.
THE BIG LEBOWSKI.- Le film noir est le genre de prédilection des frères Coen. Mais le duo américain s’est toujours appliqué à revisiter, sous la forme du pastiche ou de l’hommage, les motifs du « noir ». En 1998, The Big Lebowski s’inscrit aussi dans cette relecture qui prend le chemin du détournement des codes : kidnapping, rançon, truands interlopes…
Bien malin qui pourrait résumer l’intrigue de cette comédie bouffonne. Disons que l’aventure commence lorsque Jeffrey Lebowski, alias Le Dude rentre chez lui après avoir acheté une brique de lait. Il est agressé par deux petites frappes qui lui demandent de rendre une forte somme d’argent. Rapidement, les voyous comprennent leur erreur: ils ont confondu le Dude, glandeur désinvolte, avec un autre Lebowski, millionnaire paraplégique, qui habite lui aussi Los Angelès. Mais le Dude est bien décidé à obtenir réparation d’un vrai préjudice : l’un des malfrats a uriné sur son tapis…
 Au cœur de ce film foisonnant, figure une séquence joyeusement récréative. Si cette évocation d’une partie de bowling semble gratuite par rapport à l’intrigue principale, elle permet d’en savoir plus sur l’amitié complexe entre le Dude (Jeff Bridges), Walter Sobchak (John Goodman) et Donny (Steve Buscemi). Car la partie de bowling dérape lorsqu’un adversaire mord la ligne et refuse d’être pénalisé. Préférant résoudre, depuis son retour du Vietnam, chaque situation par le conflit, Walter le braque avec une arme. Dans un découpage rapide, on mesure la brutalité envahissante de Walter, la passivité démissionnaire du Dude et le retrait apeuré de Donny…
Au cœur de ce film foisonnant, figure une séquence joyeusement récréative. Si cette évocation d’une partie de bowling semble gratuite par rapport à l’intrigue principale, elle permet d’en savoir plus sur l’amitié complexe entre le Dude (Jeff Bridges), Walter Sobchak (John Goodman) et Donny (Steve Buscemi). Car la partie de bowling dérape lorsqu’un adversaire mord la ligne et refuse d’être pénalisé. Préférant résoudre, depuis son retour du Vietnam, chaque situation par le conflit, Walter le braque avec une arme. Dans un découpage rapide, on mesure la brutalité envahissante de Walter, la passivité démissionnaire du Dude et le retrait apeuré de Donny…
APOCALYPSE NOW.- Transposition en pleine guerre du Viêt Nam, du roman Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, la fresque de Francis Ford Coppola appartient à la catégorie des « grands films malades » tant les conditions de financement, de préparation, de tournage, de distribution ont été éprouvantes, parfois ubuesques… Présenté au Festival de Cannes 1979 (comme Work in Progress), Apocalypse Now décroche la Palme d’or, ex-aequo avec Le tambour de Schlöndorff. En conférence de presse, le cinéaste déclare : « Apocalypse Now n’est pas un film sur le Viêt Nam, c’est le Viêt Nam. Et la façon dont nous avons réalisé Apocalypse Now ressemble à ce qu’étaient les Américains au Viêt Nam. Nous étions dans la jungle, nous étions trop nombreux, nous avions trop d’argent, trop de matériel et petit à petit, nous sommes devenus fous ».
 La séquence (sept minutes) qui a marqué les esprits est bien celle de l’attaque des hélicoptères aux accents de la Chevauchée des Walkyries de Richard Wagner. Pour accéder au repaire du sanguinaire colonel Kurtz (Marlon Brando), le capitaine Willard est escorté par une escadre d’hélicoptères dirigé par le colonel Kilgore (Robert Duvall). Celui-ci en profite pour lancer un raid sur un village et, en approche, il fait donner Wagner. Dans une alternance de plans d’ensemble sur les hélicoptères et de gros plans sur les soldats, Coppola dynamise une séquence où l’intensité de la musique va croissante, brutalement stoppée par un plan sur le village où l’on évacue une école… Et puis l’on entend à nouveau, au loin, le mélange des pales et de Wagner…
La séquence (sept minutes) qui a marqué les esprits est bien celle de l’attaque des hélicoptères aux accents de la Chevauchée des Walkyries de Richard Wagner. Pour accéder au repaire du sanguinaire colonel Kurtz (Marlon Brando), le capitaine Willard est escorté par une escadre d’hélicoptères dirigé par le colonel Kilgore (Robert Duvall). Celui-ci en profite pour lancer un raid sur un village et, en approche, il fait donner Wagner. Dans une alternance de plans d’ensemble sur les hélicoptères et de gros plans sur les soldats, Coppola dynamise une séquence où l’intensité de la musique va croissante, brutalement stoppée par un plan sur le village où l’on évacue une école… Et puis l’on entend à nouveau, au loin, le mélange des pales et de Wagner…
LA LA LAND.- Avec sa formation de batteur de jazz, Damien Chazelle cultive une prédilection pour les films musicaux. A 25 ans, le Franco-américain écrit le scénario de La La Land à une époque de sa vie –2009- où l’industrie du cinéma lui semble hors de portée. Son ambition est alors de « reprendre les éléments des comédies musicales de l’âge d’or, mais les ancrer dans la vie réelle, où tout ne se passe pas toujours comme prévu ». Mais il peine à trouver des financements, les studios étant réticents à l’idée de produire un musical contemporain. Finalement, le cinéaste décide de renoncer au film et écrit Whiplash, aventure d’un aspirant batteur de jazz aux prises avec un prof d’une terrible exigence. Le film gagnera beaucoup d’argent et obtiendra trois Oscars. Chazelle remet alors La La Land sur le métier. Le film sera un imposant succès en 2016.
 Sa scène d’ouverture est un morceau de bravoure ! Coincés dans leur voiture sur une autoroute de Los Angeles, Mia (Emma Stone) et Sebastian (Ryan Gosling) assistent à un grand moment de danse sur la chanson Another Day of Sun. Chazelle obtint de pouvoir bloquer une portion d’échangeur reliant deux autoroutes pendant une journée de répétition et deux jours de tournage avec plus de cent danseurs. La séquence (un faux plan-séquence réalisé en trois plans) devait être tournée à terre mais elle le fut sur l’échangeur même, à 30 mètres de hauteur pour permettre à Chazelle de montrer l’étendue de Los Angeles. Une Cité des anges où Chazelle lui-même est souvent coincé dans des bouchons sur l’autoroute…
Sa scène d’ouverture est un morceau de bravoure ! Coincés dans leur voiture sur une autoroute de Los Angeles, Mia (Emma Stone) et Sebastian (Ryan Gosling) assistent à un grand moment de danse sur la chanson Another Day of Sun. Chazelle obtint de pouvoir bloquer une portion d’échangeur reliant deux autoroutes pendant une journée de répétition et deux jours de tournage avec plus de cent danseurs. La séquence (un faux plan-séquence réalisé en trois plans) devait être tournée à terre mais elle le fut sur l’échangeur même, à 30 mètres de hauteur pour permettre à Chazelle de montrer l’étendue de Los Angeles. Une Cité des anges où Chazelle lui-même est souvent coincé dans des bouchons sur l’autoroute…
RIDICULE.- En mai 1996, Patrice Leconte fait l’ouverture du Festival de Cannes avec l’aventure de Grégoire Ponceludon de Malavoy, jeune aristocrate désargenté, qui se rend à Versailles pour obtenir des moyens d’assécher les marais de la Dombes, sources d’épidémies qui déciment ses paysans. Candide, il découvre la vie de la cour de Louis XVI où triomphent les mots d’esprit, si possible méchants. Au cœur de cette effervescence raffinée et décadente, le baron de Malavoy va vite se mettre à pratiquer l’esprit avec une vivacité sans égale pour se frayer un chemin au sein de la cour. Le marquis de Bellegarde lui prête main-forte en lui donnant le gîte et en soutenant ce Grégoire dont les talents sont désormais redoutés par les courtisans déjà installés… « Dans ce monde, un vice n’est rien mais un ridicule tue. »
 Dans cette comédie élégante mais grinçante (couronnée de quatre César), Leconte place une séquence qui orchestre la parade des courtisans voulant, pour gagner leur paradis, s’attirer les faveurs d’un roi, ce qui les conduit en enfer. Malavoy (Charles Berling) et Bellegarde (Jean Rochefort) patientent dans l’antichambre tandis que le roi scrute la salle à travers un judas dans un tableau. Lorsqu’un huissier lance l’appel de ceux qui auront le privilège de voir le roi, Leconte filme un baron endormi. Guéret fait antichambre depuis des mois. L’abbé de Villecourt lui joue un tour pendable. Il lui vole une chaussure et crie son nom. Guéret, chaussette trouée, se précipite. On le refoule. L’antichambre est désormais désertée. Bellegarde ramène Guéret. Dont le destin sera funeste…
Dans cette comédie élégante mais grinçante (couronnée de quatre César), Leconte place une séquence qui orchestre la parade des courtisans voulant, pour gagner leur paradis, s’attirer les faveurs d’un roi, ce qui les conduit en enfer. Malavoy (Charles Berling) et Bellegarde (Jean Rochefort) patientent dans l’antichambre tandis que le roi scrute la salle à travers un judas dans un tableau. Lorsqu’un huissier lance l’appel de ceux qui auront le privilège de voir le roi, Leconte filme un baron endormi. Guéret fait antichambre depuis des mois. L’abbé de Villecourt lui joue un tour pendable. Il lui vole une chaussure et crie son nom. Guéret, chaussette trouée, se précipite. On le refoule. L’antichambre est désormais désertée. Bellegarde ramène Guéret. Dont le destin sera funeste…
L’AVENTURE DE MADAME MUIR.- Au début du 20e siècle à Londres, un an après la mort de son mari, Lucy Muir annonce à sa belle-famille qu’elle part, avec sa fille Anna et sa servante Martha, vivre au bord de la mer, ce dont elle a toujours rêvé. Malgré les mises en garde d’un agent immobilier, Lucy loue Gull Cottage qui a la réputation d’être hanté par son dernier propriétaire, le capitaine Daniel Gregg dont le portrait trône dans la demeure. De fait, le fantôme vient l’observer alors qu’elle dort, puis tente de l’effrayer une nuit de pluie et d’orage. Mais, séduit par son entêtement, Gregg accepte qu’elle reste à l’essai…
La principale difficulté de The Gost and Mrs Muir (1947) consistait, pour Joseph L. Mankiewicz, à traiter d’une pure romance entre une jeune femme (Gene Tierney) et un fantôme (Rex Harrison) dans un contexte romantique mais rendu crédible, voire naturel au spectateur…
 La mort est au cœur de chaque film de Mankiewicz et la scène finale est remarquable à cet égard. Après avoir regardé la mer depuis son balcon, Lucy Muir, devenue une vieille dame aux cheveux blancs, s’est assise dans un fauteuil. Elle boit un verre de lait. Lorsqu’elle veut le reposer, il tombe et se brise à terre. La vie l’a quittée. L’ombre de Daniel Gregg s’approche. Il lui tend les mains. Contre-champ : Lucy, jeune, se lève en souriant. Elle jette un coup d’œil à son vieux corps et s’en va avec Daniel. La porte de Gull Cottage s’ouvre d’elle-même pour les laisser s’enfoncer dans le brouillard du jardin puis se referme. The End.
La mort est au cœur de chaque film de Mankiewicz et la scène finale est remarquable à cet égard. Après avoir regardé la mer depuis son balcon, Lucy Muir, devenue une vieille dame aux cheveux blancs, s’est assise dans un fauteuil. Elle boit un verre de lait. Lorsqu’elle veut le reposer, il tombe et se brise à terre. La vie l’a quittée. L’ombre de Daniel Gregg s’approche. Il lui tend les mains. Contre-champ : Lucy, jeune, se lève en souriant. Elle jette un coup d’œil à son vieux corps et s’en va avec Daniel. La porte de Gull Cottage s’ouvre d’elle-même pour les laisser s’enfoncer dans le brouillard du jardin puis se referme. The End.
MISSION IMPOSSIBLE.- Lorsqu’en 1995, Brian de Palma s’attaque à l’adaptation cinématographique de la célèbre série télévisée diffusée dans les années 1960-1970, il reste sur deux échecs : L’esprit de Caïn (1992) puis L’impasse (1993) sont des flops. Pour De Palma, Mission… est l’occasion de remonter la pente. Le film sera un gros succès. Cela même si le cinéaste s’ingénie à prendre des libertés avec la série…
Dans ses entretiens avec Samuel Blumenfeld (Carlotta éditions, 2019), Brian de Palma raconte que son meilleur souvenir de tournage de Mission Impossible fut la scène du casse : « C’était très difficile à tourner (…) Tom (Cruise) s’est montré très patient et pourtant il était dans une position inconfortable… »
 Pour préparer son travail, De Palma avait visionné des films de casses et avait été impressionné par Topkapi (1964) de Jules Dassin et l’acrobate descendant le long d’’un filin pour voler des bijoux. On retrouve clairement cette situation dans le morceau de bravoure du film. Pour dérober un fichier informatique dans une chambre forte de la CIA, Ethan Hunt (Cruise) y entre dans le plafond, suspendu à un filin tenu par un complice. Il va connaître une série d’alertes comme l’entrée d’un analyste dans la pièce qui ne le voit pas au-dessus de lui et surtout l’instant où, troublé par la présence d’un rat, le complice lâche la corde, Hunt se retrouvant au ras du sol. Les gouttes qui perlent sur son front, menacent de déclencher l’alarme… Une scène filmée dans un silence total et très… rare dans le cinéma d’action US.
Pour préparer son travail, De Palma avait visionné des films de casses et avait été impressionné par Topkapi (1964) de Jules Dassin et l’acrobate descendant le long d’’un filin pour voler des bijoux. On retrouve clairement cette situation dans le morceau de bravoure du film. Pour dérober un fichier informatique dans une chambre forte de la CIA, Ethan Hunt (Cruise) y entre dans le plafond, suspendu à un filin tenu par un complice. Il va connaître une série d’alertes comme l’entrée d’un analyste dans la pièce qui ne le voit pas au-dessus de lui et surtout l’instant où, troublé par la présence d’un rat, le complice lâche la corde, Hunt se retrouvant au ras du sol. Les gouttes qui perlent sur son front, menacent de déclencher l’alarme… Une scène filmée dans un silence total et très… rare dans le cinéma d’action US.
L’EXTRAVAGANT MR. RUGGLES.- Lorsqu’en 1908 à Paris, le valet Marmaduke Ruggles réveille son maître, il ignore le pire. Le comte de Burnstead lui apprend que, la veille au soir, il a perdu Ruggles au poker en jouant avec un couple d’Américains. Tout en réussissant à se contrôler mais néanmoins horrifié, le valet comprend qu’il va devoir partir en Amérique, « le pays de l’esclavage »… Lorsqu’en 1935, Leo McCarey comme Charles Laughton tournent Ruggles of Red Gap, ce film représente un virage dans leurs carrières. McCarey va se démarquer des genres comiques où il faisait seulement figure de bon artisan. Pour Laughton, qui n’avait jamais fait de comédie, c’est le moment de gagner une popularité restreinte par sa réputation de grand comédien britannique issu du théâtre… Entre raideur et oscillation, Laughton va composer un Ruggles qui, tout en gardant son corps immobile, réussit par ses roulements d’yeux, à dire le tangage intérieur du personnage. Valet raffiné propulsé dans la petite société plouc de Red Gap, il y trouvrera son équilibre (et l’amour !).
 La scène la plus célèbre du film est celle où Ruggles récite au saloon Silver Dollar, le discours du président Lincoln à Gettysburg en 1863. A cet instant, le valet tourne le dos à sa vision cauchemardesque du Far West par une assimilation à l’un des textes politiques fondateurs du pays. Au sortir de la guerre civile, Lincoln y reprend les principes de la Déclaration d’indépendance, affirme que la guerre aura servi à rétablir l’Union américaine. Curieusement, les clients du Silver Dollar ne se souviennent pas des termes du discours. Et ce sera un valet anglais –bouleversé par l’idéal américain- qui comblera un grand trou de mémoire historique…
La scène la plus célèbre du film est celle où Ruggles récite au saloon Silver Dollar, le discours du président Lincoln à Gettysburg en 1863. A cet instant, le valet tourne le dos à sa vision cauchemardesque du Far West par une assimilation à l’un des textes politiques fondateurs du pays. Au sortir de la guerre civile, Lincoln y reprend les principes de la Déclaration d’indépendance, affirme que la guerre aura servi à rétablir l’Union américaine. Curieusement, les clients du Silver Dollar ne se souviennent pas des termes du discours. Et ce sera un valet anglais –bouleversé par l’idéal américain- qui comblera un grand trou de mémoire historique…
LE TROU.- Pour les jeunes Turcs de la Nouvelle vague, Jacques Becker est clairement un passeur de modernité lorsqu’à la fin des années 50, il veut s’affranchir des contraintes commerciales du cinéma. Le cinéaste lit alors Le trou et décide de le porter à l’écran. José Giovanni y raconte l’histoire de Claude Gaspard qui, en 1947, à la Santé, est changé de cellule pour cause de travaux. Il y a là quatre prévenus qui voient d’un mauvais œil, arriver le nouveau. Car ils préparent une évasion en creusant un trou dans leur cellule. Pour des raisons d’authenticité (et de sobriété du jeu), Becker recherche des acteurs débutants et embauche notamment Jean Keraudy, l’un des vrais protagonistes de la tentative d’évasion, qui jouera son propre rôle à l’écran. Le tournage, en juillet 1959, se révèle harassant. Becker, déjà malade, est très exigeant mais le film (son dernier car il meurt en 1960, un mois avant la sortie en salles) est considéré comme un classique du film d’évasion.
 Le forage du trou donne lieu à l’une des grandes scènes du film avec notamment le plan récurrent sur les mains habiles de Roland, cerveau du groupe et véritable homme au travail. Becker décortique les gestes de l’action et organise la montée de la tension en jouant sur la régularité des coups portés à la dalle de béton, sur l’anxiété des détenus face au bruit produit mais aussi sur la nécessaire vitesse… Vaincre l’enfermement, c’est d’abord l’emporter sur le temps. C’est quasiment en temps réel que l’on assiste à la progression de l’entreprise menée par un groupe organisé, agissant comme un seul homme…
Le forage du trou donne lieu à l’une des grandes scènes du film avec notamment le plan récurrent sur les mains habiles de Roland, cerveau du groupe et véritable homme au travail. Becker décortique les gestes de l’action et organise la montée de la tension en jouant sur la régularité des coups portés à la dalle de béton, sur l’anxiété des détenus face au bruit produit mais aussi sur la nécessaire vitesse… Vaincre l’enfermement, c’est d’abord l’emporter sur le temps. C’est quasiment en temps réel que l’on assiste à la progression de l’entreprise menée par un groupe organisé, agissant comme un seul homme…
BONNIE & CLYDE.- Au mitan des années 60, Arthur Penn vit en reclus, profondément dégoûté par le système hollywoodien. Le montage du Gaucher lui a été retiré et il connaîtra la même mésaventure avec La poursuite impitoyable… Bien que peu enthousiaste, il accepte le scénario de Bonnie & Clyde proposé par Warren Beatty.
Pour Penn, il ne s’agit pas de tourner un film de gangsters rétro : « On est en pleine guerre du Vietnam, ce film ne peut pas être immaculé, aseptisé. Fini le simple bang bang. Ça va saigner ! » En s’emparant de l’épopée du gang Barrow qui défraya la chronique criminelle dans les années 30, le cinéaste va signer, non point un film de gangsters de plus, mais bien la fin du vieil Hollywood. Considéré comme une œuvre charnière, le film a la réputation d’avoir donner le coup de grâce au fameux code de production dit code Hays, permettant ainsi aux cinéastes des années 70 de retrouver une liberté de ton envolée depuis une trentaine d’années. La manière de représenter la violence à l’écran trouve en effet une expression directe sans précédent dans le cinéma.
 La scène ultime de Bonnie & Clyde en constitue une synthèse. Sur une petite route de campagne, Bonnie (Faye Dunaway) et Clyde (Warren Beatty) s’arrêtent pour aider un camionneur en panne. Un vol d’oiseaux trouble le silence. Des buissons bougent. Série de très gros plans sur les deux bandits. La fusillade explose. Avec une brutale volonté de réalisme, Penn filme la mort au au ralenti avec les corps secoués et criblés par les balles qui finissent par s’affaisser comme de pathétiques pantins ensanglantés…
La scène ultime de Bonnie & Clyde en constitue une synthèse. Sur une petite route de campagne, Bonnie (Faye Dunaway) et Clyde (Warren Beatty) s’arrêtent pour aider un camionneur en panne. Un vol d’oiseaux trouble le silence. Des buissons bougent. Série de très gros plans sur les deux bandits. La fusillade explose. Avec une brutale volonté de réalisme, Penn filme la mort au au ralenti avec les corps secoués et criblés par les balles qui finissent par s’affaisser comme de pathétiques pantins ensanglantés…
UN CHIEN ANDALOU.- « En arrivant chez Dalí, à Figueras, invité à passer quelques jours, je lui racontais que j’avais rêvé, peu de temps auparavant, d’un nuage effilé coupant la lune et d’une lame de rasoir fendant un œil. De son côté, il me raconta qu’il venait de voir en rêve, la nuit précédente, une main pleine de fourmis. Il ajouta : « et si nous faisions un film, en partant de ça ? » C’est Luis Bunuel qui évoque ainsi la genèse du Chien andalou que les deux artistes vont réaliser en 1929 et qui deviendra le film surréaliste par excellence.
 En six jours, Buñuel et Dali, sur le mode du cadavre exquis, écrivent le scénario… Buñuel raconte encore: « Nous travaillions en accueillant les premières images qui nous venaient à l’esprit et nous rejetions systématiquement tout ce qui pouvait venir de la culture ou l’éducation. Il fallait que ce soient des images qui nous surprennent et qui soient acceptées par tous les deux sans discussion. »
En six jours, Buñuel et Dali, sur le mode du cadavre exquis, écrivent le scénario… Buñuel raconte encore: « Nous travaillions en accueillant les premières images qui nous venaient à l’esprit et nous rejetions systématiquement tout ce qui pouvait venir de la culture ou l’éducation. Il fallait que ce soient des images qui nous surprennent et qui soient acceptées par tous les deux sans discussion. »
Souvent jugée insoutenable par certains spectateurs (on dit qu’elle a été retirée des copies dans certains pays), la scène d’ouverture présente, sur un air de tango, un homme (Luis Bunuel lui-même) aiguisant un rasoir, puis, sur un balcon, avisant pensivement la lune devant laquelle passe un nuage effilé. Gros plan : la main d’un homme écarte les paupières d’une femme (Simonne Mareuil) filmée de face et étrangement calme. Un rasoir s’apprête à passer dans l’œil. Cut dans le mouvement. Un fin nuage passe devant la lune. Cut. Le rasoir tranche l’œil (de bœuf utilisé pour le tournage) et provoqua une foultitude d’interprétations…
LES DENTS DE LA MER.- «Si tu arrives à mettre la moitié de tout ce que je vois là-dessus dans ton film, tu tiendras le plus gros succès de tous les temps. » C’est George Lucas qui, en parcourant le storyboard de Jaws, tient ce discours à son ami Spielberg. Il a raison. Inaugurant l’ère des blockbusters, le film va cartonner (6,2 millions d’entrées en France en 1975) et installer durablement Steven Spielberg au sommet de l’entertainement hollywoodien avec cette histoire de requin tueur semant la panique dans une station balnéaire. Et l’on sait que le cinéaste développe… une phobie du monde sous-marin. Portée par la musique répétitive et obsessionnelle, faite de deux seules notes, de John Williams, la scène d’ouverture (durée: 4’55 mn) instille immédiatement –notamment par l’invisibilité du squale- une pure angoisse.
 Sur l’île (imaginaire) d’Amity, des jeunes gens sont autour d’un feu de camp sur la plage. Chrissie Watkins (Susan Blacklinie) s’éloigne du groupe pour un bain de minuit. Son flirt, ivre, renonce à la suivre. Après quelques brasses, elle est « percutée » par une force mystérieuse. Elle tente de résister mais est happée et disparaît dans l’eau en hurlant de terreur. Quelques secondes après, la mer retrouve son calme nocturne. Personne ne sait ce qui vient de se dérouler.
Sur l’île (imaginaire) d’Amity, des jeunes gens sont autour d’un feu de camp sur la plage. Chrissie Watkins (Susan Blacklinie) s’éloigne du groupe pour un bain de minuit. Son flirt, ivre, renonce à la suivre. Après quelques brasses, elle est « percutée » par une force mystérieuse. Elle tente de résister mais est happée et disparaît dans l’eau en hurlant de terreur. Quelques secondes après, la mer retrouve son calme nocturne. Personne ne sait ce qui vient de se dérouler.
En 1979, Spielberg s’auto-parodie en ouverture de 1941. Une jeune femme (Susan Backlinie, encore elle !) s’approche de l’eau, enlève ses vêtements et se baigne nue. A la place du requin, c’est un sous-marin japonais qui émerge alors que la jeune femme s’agrippe au périscope !
TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI.- Prolifique figure de proue du nouveau cinéma allemand, Rainer Werner Fassbinder (1945-1982), a réussi une « comédie humaine » qui trace un rude portrait de la société allemande de l’après-guerre.
En 1974, RWF raconte l’histoire tragique d’Emmi Kurowski (Brigitte Mira) qui, un soir de pluie, entre dans un bar pour immigrés à Munich. Elle y croise Ali, un travailleur marocain. Veuve déjà âgée, elle vit seule sans ses enfants. L’improbable arrive : Emmi et Ali (El Hedi Ben Salem) tombent amoureux et se marient. Mais, face au racisme ambiant et au rejet des siens, Emmi s’effondre. Après des vacances pour fuir l’hostilité générale, les deux vont être secoués lorsqu’elle se laisse aller à d’hypocrites propositions de réconciliation des uns et des autres…
 A la 57e minute, Fassbinder place une séquence qui condense la solitude du couple. Dans un large plan d’ensemble, Emmi et Ali sont seuls et minuscules au milieu de la composition. Autour d’eux, sous de larges frondaisons, de multiples tables jaunes et vides d’un Biergarten. De loin, ils sont observés par des clients et des serveurs. Ce « désert » jaune et vert, dominé par les seuls chants des oiseaux après la pluie, est impressionnant . Pour le cinéaste, il est une manière à la fois extrêmement littérale et décalée d’exprimer la détresse du couple, la méfiance de tous à leur égard, la froideur nouvelle d’un monde à la limite de l’abstraction. Tandis qu’Ali la console, Emmi pleure : « Je n’arrive plus à supporter tout ça. Cette haine des gens. » Fondu au noir.
A la 57e minute, Fassbinder place une séquence qui condense la solitude du couple. Dans un large plan d’ensemble, Emmi et Ali sont seuls et minuscules au milieu de la composition. Autour d’eux, sous de larges frondaisons, de multiples tables jaunes et vides d’un Biergarten. De loin, ils sont observés par des clients et des serveurs. Ce « désert » jaune et vert, dominé par les seuls chants des oiseaux après la pluie, est impressionnant . Pour le cinéaste, il est une manière à la fois extrêmement littérale et décalée d’exprimer la détresse du couple, la méfiance de tous à leur égard, la froideur nouvelle d’un monde à la limite de l’abstraction. Tandis qu’Ali la console, Emmi pleure : « Je n’arrive plus à supporter tout ça. Cette haine des gens. » Fondu au noir.
BLOW OUT.- Que pouvons-nous savoir d’un événement par l’image ? Par le son ? Lorsqu’en 1981, Brian de Palma met en chantier Blow Out, son film est hanté par un spectre, celui de l’assassinat de John F. Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas. Jack Terry (John Travolta) est preneur de son. Une nuit alors qu’il est en quête de sons naturels, il entend un crissement suivi d’une explosion. Une voiture vient de quitter la route et a plongé dans un lac. Jack plonge à l’eau et réussit à sauver la passagère du véhicule mais le conducteur, un influent homme politique, succombe. En réécoutant attentivement l’enregistrement, Terry comprend que l’explosion n’est pas accidentelle…
 Si Blow Out n’est pas un film-enquête sur la mort de JFK (De Palma a plutôt songé à l’accident de Chappaquiddick qui a brisé la carrière de Ted Kennedy), c’est par contre une formidable analyse des manipulations du son et de l’image au cinéma. Ainsi la séquence, presque sans dialogues, où Jack enregistre des sons dans un parc de Philadelphie est remarquable dans la manière dont elle organise des trajectoires sonores. Pointant son long micro canon comme une baguette de chef d’orchestre, Jack, immobile sur un pont, est au cœur du dispositif de mise en scène tandis que des sons (vent, bruits d’animaux, conversations) s’enchaînent les uns aux autres. Et puis, peu à peu, s’installent presque des mystères auditifs. Et bientôt, surgit une menace. Désormais, et jusqu’au bout du film, les repères de Jack sont bouleversés…
Si Blow Out n’est pas un film-enquête sur la mort de JFK (De Palma a plutôt songé à l’accident de Chappaquiddick qui a brisé la carrière de Ted Kennedy), c’est par contre une formidable analyse des manipulations du son et de l’image au cinéma. Ainsi la séquence, presque sans dialogues, où Jack enregistre des sons dans un parc de Philadelphie est remarquable dans la manière dont elle organise des trajectoires sonores. Pointant son long micro canon comme une baguette de chef d’orchestre, Jack, immobile sur un pont, est au cœur du dispositif de mise en scène tandis que des sons (vent, bruits d’animaux, conversations) s’enchaînent les uns aux autres. Et puis, peu à peu, s’installent presque des mystères auditifs. Et bientôt, surgit une menace. Désormais, et jusqu’au bout du film, les repères de Jack sont bouleversés…
TRAINS ETROITEMENT SURVEILLES.- « Tant qu’on est jeune et bête et qu’on n’a pas conscience du danger, on se lance dans des projets dans lesquels on ne se lancerait jamais si on était un peu raisonnable. Parfois, ce genre d’imprudence peut s’avérer payante… » C’est ainsi que Jiri Menzel (1938-2020) évoque la genèse de Trains étroitement surveillés. Ce premier long-métrage, tourné en 1966, va le propulser chef de file de la Nouvelle vague tchécoslovaque.
Durant l’Occupation allemande de la Tchécoslovaquie, Milos commence son apprentissage dans une gare de campagne. Amoureux de la pétillante Macha, il découvre les affres de la timidité et de l’impuissance, songe au suicide avant de se muer en héros de la Résistance.
 La scène la plus fameuse de Trains étroitement surveillés (Oscar du meilleur film étranger en 1968) est celle où Hubicka, chef de gare jouisseur, courtise la télégraphiste Zdenka. Menzel filme, en gros plans, un jeu potache où le séducteur va tamponner à trois reprises la cuisse de la belle allongée sur le ventre. Cette dernière qui humecte les tampons de son haleine et paraît y trouver du plaisir, va enfin baisser sa culotte pour offrir ses fesses à un quatrième tampon. Joliment érotique, la scène se développe ensuite, de manière cocasse, lorsque la mère de Zdenka, ayant découvert les tampons, alerte successivement la police et la justice. Les deux institutions botteront prudemment en touche, renvoyant la mère à saisir le conseil de discipline des chemins de fer. Troublée, la production demanda à Menzel de couper la scène. Il n’en fut heureusement rien.
La scène la plus fameuse de Trains étroitement surveillés (Oscar du meilleur film étranger en 1968) est celle où Hubicka, chef de gare jouisseur, courtise la télégraphiste Zdenka. Menzel filme, en gros plans, un jeu potache où le séducteur va tamponner à trois reprises la cuisse de la belle allongée sur le ventre. Cette dernière qui humecte les tampons de son haleine et paraît y trouver du plaisir, va enfin baisser sa culotte pour offrir ses fesses à un quatrième tampon. Joliment érotique, la scène se développe ensuite, de manière cocasse, lorsque la mère de Zdenka, ayant découvert les tampons, alerte successivement la police et la justice. Les deux institutions botteront prudemment en touche, renvoyant la mère à saisir le conseil de discipline des chemins de fer. Troublée, la production demanda à Menzel de couper la scène. Il n’en fut heureusement rien.
IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST.- Maître du western spaghetti, Sergio Leone aimait à étirer au maximum le temps à l’instar des cinéastes japonais qu’il affectionnait. L’Italien voulait que, de la sorte, ses « mouvements de caméra soient comme des caresses ». Emblématique illustration de cette méthode « indolente », l’ouverture (longue de dix minutes et tournée en trois jours en Andalousie) du fameux Il était une fois dans l’Ouest (1968).
 Dans une petite gare en piteux état, trois tueurs font peur au vieux chef de gare et l’enferment dans un cagibi. Le premier se pose près d’un abreuvoir à chevaux au bout du quai. Le second s’assoit sur un rocking-chair au milieu. Le dernier se poste sous le château d’eau. Agacé par le tic-tac du télégraphe, le tueur au rocking-chair en arrache les fils, avant d’être importuné par une mouche qui se pose sur son visage. Son collègue du château d’eau coiffe son chapeau pour ne pas se faire mouiller par les gouttes qui s’en échappent. L’homme de l’abreuvoir fait craquer ses doigts.
Dans une petite gare en piteux état, trois tueurs font peur au vieux chef de gare et l’enferment dans un cagibi. Le premier se pose près d’un abreuvoir à chevaux au bout du quai. Le second s’assoit sur un rocking-chair au milieu. Le dernier se poste sous le château d’eau. Agacé par le tic-tac du télégraphe, le tueur au rocking-chair en arrache les fils, avant d’être importuné par une mouche qui se pose sur son visage. Son collègue du château d’eau coiffe son chapeau pour ne pas se faire mouiller par les gouttes qui s’en échappent. L’homme de l’abreuvoir fait craquer ses doigts.
Retour au rocking-chair. Le tueur (Jack Elam) a dégainé son colt et attrapé la mouche qu’il maintient vivante dans son canon. L’homme du réservoir (Woody Strode) se désaltère en buvant l’eau recueillie sur son chapeau. Le train arrive. Personne n’en sort. D’abord aux aguets, les tueurs tournent les talons. Alors que le train quitte la gare, ils entendent le son d’un harmonica. Ils se retournent. Harmonica (Charles Bronson), l’homme qu’ils attendaient est là, descendu de l’autre côté de la voie.
AU REVOIR LES ENFANTS.- C’est alors qu’il prépare Lacombe Lucien (1974) que Louis Malle acquiert la certitude de réaliser un jour Au revoir les enfants, en l’occurrence mettre en scène l’histoire personnelle qui lui était arrivée en janvier 1944 alors qu’il a onze ans et qu’il est au collège d’Avon, près de Fontainebleau. Un épisode douloureux de sa vie dont il ne parla jamais à personne…
La concrétisation de ce projet –entre exhumation d’une part d’enfance et travail de mémoire- attendra la fin de la période américaine (1975-1985) du cinéaste. En août 1986, Malle s’isole à Paris pour écrire et commence par les scènes de la fin : « C’étaient celles que je ne voulais pas changer ». Il lit son scénario à sa femme et sa fille qui éclatent en sanglots… Il raconte, du point de vue de Julien, collégien de 12 ans, l’histoire (romancée) du père Jean, prêtre résistant qui cache des enfants juifs, dont un nouveau venu nommé Bonnet, dans le collège qu’il dirige…
 Reposant sur des échanges de regards, la séquence ultime du film montre, en plan d’ensemble, le père Jean suivi de trois collégiens, qui traverse la cour. Alignés, les collégiens regardent. Une voix puis toutes les voix : « Au revoir, mon père ». Le père Jean : « Au revoir les enfants. A bientôt ! ». Gros plan sur Bonnet puis sur Julien qui agite la main. Plan sur Bonnet qu’un soldat allemand tire par le bras. En voix off, sur un plan de Julien, Louis Malle dit : « Bonnet, Négus et Dupré sont morts à Auschwitz, le père Jean au camp de Mauthausen. (…) Plus de quarante ans ont passé et jusqu’à ma mort, je me rappellerai chaque seconde de ce matin de janvier. »
Reposant sur des échanges de regards, la séquence ultime du film montre, en plan d’ensemble, le père Jean suivi de trois collégiens, qui traverse la cour. Alignés, les collégiens regardent. Une voix puis toutes les voix : « Au revoir, mon père ». Le père Jean : « Au revoir les enfants. A bientôt ! ». Gros plan sur Bonnet puis sur Julien qui agite la main. Plan sur Bonnet qu’un soldat allemand tire par le bras. En voix off, sur un plan de Julien, Louis Malle dit : « Bonnet, Négus et Dupré sont morts à Auschwitz, le père Jean au camp de Mauthausen. (…) Plus de quarante ans ont passé et jusqu’à ma mort, je me rappellerai chaque seconde de ce matin de janvier. »
LA MORT AUX TROUSSES.- Eblouissant road-movie d’espionnage, North by Northwest (1958) est l’une des œuvres les plus réussies de Sir Alfred Hitchcock. Publiciste new-yorkais, Roger Thornhill (Cary Grant) estn pris par erreur pour George Kaplan, un agent des services secrets. Philip Vandamm, un espion, cherche à faire disparaître Thornhill alors que celui-ci est traqué par la police pour le meurtre, aux Nations Unies, d’un homme assassiné par les hommes de Vandamm…
 Si on connaît La mort aux trousses, c’est à cause de la fameuse séquence (8 mn) du champ de maïs. Ayant un rendez-vous avec le vrai Kaplan, Thornhill l’attend à un arrêt de bus en rase campagne, à plus d’une heure de Chicago. Mais point de Kaplan et personne aux alentours, sinon un avion qui pulvérise des pesticides. Une voiture dépose un homme au bord de la route. Kaplan ? Non, juste un quidam qui, avant de monter dans le bus qu’il attendait, remarque que, bizarrement, le petit avion arrose un endroit où il n’y a pas de plantation…
Si on connaît La mort aux trousses, c’est à cause de la fameuse séquence (8 mn) du champ de maïs. Ayant un rendez-vous avec le vrai Kaplan, Thornhill l’attend à un arrêt de bus en rase campagne, à plus d’une heure de Chicago. Mais point de Kaplan et personne aux alentours, sinon un avion qui pulvérise des pesticides. Une voiture dépose un homme au bord de la route. Kaplan ? Non, juste un quidam qui, avant de monter dans le bus qu’il attendait, remarque que, bizarrement, le petit avion arrose un endroit où il n’y a pas de plantation…
Bientôt le biplan va foncer sur Thornhill qui se plaque au sol pour l’éviter. L’avion va réitérer ses attaques en lui tirant dessus. Avisant un champ de maïs, Thornhill court s’y réfugier. Mais, étouffé par le nuage de pesticides, il doit sortir de sa cachette. Revenu sur la route, le fuyard stoppe un camion-citerne qui manque de l’écraser. L’avion qui arrive en rase-mottes ne peut éviter le camion et s’y encastre. Le petit zinc explose, suivi du camion. Roger Thornhill a juste le temps de filer en courant…
LE VOLEUR DE BICYCLETTE.- Né sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, le néoréalisme –dont Le voleur de bicyclette est une œuvre emblématique- a révolutionné le cinéma mondial en filmant la « vraie vie ». Avec le scénariste Cesare Zavattini, Vittorio De Sica veut, en 1948, descendre dans la rue et enregistrer les conditions de vie du peuple italien. Il le fera à travers l’aventure d’Antonio Ricci, père de famille romain au chômage. Recruté comme colleur d’affiches, Ricci a besoin d’un vélo pour se déplacer dans la ville. Catastrophe, dès le premier jour de boulot, on lui dérobe son précieux outil de travail. Epaulé par Bruno, son gamin qui lui voue une admiration sans bornes, Ricci se lance dans une quête de sa bicyclette.
 Fable morale aux accents de tragédie portée par le regard d’une infinie tendresse de De Sica, le film s’achève par une séquence bouleversante mais cependant dépourvue d’effets faciles pour provoquer l’émotion du spectateur. Arrivés sur une grande place, Antonio et Bruno se tiennent devant le stade municipal où se déroule le grand match de football dominical. Alors que des centaines de supporters sortent du stade, Antonio est pris d’un coup de folie : il tente de dérober une bicyclette posée devant un immeuble dans une rue attenante. Rattrapé par la foule, à deux doigts du lynchage, il est tiré d’affaire lorsque Bruno le rejoint, apitoyant sans le vouloir le propriétaire du vélo qui décide de ne pas envoyer Antonio au poste. Le père et son fils, en larmes, marchent hagards parmi les supporters et se perdent dans la foule…
Fable morale aux accents de tragédie portée par le regard d’une infinie tendresse de De Sica, le film s’achève par une séquence bouleversante mais cependant dépourvue d’effets faciles pour provoquer l’émotion du spectateur. Arrivés sur une grande place, Antonio et Bruno se tiennent devant le stade municipal où se déroule le grand match de football dominical. Alors que des centaines de supporters sortent du stade, Antonio est pris d’un coup de folie : il tente de dérober une bicyclette posée devant un immeuble dans une rue attenante. Rattrapé par la foule, à deux doigts du lynchage, il est tiré d’affaire lorsque Bruno le rejoint, apitoyant sans le vouloir le propriétaire du vélo qui décide de ne pas envoyer Antonio au poste. Le père et son fils, en larmes, marchent hagards parmi les supporters et se perdent dans la foule…
SEPT ANS DE REFLEXION.- Si Marilyn Monroe représente l’incarnation absolue de la star, l’actrice n’a pas fait que des chefs d’œuvre au cinéma, loin s’en faut. Cependant, c’est avec le grand Billy Wilder qu’elle a connu ses deux plus belles réussites. En 1959 avec le pétillant Certains l’aiment chaud et, avant cela, en 1955 avec Sept ans de réflexion.
On sait que Wilder n’était pas satisfait du film, déclarant même: « J’aurais aimé ne jamais l’avoir tourné ». Heureusement, pour les admirateurs de Marilyn, il l’a fait. Certes The Seven Year Itch apparaît, aujourd’hui, comme une comédie datée sur les fantasmes et les frustrations de l’Homo americanus. Mais à entendre certains propos sur les femmes du président Trump, on peut se dire que… mais ceci est une autre histoire.
 Si le tournage fut compliqué à cause des absences à répétition d’une star angoissée, la fameuse scène de la bouche de métro demeure un moment culte. Dans la chaleur torride de l’été new-yorkais, celle que le film désigne simplement comme The Girl est sortie dans les rues avec son voisin Tom Sherman (Tom Ewell), célibataire éphémère. Sa femme et leur fils ont quitté la ville et Sherman se sent pousser des ailes d’autant que « la fille » lui offre le charmant spectacle de ses jambes et, furtivement, de sa culotte blanche en prenant le frais au passage d’une rame. L’image est devenue totalement iconique… même si elle n’est pas dans le film ! De fait, la scène est construite en deux plans : un plan américain sur Marilyn et un insert sur ses jambes.
Si le tournage fut compliqué à cause des absences à répétition d’une star angoissée, la fameuse scène de la bouche de métro demeure un moment culte. Dans la chaleur torride de l’été new-yorkais, celle que le film désigne simplement comme The Girl est sortie dans les rues avec son voisin Tom Sherman (Tom Ewell), célibataire éphémère. Sa femme et leur fils ont quitté la ville et Sherman se sent pousser des ailes d’autant que « la fille » lui offre le charmant spectacle de ses jambes et, furtivement, de sa culotte blanche en prenant le frais au passage d’une rame. L’image est devenue totalement iconique… même si elle n’est pas dans le film ! De fait, la scène est construite en deux plans : un plan américain sur Marilyn et un insert sur ses jambes.
BLOW-UP.- Souvent classé « cinéaste de l’incommunicabilité » -une étiquette fortement réductrice-, Michelangelo Antonioni (1912-2007) affirmait, très tôt, que « c’est le mouvement intérieur des personnages qui doit prévaloir ». En 1966, l’Italien part à Londres pour s’imprégner de l’effervescence du Swinging London et pouvoir partir de l’observation de la réalité pour raconter l’aventure de Thomas, un photographe professionnel (David Hemmings) qui, en errant dans un parc, aperçoit un couple et en prend des clichés. La femme (Vanessa Redgrave) tentera de récupérer les pellicules. En agrandissant ses images et en scrutant quasiment la matière des clichés, Thomas s’interroge : a-t-il été le témoin d’un meurtre ?
 Plongée vertigineuse et passionnante au cœur des images, Blow-Up, qui obtint la Palme d’or au Festival de Cannes 1967 et fut le plus gros succès d’Antonioni (sans doute aussi à cause du scandale provoqué par quelques scènes dénudées), s’achève sur une superbe séquence. De retour dans le parc où il avait photographié le couple, Thomas croise des clowns qu’il avait vu la veille et observe deux d’entre eux mimant, sur un court, une partie de tennis. Quand la balle invisible sort du terrain, Antonioni réalise un travelling sur la balle roulant dans l’herbe. Malgré son absence, on la suit des yeux. Thomas peut alors la ramasser et la renvoyer aux joueurs… Par la force de sa mise en scène, Antonioni fait la part belle au cinéma. La partie de tennis est bien « réelle » pour peu qu’on fasse le choix d’y croire…
Plongée vertigineuse et passionnante au cœur des images, Blow-Up, qui obtint la Palme d’or au Festival de Cannes 1967 et fut le plus gros succès d’Antonioni (sans doute aussi à cause du scandale provoqué par quelques scènes dénudées), s’achève sur une superbe séquence. De retour dans le parc où il avait photographié le couple, Thomas croise des clowns qu’il avait vu la veille et observe deux d’entre eux mimant, sur un court, une partie de tennis. Quand la balle invisible sort du terrain, Antonioni réalise un travelling sur la balle roulant dans l’herbe. Malgré son absence, on la suit des yeux. Thomas peut alors la ramasser et la renvoyer aux joueurs… Par la force de sa mise en scène, Antonioni fait la part belle au cinéma. La partie de tennis est bien « réelle » pour peu qu’on fasse le choix d’y croire…
QUAI DES ORFEVRES.- Lorsqu’en 1947, Henri-Georges Clouzot réalise Quai des Orfèvres, il est un rescapé. En 1943, il a tourné le brillant Corbeau, sordide histoire de délation adaptée d’un fait-divers des années 20 qui lui vaudra, dès la Libération, les foudres du Comité d’épuration du cinéma français. Jugeant le Corbeau antifrançais, il interdit à Clouzot de travailler. Fort du soutien de nombreuses personnalités du cinéma, Clouzot verra cette interdiction levée et il pourra faire Quai des Orfèvres, une oeuvre qui connaîtra un immense succès en France comme à l’étranger.
 Archétype du « polar à la française », le film mêle enquête policière (qui a tué ce vieux dégueulasse de Brignon ?), univers du music-hall, ménage en crise et portrait de l’inspecteur Antoine, type droit et bourru auquel l’immense Louis Jouvet prête son aura et sa fameuse et atypique diction. Dans Quai des Orfèvres, on croise des personnages superbement dessinés comme Jenny Lamour, chanteuse légère (Suzy Delair) ou son mari jaloux (Bernard Blier). Simone Renant incarne Dora, la photographe amoureuse transie de Jenny. Observatrice discrète, Dora est une sorte de double d’Antoine. La première fois que celui-ci apparaît, un bref fondu enchainé les met en relation, comme s’ils échangeaient un regard complice. À la fin du film, l’inspecteur ayant compris l’amour de Dora pour Jenny, va jusqu’à le formuler : « Et puis je vais vous dire, vous m’êtes particulièrement sympathique, mademoiselle Dora Monnier (…), vous êtes un type dans mon genre. Avec les femmes, vous n’aurez jamais de chance. »
Archétype du « polar à la française », le film mêle enquête policière (qui a tué ce vieux dégueulasse de Brignon ?), univers du music-hall, ménage en crise et portrait de l’inspecteur Antoine, type droit et bourru auquel l’immense Louis Jouvet prête son aura et sa fameuse et atypique diction. Dans Quai des Orfèvres, on croise des personnages superbement dessinés comme Jenny Lamour, chanteuse légère (Suzy Delair) ou son mari jaloux (Bernard Blier). Simone Renant incarne Dora, la photographe amoureuse transie de Jenny. Observatrice discrète, Dora est une sorte de double d’Antoine. La première fois que celui-ci apparaît, un bref fondu enchainé les met en relation, comme s’ils échangeaient un regard complice. À la fin du film, l’inspecteur ayant compris l’amour de Dora pour Jenny, va jusqu’à le formuler : « Et puis je vais vous dire, vous m’êtes particulièrement sympathique, mademoiselle Dora Monnier (…), vous êtes un type dans mon genre. Avec les femmes, vous n’aurez jamais de chance. »
DOCTEUR NO.- A Kingston, Jamaïque, un trio de faux aveugles exécutent deux agents secrets anglais… A Londres, c’est le branle-bas de combat. Gros plan sur la plaque d’un casino huppé, Le Cercle. On vient demander James Bond. Autour d’une table, on joue au chemin de fer.
 Travelling arrière : on découvre l’épaule et la nuque d’un homme en smoking. Gros plan sur les cartes qu’il vient de tirer, un valet de trèfle et un 8 de carreau. Plan sur une élégante jeune femme en fourreau rouge qui est en train de perdre. « J’admire votre courage, Mademoiselle… » Et la belle de répondre : « Trench, Sylvia Trench ». On vient d’entendre James Bond avant de le voir. Contre-champ sur un homme séduisant mais au regard dur qui allume une cigarette et se présente à son tour : « Bond, James Bond » Il lance à Sylvia Trench : « Vous êtes décidée à aller jusqu’au bout… » Mais on lui parle à l’oreille. Il se lève : « Le devoir m’appelle ! » A la belle, il propose bien de dîner le lendemain mais M ramènera l’agent 007 à sa mission.
Travelling arrière : on découvre l’épaule et la nuque d’un homme en smoking. Gros plan sur les cartes qu’il vient de tirer, un valet de trèfle et un 8 de carreau. Plan sur une élégante jeune femme en fourreau rouge qui est en train de perdre. « J’admire votre courage, Mademoiselle… » Et la belle de répondre : « Trench, Sylvia Trench ». On vient d’entendre James Bond avant de le voir. Contre-champ sur un homme séduisant mais au regard dur qui allume une cigarette et se présente à son tour : « Bond, James Bond » Il lance à Sylvia Trench : « Vous êtes décidée à aller jusqu’au bout… » Mais on lui parle à l’oreille. Il se lève : « Le devoir m’appelle ! » A la belle, il propose bien de dîner le lendemain mais M ramènera l’agent 007 à sa mission.
Nous sommes en 1962 et ces images scellent le sort d’un comédien écossais de 32 ans. Sean Connery, disparu hier à l’âge de 90 ans, devenait le plus célèbre agent secret au monde. Entre 62 et 1971, six Bond et un septième film non officiel (Jamais plus jamais en 1983) permettront à Sir Sean d’installer son 007 dans l’éternité du grand écran. Les autres Bond, de Lazenby à Craig en passant par Moore, Dalton et Brosnan, ne sont pas mauvais. Sean Connery reste le plus grand.
LA RUEE VERS L’OR.- La légende raconte que, bien après la sortie de La ruée vers l’or, l’une des petites-filles de Chaplin, qui venait de découvrir le film, n’arrivait pas à croire que son grand-père et Charlot étaient une seule et même personne. Elle fut émue aux larmes lorsqu’il débarrassa un coin de table et exécuta, devant elle, la Danse des petits pains…
 A l’origine, The Gold Rush, dont le tournage débute en décembre 1923 (avec la construction de la cabane sur balancier, autre scène fameuse) était un film muet. Quelques mois après la sortie du Dictateur, Chaplin réalise, en 1942, une version sonorisée, synchronisant notamment la danse des petits pains et la musique de façon très précise. Cette séquence fait partie d’un rêve de Charlot où tout ce qu’il désire se réalise: briller devant Georgia, une entraîneuse de saloon dont il est tombé amoureux mais qui se joue de lui. Dans ce rêve, il imagine qu’il va impressionner les danseuses en transformant habilement les petits pains ordinaires du repas en chaussons de danseuse classique.
A l’origine, The Gold Rush, dont le tournage débute en décembre 1923 (avec la construction de la cabane sur balancier, autre scène fameuse) était un film muet. Quelques mois après la sortie du Dictateur, Chaplin réalise, en 1942, une version sonorisée, synchronisant notamment la danse des petits pains et la musique de façon très précise. Cette séquence fait partie d’un rêve de Charlot où tout ce qu’il désire se réalise: briller devant Georgia, une entraîneuse de saloon dont il est tombé amoureux mais qui se joue de lui. Dans ce rêve, il imagine qu’il va impressionner les danseuses en transformant habilement les petits pains ordinaires du repas en chaussons de danseuse classique.
Beau morceau de bravoure incrusté dans le récit, la scène des petits pains puisqu’elle est une affaire de pieds, de chaussure et de nourriture, constitue une revanche sur le corps de Charlot, redevenu gracieux et aérien en ayant retrouvé le plein usage de ses pieds agiles le temps de cette danse. On avait, auparavant, vu Charlot (privé, par la neige, de sa célèbre démarche sautillante) mettre son pied enrobé de chiffons dans le poêle, afin de le réchauffer…
© Photos DR / PLC

