UN COLIS DANS LA NEIGE POLONAISE ET L’EMPLOYÉE SOURDE ET FRUSTRÉE 
 LA PLUS PRECIEUSE DES MARCHANDISES
LA PLUS PRECIEUSE DES MARCHANDISES
Il était une fois, dans un grand bois, par un froid glacial, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne… D’emblée, le narrateur nous interpelle. Non, il ne s’agit pas du Petit Poucet. D’ailleurs qui pourrait croire à ce conte car aucun parent n’abandonne ses enfants quand il n’y a plus de quoi manger ! Mais alors, pourquoi abandonne-t-on un enfant ? Parfois, justement, parce qu’on les aime. C’est tout! Voilà ce que nous dit La plus précieuse des marchandises. En s’appuyant sur l’oeuvre éponyme de Jean-Claude Grumberg, Michel Hazavanicius signe un superbe drame d’animation qui nous emporte dans les vastes étendues couvertes de neige de Pologne régulièrement traversées par de longs et sinistres convois ferroviaires. Connu pour le diptyque OSS 117 (2006-2009) ou The Artist (2011), on n’attendait pas Michel Hazavanicius du côté de La plus précieuse des marchandises. Faut-il chercher une explication dans les propos tenus sur France Inter où il disait qu’il n’avait longtemps eu cure de sa judéité mais qu’avec les temps qui courent, il se sentait Juif et dans la nécessité de s’affirmer tel. Plongée donc dans la Pologne rurale durant la Seconde Guerre mondiale au côté d’un couple misérable. Chaque jour, au loin, passent les trains. La femme pense que les wagons sont remplis de marchandises et que, peut-être, la providence fera tomber un colis. C’est sur une toute autre marchandise qu’elle va mettre la main. Tandis qu’elle avance dans la neige, elle entend des cris de bébé. Pleine de bonheur, elle ramène le nourrisson chez elle. Mais le pauvre bûcheron ne l’entend pas de cette oreille. Lui qui marche régulièrement, le long de la voie ferrée, sait que ces sinistres convois de la mort emportent les Juifs vers l’enfer des camps. Enveloppé dans un talit, le châle de prière des Juifs, le bébé est donc un « sans coeur » issu de la « race maudite », selon l’expression des nazis. De fait, en chemin vers Auschwitz, un père de famille a craqué. Sa femme tenait, dans ses bras, ses deux enfants. L’homme a saisi la fillette et, à travers les barreaux du wagon, l’a lancé dans la neige, lui offrant une hypothétique survie. Entre la pauvre bûcheronne et le pauvre bûcheron, les relations sont désormais glaciales. La femme dort dans la grange avec le bébé. Lui rumine. Petit à petit, la magie de l’enfance innocente opère et le pauvre bûcheron se laissera emporter aussi par un bel amour pour sa « petite marchandise», scandant dans sa tête « Les sans coeur ont un coeur ». Pourtant, tandis que la pauvre bûcheronne obtient de l’aide et… du lait de chèvre, d’un vieux soldat à la gueule cassée, bien des épreuves attendent encore cette famille… En donnant longtemps la prime, dans son récit, à ces Justes que sont les deux bûcherons attachés à sauver coûte que coûte la fillette, Hazanavicius aborde, quasiment par la suggestion, l’horreur des camps. Le film se passe alors de dialogues, laissant opérer Schluf mayn feygele, une berceuse yiddish… Porté par la belle voix de Jean-Louis Trintignant, dans son ultime apparition vocale au grand écran (accompagné par Dominique Blanc, Gregory Gabedois et Denis Podalydès), La plus précieuse des marchandises parle, au-delà de l’horreur de la déportation, de solidarité, d’entraide et résistance. « Dans n’importe quelle circonstance, dit encore le cinéaste, on peut faire le choix de la dignité et de l’humanité. » Rien de tout ça n’est arrivé, dit in fine le narrateur. Comme n’ont pas existé les trains, les cris, les pleurs, la douleur, la nuit, le brouillard, le feu, les cendres, la sauvagerie industrielle… Ce qui importe, c’est l’amour. Tout le reste est silence. (Studiocanal)
 SUR MES LEVRES
SUR MES LEVRES
Discrète employée dans une société de promotion immobilière, Carla Bhem a tout de la bonne à tout faire, voire du bouc émissaire. Pire que cela, comme elle est malentendante, cette jeune femme solitaire est ignorée par ses collègues dont elle subit des moqueries effectuées à son insu. Erreur ! La petite employée avec ses aides auditives planquées sous ses cheveux mal peignés, sait lire sur les lèvres. Afin d’alléger sa charge de travail, elle obtient l’embauche d’un stagiaire auprès de l’ANPE. Voilà donc que débarque Paul Angeli, belle gueule de voyou et type sans expérience dans les photocopies. Paul sort de prison et reste sous la surveillance de Masson, son contrôleur judiciaire. Instantanément, son comportement impulsif et son charisme troublent Carla, bien qu’elle rejette ses avances maladroites. Peu après son arrivée, Paul est violemment agressé au bureau par un homme venu lui rappeler qu’il doit une importante somme d’argent à Marchand, un gérant de boîte de nuit impliqué dans des activités illégales. Pour rembourser sa dette, Paul abandonne son poste dans la société et commence à travailler comme barman pour Marchand. Troisième film de Jacques Audiard, Sur mes lèvres est une œuvre, incontournable dans la filmographie du cinéaste. Sorti au cinéma en 2001, cinq ans après Un héros très discret son précédent long métrage, Sur mes lèvres est un film singulier et troublant, brouillant la frontière des genres cinématographiques, Audiard y naviguant entre le drame social et le thriller haletant. Film noir, western, drame, marivaudage moderne, polar, mélo, comédie musicale, depuis ses débuts, le fils du grand Michel Audiard, le dialoguiste des Tontons flingueurs (1963), jongle avec les codes du cinéma de genre, variant les formes et forgeant, avec ses équipes, un langage filmique inédit. Son dernier opus, Emilia Perez en atteste pleinement. Esthétisant le quotidien, le cinéma d’Audiard décolle du réalisme, touche le sensible et le sensoriel jusqu’à atteindre une stylisation qui lui est propre. Voir un film d’Audiard, c’est vivre une expérience presque primitive du cinéma qui passe par les images, les sons et les silences mystérieux. Audacieux de film en film, ses longs métrages sont de plus en plus populaires, ses récompenses quasi systématiques. Sur mes lèvres remporte en 2002, trois César (Meilleur actrice, Meilleur scénario, Meilleur son). Partant du drame social pour virer au polar palpitant, le cinéaste orchestre une rencontre, de plus en plus intense, entre une employée frustrée et un stagiaire fruste. Emmanuelle Devos est parfaite en fille trouble, saisie par le vertige de la domination et de la cruauté face à ceux qui la briment. Vincent Cassel, ex-taulard aux cheveux gras, lui donne parfaitement la réplique tandis que le cinéaste explore deux âmes blessées et esseulées qui ne parviennent pas à trouver leur place dans la société. (Pathé)
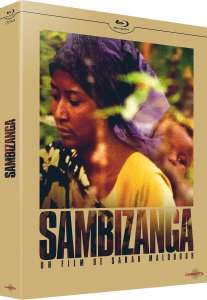 SAMBIZANGA
SAMBIZANGA
En 1961, Domingos Xavier, un militant révolutionnaire angolais, est arrêté par la police secrète portugaise. Il est emmené à la prison de Sambizanga à Luanda. Il y subit des interrogatoires puis des tortures destinés à lui soutirer les noms de ses contacts indépendantistes. Maria, la femme de Domingos, (dont le film endosse le point de vue) part avec son bébé sur le dos à la recherche de son mari de prison en prison. Elle se débrouille seule. Elle crie sa rage. Aidée dans sa quête par des hommes et des femmes sensibles à son histoire et à la cause de Domingos, elle ne faiblit pas. La mort de Domingos Xavier va provoquer l’attaque de la prison de Luanda le 4 février 1961, date officielle du début de la lutte armée contre l’occupant portugais. Réalisé par Sarah Maldoror et sorti en 1972, Sambizanga est une adaptation du roman de José Luandino Vieira A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. Hommage aux combattants de l’ombre, ce drame politique, interprété par des non-professionnels, est à la fois une tragédie intimiste et une œuvre poétique engagée signée de l’une des figures majeures du cinéma panafricain. Véritable pionnière et figure de proue du cinéma africain, Sarah Maldoror (1929-2020) donne un portrait émouvant des débuts de la lutte de libération angolaise tout en mettant largement l’accent sur la place des femmes dans ce combat. « Cela pourrait être, dit la cinéaste, l‘histoire de n’importe quelle femme qui part pour retrouver son mari. En 1961, la conscience politique des gens n’était pas encore mûre. (…) Dans le village où vit Maria, les gens n’ont aucune idée de ce que signifie « indépendance ». Les Portugais empêchent toute information et un débat sur le sujet est impossible. (…) Mon souci principal était de rendre les Européens, qui ne savent pas grand chose de l’Afrique, conscients de cette guerre oubliée en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau. » Cette édition, dans une superbe restauration 4K, disponible pour la première fois en Blu-ray, est accompagné de nombreux suppléments. On y trouve une introduction de Martin Scorsese, un entretien avec Annouchka de Andrade et Henda Ducados (6 mn) réalisé par Antoine Aphesbero dans le cadre de l’exposition « Sarah Maldoror : cinéma tricontinental » (2021-2022) au Palais de Tokyo à Paris. À partir de documents et photographies, les deux filles de la cinéaste reviennent sur le parcours de Sarah Maldoror pour dresser un portrait intime de la femme et mère qu’elle fut. On découvre aussi quatre films inédits de la cinéaste. Monangabééé (1969 – Noir & Blanc – 16 mn), premier film de Sarah Maldoror, laisse parler les corps et la musique pour donner voix à la résistance du peuple angolais contre le colonialisme portugais. Puis Trilogie de carnaval (Fogo, île de feu (1979 – 34 mn), A Bissau, le carnaval (1980 – 19 mn) et Carnaval dans le Sahel (1979 – 30 mn). En découvrant en 1978 les îles du Cap-Vert après leur indépendance, Sarah Maldoror est saisie par cet archipel et décide d’y tourner trois films comme une urgente nécessité. Elle capte la rudesse de la vie sur l’île volcanique de Fogo, puis filme les préparatifs et les festivités du carnaval à São Vicente et en Guinée-Bissau. Enfin, comme livret (124 pages), le fac-similé du n°720 (février 2025) de L’Avant-scène Cinéma avec des entretiens, A à Z sur Sarah Maldoror, souvenirs de tournage, revue de presse, fiche technique, scénario original, dialogues français et portugais… (Carlotta)
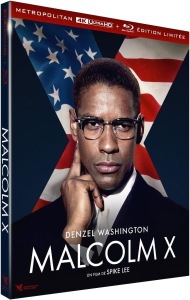 MALCOLM X
MALCOLM X
Né en 1925 dans le Nebraska, Malcolm Little vit de petits emplois et de magouilles en essayant de profiter au maximum de la vie… Il deviendra gangster à Harlem pour le compte d’un caïd avec lequel il se brouillera pour un malentendu financier. Il file alors à Boston, retrouve Shorty, son meilleur ami. Un cambriolage chez un couple blanc et riche leur vaudra une dizaine d’années de prison. En détention, il croise Baines, un autre détenu noir, qui l’aide à sortir de son addiction à la cocaïne. Malcolm reste méfiant lorsque Baines fait la promotion de l’islam mais il est toutefois progressivement convaincu et Baines l’éduque en le présentant à la Nation of Islam (dont Malcolm deviendra plus tard le leader charismatique) en insistant sur le fait que « Dieu est noir »… Commence alors la trajectoire qui va faire de lui l’une des grandes icônes des mouvements afro-américains pour abolir les discriminations raciales aux États-Unis au même titre que Rosa Parks, Martin Luther King ou encore Mohamed Ali… A la fin des années 80 et au début des années 90, Spike Lee est au sommet de la vague. Il tourne à un rythme soutenu et donne successivement Nola Darling n’en fait qu’à sa tête (1986), Do The Right Thing (1989), Mo’ Better Blues (1990, Jungle Fever (1991). Il va alors enchaîner avec ce film biographique sur Malcolm X, basé sur l’autobiographie coécrite avec le journaliste Alex Haley. Spike Lee évoque ainsi l’enfance difficile à Omaha, la prison où il apprend à cultiver la fierté de sa race, l’entrée dans l’organisation d’inspiration islamiste, le mariage avec l’infirmière Betty Shabazz, le pèlerinage à la Mecque et son assassinat le 21 février 1965 au cours d’un meeting à Harlem. Bien avant la mode des biopics, Spike Lee s’attache, en 1992, à proposer son regard sur un personnalité hors du commun et dont, avant de voir le film, on ne sait finalement pas tant que ça. Pour l’aider dans sa tâche, il peut compter sur Denzel Washington qui réussit l’un de ses meilleurs rôles. Malgré de bonnes critiques, le succès au box-office ne sera pas au rendez-vous. Le film culmine avec une scène montrant le militant anti-apartheid Nelson Mandela, alors récemment libéré de prison, citant l’un des discours de Malcolm X dans une salle de classe en Afrique du Sud. (Metropolitan)
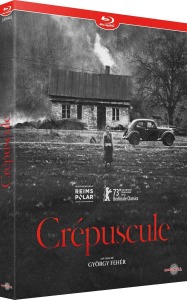 CREPUSCULE
CREPUSCULE
Le corps de la petite Anna, huit ans, est découvert au fin fond d’une forêt. Deux inspecteurs sont dépêchés sur place pour mener l’enquête et retrouver le dangereux tueur en série qui a déjà sévi deux fois dans la région. Lorsque leur unique suspect, un colporteur, met fin à ses jours en se jetant d’une fenêtre du commissarait, les enquêteurs décident de partir sur une nouvelle piste, s’aidant pour cela d’un dessin de la dernière victime… Pour son premier long-métrage de cinéma en 1990, le réalisateur hongrois Gyorgy Feher (1939-2002) s’est inspiré du roman policier La Promesse de Friedrich Dürrenmatt, également adapté par Sean Penn en 2001 dans The Pledge. À l’instar de son compatriote Béla Tarr, consultant sur le film, le cinéaste hongrois s’ingénie à dilater le temps en travaillant avec des travellings et des panoramiques qui rendent ainsi palpables l’attente fébrile de l’enquêteur en chef et sa quête obsessionnelle de la vérité. Lauréat du Léopard de bronze au Festival de Locarno 1990, Crépuscule est un étrange thriller très contemplatif qui joue avant tout la carte d’une atmosphère singulière et funèbre. Le cinéaste entraîne le spectateur dans un univers de montagne et de forêt qui baignent constamment dans une lumière grise traversant des ambiances brumeuses dans laquelle apparait une maison isolée qui fait station-service. Autour de la maison, une fillette joue avec un ballon et on n’évite pas la référence à M le maudit de Lang et à son tueur d’enfants d’autant que le film ne nie pas sa dimension expressionniste. Si ce conte noir est très virtuose sur le plan formel avec ses cadrages sophistiqués et ses longs plans larges immobiles, Crépuscule ne donne pas toutes les clés de l’intrigue. On a ainsi du mal à saisir clairement les motivations des personnages, qu’il s’agisse de l’inspecteur qui scrute le paysage avec ses jumelles et finit par s’emporter contre la fillette autour d’un mystérieux chocolat ou encore le moustachu alcoolique qui violente sa compagne… Disponible pour la première fois en Blu-ray dans une version restaurée 4K, l’édition comprend deux entretiens. Dans Une lumière particulière (33 mn), Miklos Gurban, le directeur de la photographie de Crépuscule raconte sa rencontre avec Gyorgy Feher et détaille sa méthode de travail atypique, axée sur les plans-séquences, l’éclairage et la performance des acteurs. Dans Le long affrontement (24 mn), Maria Czeilik, la monteuse attitrée de Feher revient sur leur relation professionnelle, aussi enrichissante qu’éprouvante, et sur la complicité qui liait le cinéaste à Béla Tarr. Enfin, on y trouve deux courts-métrages inédits du cinéaste : Oregek (1969 – Noir & Blanc – 16 mn) est un documentaire dans lequel des personnes âgées confient leurs difficultés au quotidien à des représentants du Parti venus les écouter. Tomikam (1970 – Noir & Blanc – 23 mn) raconte comment une promesse non tenue entre un vieux philatéliste et un jeune célibataire roublard va conduire ce dernier devant un tribunal et remettre en cause son existence… (Carlotta)
 GLADIATOR 2
GLADIATOR 2
Avec sa maigre troupe de (valeureux) combattants, le Numidien Hanno affronte, dans une bataille navale rudement violente, les troupes de Rome conduites par le général Marcus Acacius… La rébellion contre l’empire tourne hélas au détriment d’Hanno qui voit même sa compagne Arishat mourir, frappée d’une flèche en pleine poitrine. Pour Hanno, désormais, la rage de la vengeance anime son coeur et son esprit. Prisonnier des Romains, conduit dans la capitale, Hanno rejoint les rangs des gladiateurs qui donnent, régulièrement, un brutal divertissement dans la vaste arène du Colisée. Pris en main par Macrinus, un « manager » de gladiateurs qui lui lance « Cette rage est ton don », Hanno va s’imposer comme un combattant de premier ordre. A Macrinus, il ne demande qu’une faveur : pouvoir affronter le général Acacius qu’il tient pour responsable de son drame. Il aura bientôt l’occasion d’affronter le général romain car celui-ci fomente sans succès une insurrection contre les empereurs Geta et Caracalla, impressionnants tyrans complètement dégénérés… Que Ridley Scott, réalisateur du premier Gladiator, s’attelle au second, n’a rien de surprenant. D’autant que le Britannique de 86 ans a clairement le goût des gros machins censés en mettre plein la vue à un public amateur de divertissements spectaculaires. Lorsqu’on voit, dans les premières séquences, des gamins jouer au football au pied des pyramides de Numidie, on constate qu’une fois de plus, Scott se moque de l’Histoire comme de sa première calliga. Le sachant, on n’y fait plus vraiment attention pour se contenter de suivre le spectacle. Après la bataille navale initiale, c’est surtout dans l’arène que le show trouve sa place. Ainsi Hanno va se bagarrer avec des mandrills sanguinaires, affronter Le destructeur monté sur une énorme rhinocéros ou reconstituer la bataille de Salamine dans un Colisée transformé en piscine géante peuplée de requins affamés… Le spectacle est volontiers pompeux et la mise en scène boursouflée et riche de multiples clameurs. Paul Mescal, l’interprète d’Hanno/Lucius, a plus de muscles que de charisme et seul Denzel Washington tire vaguement son épingle du jeu en composant, avec son Macrinus, un grand méchant, passant d’entrepreneur à un politique retors cultivant la loi du plus fort. On se gardera de filer la métaphore mais probablement que, pour Scott, Rome c’est l’Amérique et Hollywood le Colisée et ses jeux du cirque… (Paramount)
 HERE – LES PLUS BELLES ANNEES DE NOTRE VIE
HERE – LES PLUS BELLES ANNEES DE NOTRE VIE
Raconter l’histoire de l’Amérique à travers une maison qui évolue de 10 000 avant Jésus-Christ à 2022, sacrée ambition ! C’est ainsi qu’au fil des époques, vont se succéder Richard, un aspirant artiste peintre et Margaret, une aspirante avocate qui vivent chez Al, ancien vétéran de la Seconde Guerre mondiale et Rose, les parents du premier et qui deviendront les principaux personnages d’un vaste récit choral. Passeront aussi par là divers autres personnages dont le fils illégitime de Benjamin Franklin, un couple de bourgeois, un inventeur et sa femme, de même qu’un couple d’Afro-Américains et leur femme de ménage mexicaine… En adaptant le roman graphique éponyme de l’Américain Richard McGuire, paru chez Gallimard en récompensé du Fauve d’Or du meilleur album de l’année au Festival d’Angoulême 2016, Robert Zemeckis trouve évidemment un matériau qui lui offre de belles pistes cinématographiques (en mettant en œuvre une technologie innovante permettant de superposer les temporalités et les images) autant que thématiques. Ici et là, s’ouvrent des fenêtres sur différentes époques, amenant les récits à se répondre pour mettre en lumière l’évolution des mœurs et le passage du temps, évoquant aussi les secousses socio-économiques, les progrès de la science, l’immigration, voire le mouvement Black Lives Matter… On avait perdu de vue le Robert Zemeckis qui séduisait tant le public avec la trilogie Retour vers le futur (1985-1990), Qui veut la peau de Roger Rabbit (1988) ou l’incontournable Forrest Gump (1994) dont il retrouve, pour Here, les deux comédiens principaux Tom Hanks et Robin Wright qui incarnent, ici, Richard et Margaret… En dernier, Zemeckis avait joué, sans grande réussite, l’actuelle carte Disney avec les reprises des classiques en prises de vues réelles. Le revoilà donc avec une bonne histoire puisqu’il ne s’agit rien de moins que de détailler une étonnante odyssée à travers le temps et la mémoire, les amours et les conflits au coeur d’une maison de Nouvelle-Angleterre sur fond de couples et de familles au fil des générations. (M6)
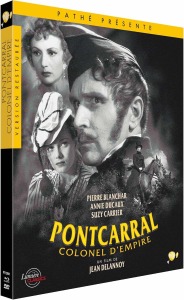 PONTCARRAL, COLONEL D’EMPIRE
PONTCARRAL, COLONEL D’EMPIRE
C’est au coeur de l’Occupation que Jean Delannoy sort Pontcarral, colonel d’Empire, un film (subventionné par l’État français!) qui met en scène, sous le couvert d’un drame romantique en costumes, un audacieux hommage à la Résistance à travers le personnage de Pierre Pontcarral, fidèle de Napoléon même après la chute de l’Empire en 1815. L’écho à la situation politique que vit la France sous le régime de Vichy est patent. « Il faut se reporter, dit bien le cinéaste, à l’occupation allemande, en 1942, pour juger ce film que nous avons voulu faire pour exalter la Résistance. Pas question à l’époque de traiter un sujet contemporain, mais par le truchement du personnage de Pontcarral, nous avons réussi à exprimer le sentiment de l’honneur qu’il incarnait dans toute son intransigeance… » Pontcarral, c’est donc l’histoire d’un baron et ancien colonel d’Empire sous Napoléon, méprisé de tous pendant la Restauration. Lorsque Garlone de Ransac, une fière aristocrate, lui propose de l’épouser, il y voit une possible revanche sur la société. C’était sans se douter que la redoutable Garlone l’utilise aussi pour une vengeance personnelle… Le film est porté par Pierre Blanchar, totalement habité dans son rôle de colonel-baron. Le comédien révèle ses grandes qualités d’acteur dans un jeu dénué d’emphase. Face à lui, deux femmes jouent deux caractères opposés. Suzy Carrier a du charme et de la spontanéité. Annie Ducaux, belle, hautaine et pourtant sensible, incarne l’élégance et la séduction aristocratique. C’est à la veille de la guerre que Jean Delannoy débute sa carrière de réalisateur. En 1939, il tourne son premier grand succès, Macao, l’enfer du jeu, qui ne sortit sur les écrans qu’en 1942, après que toutes les scènes avec Erich von Stroheim aient été refaites avec Pierre Renoir, Stroheim étant interdit d’écran par l’occupant. C’est aussi en 1942 que le cinéaste va connaître la consécration avec son Pontcarral tiré d’un roman d’Albert Cahuet. En 1943, ce sera l’apothéose avec L’éternel retour, écrit et coréalisé avec Jean Cocteau. Puis s’enchaineront Le Bossu (1944) où il retrouve Pierre Blanchar dans le rôle de Lagardère et plus tard La Symphonie pastorale (1946) qui remportera la première Palme d’or au Festival de Cannes. Jean Delannoy (1908-2008) laisse derrière lui une œuvre abondante. Féru des grands mythes et des histoires d’amour célèbres, il est grand amateur de films en costumes et aime transposer à l’écran les œuvres des grands auteurs (Notre-Dame de Paris en 1956 ou La Princesse de Clèves en 1961). Le film fut censuré en partie, l’occupant supprimant certains dialogues (rétablis à la Libération) tels que cette phrase de Louis-Philippe : « Il est temps de sortir la France de ses humiliations, de rendre à son drapeau un peu de gloire ». Lors de la première à Paris en décembre 1942, le public lui fit un triomphe en criant : « Vive la France ! » (Pathé)
 FINALEMENT
FINALEMENT
Dans un monde de plus en plus fou, Lino, qui a décidé de tout plaquer, va se rendre compte que finalement, tout ce qui nous arrive, c’est pour notre bien ! A 86 ans, Claude Lelouch n’en a pas fini avec le cinéma. Et on s’en réjouit. Et si Finalement était son dernier film ? Allez savoir… Car le cinéaste d’Un homme et une femme a le cinéma tellement chevillé au corps qu’on se doute bien qu’il a encore envie d’y revenir. Voici donc l’histoire de Lino Massaro, un avocat réputé pour ses vibrantes plaidoiries. Déçu du monde dans lequel il vit, il décide de tout plaquer et de partir sur les routes de France. Frappé d’une maladie mentale, il est contraint d’exprimer ses sentiments les plus profonds. De quoi paraître cinglé à ses interlocuteurs. Mais c’est la musique (orchestrée par Ibrahim Maalouf et Didier Barbelivien) et sa trompette, qui pointe dans son sac, qui vont atténuer son malheur… Finalement s’inscrit pleinement dans l’oeuvre de Lelouch qui dit : « Je suis sincère quand je dis n’avoir fait qu’un seul film ». Puisque chacun a inventé le suivant. D’ailleurs ce 51e opus est lié plus spécialement à deux films précédents de Lelouch : L’aventure c’est l’aventure (1972) et La Bonne année (1973). Lino, le personnage principal incarné par Kad Merad, est le fils de Simon, campé par Lino Ventura dans La Bonne année. Quant à Sandrine, jouée par Sandrine Bonnaire, elle est la fille de Nicole, interprétée par Nicole Courcel dans L’aventure c’est l’aventure. Finalement prolonge aussi Itinéraire d’un enfant gâté (1988) en abordant le thème de la liberté. Belmondo comme Kad Merad, ici et pour la première fois chez Lelouch, dans leurs départs respectifs, incarnent ce sentiment : le désir de recommencer sa vie. Alors de quoi parle Finalement ? De la même chose que les précédents ! La vie et les relations humaines sous toutes leurs facettes avec l’amour, le sexe, l’amitié, la tristesse, la famille, la création, le cinéma, la France, la trahison, la politique… La musique aussi! Ce n’est pas la première fois non plus que Lelouch signe un film musical mais, pour Finalement, c’est une évidence. « Peut-être, dit le cinéaste, parce qu’on y évoque Dieu et que la musique est son langage. A chaque fois que l’on en écoute, on se sent porté… » Si on ajoute les beaux paysages de Bourgogne, d’Occitanie, le Mont Saint Michel ou Avignon et une ribambelle de comédiens (Michel Boujenah, Sandrine Bonnaire, Barbara Pravi, Elsa Zylberstein, Françoise Gillard, Françoise Fabian, Marianne Denicourt, Clémentine Célarié, François Morel, Raphaël Mezrahi), on tient un bon cru de Lelouch. (Metropolitan)
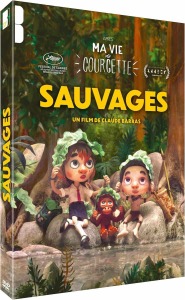 SAUVAGES
SAUVAGES
À la lisière de la forêt tropicale de Bornéo, Kéria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment, Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Ensemble, Kéria, Selaï et le bébé singe luttent contre la destruction de la forêt ancestrale, plus que jamais menacée. Mais pour Kéria, ce combat sera aussi l’occasion de découvrir la vérité sur ses origines… Après l’excellent Ma vie de courgette (César 2017 du meilleur film d’animation), le réalisateur Claude Barras revient avec un nouveau chef-d’œuvre du film d’animation en forme de conte familial et écologique au cœur de la jungle de Bornéo. Réalisé en stop-motion, ce film enchanteur à la fois drôle, sensible et touchant accomplit une belle prouesse technique. Avec ses couleurs chatoyantes, son univers visuel est d’une véritable splendeur, et l’on s’émerveille en découvrant la faune et la flore locales. L’ambiance sonore s’avère des plus immersives, faisant découvrir les riches sons de la forêt tropicale. Enfin, le doublage de qualité, avec les voix françaises de Benoît Poelvoorde, Michel Vuillermoz et Laetitia Dosch, donne vie à des personnages plein de charme. Si Sauvages (sélectionné au Festival de Cannes 2024 et nommé au César du meilleur film d’animation 2025) est une belle aventure initiatique pleine de tendresse et de péripéties, ce long métrage est aussi une magnifique fable pédagogique sur l’écologie. Véritable ode à la nature, à la forêt et à ses habitants, le film dénonce intelligemment la triste réalité de la déforestation et le désastre écologique qui en résulte, sensibilisant petits (à partir de 6 ans) et grands à des enjeux cruciaux. (Blaq Out).
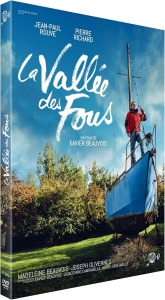 LA VALLEE DES FOUS
LA VALLEE DES FOUS
Passionné de voile, Jean-Paul Choveau est dans une mauvaise passe. Il accumule les dettes et surtout s’éloigne des siens. Bien décidé à reprendre sa vie en main, ce type veuf et alcoolique s’inscrit à Virtual Regatta, la course virtuelle du Vendée Globe (course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale, ni assistance, ayant lieu tous les quatre ans, en novembre, au départ des Sables d’Olonne), en espérant remporter l’une des dotations accordées aux trois premiers de la course. Pour atteindre son objectif, et bien que la course soit virtuelle, il se met dans les conditions d’un vrai skipper en s’isolant pendant trois mois sur son bateau installé dans le jardin de son restaurant du côté de Port-la-Forêt dans le Finistère… Son vieux père et sa fille Camille n’en croient pas leurs yeux mais ce voyage pas comme les autres permettra à Jean-Paul de renouer avec sa famille, mais surtout avec lui-même. Après Albatros en 2021 qui racontait, avec beaucoup de force, la vie quotidienne des gendarmes entre vie privée et professionnelle devant la misère sociale, le suicide, les affaires de pédophilie, de vols, etc., Xavier Beauvois est de retour avec un loser même pas vraiment magnifique emporté dans une aventure de résilience. En imaginant l’océan dans son jardin, le pari que se lance ce participant virtuel au Vendée Globe a quelque chose d’un peu tragique. Heureusement Xavier Beauvois, réalisateur de N’oublie pas que tu vas mourir, prix du Jury au Festival de Cannes 1995 et de Des hommes et des dieux, Grand prix de Cannes 2010 et César du meilleur film en 2011, sait mettre en scène cette histoire poétique d’un homme à la dérive, réanimé par une idée folle. C’est aussi l’occasion pour le cinéaste d’évoquer, avec réalisme et justesse, des thèmes comme la solitude et la famille. Pour La vallée des fous, Beauvois peut enfin compter sur de bons comédiens avec Jean-Paul Rouve bouleversant de sensibilité en type qui se relève, Pierre Richard, 90 ans, épatant en vieux père ou Madeleine Beauvois, la fille du cinéaste, dans le rôle de Camille… (Pathé)
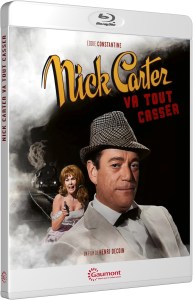 NICK CARTER VA TOUT CASSER
NICK CARTER VA TOUT CASSER
Scientifique français, le professeur Fromentin vient de mettre la touche finale à une invention qui sera capable de détruire toute sorte d’appareil volant. Un gang du crime international est très intéressé par cette invention afin de la vendre au plus offrant. Menacé, le scientifique, qui était ami avec le père de Nick Carter, appelle Nick à l’aide alors que ce dernier s’apprête à partir en vacances. Après avoir échappé à plusieurs attentats (sa voiture plonge notamment dans un ravin et prend feu), le privé se rend compte que c’est l’entourage proche du savant qui complote contre lui… Apparu en septembre 1886 dans une nouvelle de l’Américain John R. Coryell, le personnage du détective privé Nick Carter connaîtra une carrière au cinéma, dans les années 30 et 40, avec une trilogie de la MGM réalisée par Jacques Tourneur et Walter Pidgeon dans le rôle de Carter. En France, dans les années 60, c’est Eddie Constantine qui se glisse dans la peau du privé sans peur avec Nick Carter va tout casser (1964) puis Nick Carter et le trèfle rouge (1965) de Jean-Paul Savignac. Pour Henri Decoin dont on a vu, le mois dernier en Blu-ray, Dortoir des grandes avec Jean Marais, ce Nick Carter (qui sort dans une belle édition Blu-ray) marque l’adieu au cinéma après une carrière de quatre décennies. Porté par un Eddie Constantine (qui fut aussi Lemmy Caution) toujours à l’aise dans le registre cogneur décontracté qui ne craint pas de se colleter avec quatre ou cinq méchants à la fois, ce polar/nanar est du sous-007 filmé sans autre souci que de faire passer un peu de bon temps au spectateur… (Gaumont)
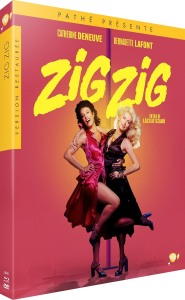 ZIG ZIG
ZIG ZIG
Amies à la vie à la mort, Marie et Pauline se produisent tous les soirs dans un cabaret. Si elles chantent plutôt pas mal en se déhanchant devant des clients passablement avinés, elles se livrent aussi au tapin pour financer la maison de leurs rêves. Un soir, un kidnapping fait s’effondrer l’univers de Marie. Car elle découvre que Pauline (Bernadette Lafont) est impliquée dans l’affaire. Réalisé en 1974 par Laszlo Szabo, comédien fétiche de Jean-Luc Godard, assidu de la Cinémathèque d’Henri Langlois et compagnon de route de la Nouvelle vague, cette comédie, très singulière dans le paysage cinématographique de son époque, est une espèce d’ovni qui mêle le burlesque, le pastiche policier et le mélodrame psychologique. Manifestement, Szabo ne s’est pas trop cassé la tête avec un scénario qui part dans tous les sens, suivant tour à tour les aventures des deux chanteuses, la trajectoire de Jean Mortagne (l’inénarrable Huberrt Deschamps), commissaire retraité mais toujours futé et celle d’une bande de branquignols ravisseurs d’une chanteuse d’opéra sur le retour qui s’en finit pas de maltraiter Verdi. Zig Zig devait être une toute petite entreprise. Elle prit une autre tournure lorsque Catherine Deneuve s’intéressa au projet. La comédienne qui avait déjà joué avec Polanski (Répulsion), Demy (Les demoiselles de Rochefort), Bunuel (Belle de jour), Truffaut (La sirène du Mississipi), Melville (Un flic) s’en mordit, semble-t-il, les doigts. Dans un interview, elle raconta qu’il s’agissait d’un des tournages les plus chaotiques qu’elle ait vécu, le réalisateur étant constamment ivre sur le plateau… Un film rare, fantasmagorique, un thriller saisi par la bouffonnerie. (Pathé)
UNE CENDRILLON DÉLURÉE ET LA MEILLEURE VERSION D’UNE FEMME 
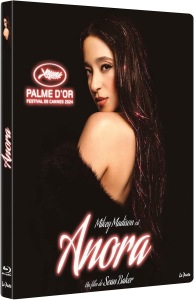 ANORA
ANORA
Il a 21 ans, elle en a 23. Lui est un gamin pourri gâté, fils d’un oligarque russe. Elle est danseuse érotique dans un club de Manhattan où elle aguiche les clients pour les entraîner, selon leurs moyens, dans des cabines privées ou des salons VIP. C’est là qu’Ani et Ivan se rencontrent. Ivan, dont l’existence consiste à faire la bringue avec ses copains, voudrait bien jouer aussi à ces jeux-là. Mais avec une strip-teaseuse parlant la langue de Tolstoï. C’est le cas d’Ani. En riant, tous les deux se parlent en russe. La magie opère. Ivan tombe sous le charme de cette Cendrillon de Brighton Beach, touchante mais vénale. Sur la Croisette, Sean Baker n’est pas un inconnu. Il y a montré The Florida Project (2017) et Red Rocket (2021). Avec son huitième long-métrage, l’Américain signe une Palme d’or qui s’apparente à une… comédie, genre qui n’est pas, et de loin, le plus primé à Cannes ! Anora va ainsi devenir une variation assez singulière sur le mythe de Cendrillon, emblématique du cinéma de Sean Baker. Un conte ancien qui peut, dans le cadre d’une analyse psychanalytique et dans une optique plus spécifiquement sexualisante, poser deux images fondamentales de la femme tout en essayant de les concilier : l’idéal féminin, sublimé, qui attire tous les regards et l’image de la femme simple, sauvage et farouche après minuit. Grand ado dissolu, flambeur et immature, Ivan alias Vanya va se piquer au jeu. Ani est d’abord un épatant jouet érotique et le gamin l’embauche pour plusieurs rencontres sexuelles. Mieux, il s’attache à la jeune femme et lui offre 15 000 dollars pour qu’elle passe une semaine avec lui. L’occasion d’un voyage à Las Vegas fera le reste. Vanya demande la main d’Ani qui n’en croit pas un mot. Une petite chapelle blanche fait l’affaire. Et voilà la petite escort devenue Madame Zakharov. Les réseaux sociaux russes s’emparent de la nouvelle. Galina et Nikolai, les parents d’Ivan, s’alarment. Leur fils marié avec une prostituée ! Alors qu’Anora semblait raconter une (improbable) histoire d’amour, le film bifurque. Les parents Zakharov ont donné des ordres. Toros, Garnick et Igor sont chargés de récupérer Ivan et de mettre immédiatement en œuvre une procédure d’annulation du mariage. Commence alors une course-poursuite trépidante, drôle et sombre. Les nervis investissent le somptueux manoir dans lequel vivent Ani et Ivan. Ce dernier prendre la fuite. Ani est séquestrée, baillonnée mais toujours capable de hurler comme une furie et de distribuer des horions. Même s’il y a quelques longueurs et si Baker est parfois complaisant dans les scènes de sexe, Anora est une œuvre frénétique, qui fonce dans le tas. Baker, qui a souvent filmé l’Amérique des marges, réussit brillamment à montrer le côté moyennement flatteur du rêve américain en pleine dégringolade. Si Anora séduit, c’est aussi à cause de l’épatante performance de Mikey Madison qui fait de son Ani un personnage savoureux, déglingué et pathétique. L’acteur russe Mark Eydelshteyn campe joliment un jeune type richissime et en pleine débauche. Anora nous amuse d’abord avec une love story sur fond de lap dance puis avec une odyssée burlesque qui s’achève de manière bigrement mélancolique. Non, décidément non, Ani-Cendrillon n’a pas fini d’en baver… Quant aux Oscars, Anora a tout simplement raflé la mise : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur scénario original, meilleur montage ! (Le Pacte)
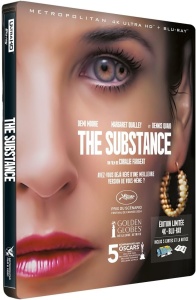 THE SUBSTANCE
THE SUBSTANCE
Femme de la cinquantaine, Elizabeth Sparkle est la star d’une émission télévisée d’aérobic… Un besoin pressant la pousse à entrer dans les wc hommes. Là, elle entend le patron de la chaîne dire qu’elle a fait son temps. Bref, qu’Elizabeth est vieille et bonne à jeter. Elle se souvient qu’alors, aux urgences de l’hôpital où elle était prise en charge à la suite d’un accident de la circulation, une blouse blanche qui lui avait glissé une clé USB. Sur la clé, un message des plus intrigants. « Avez-vous déjà rêvé d’une meilleure version de vous-même ? » Pour cela, il suffit d’essayer The Substance qui permet de générer « une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite ». La proposition tombe pile pour une Elizabeth complètement déprimée d’avoir été virée vite fait. Il suffit de respecter le mode d’emploi. Vous activez une seule fois. Vous stabilisez chaque jour. Vous permutez tous les sept jours sans exception. Il suffit de partager le temps. Simple comme bonjour. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Révélée en 2017 par Revenge, un thriller d’horreur déjà, la cinéaste française Coralie Fargeat a connu, dès sa seconde réalisation, les prestigieux honneurs de la compétition officielle au dernier Festival de Cannes. Avec, pour cerise sur le gâteau, le prix du meilleur scénario pour The Substance qui le mérite tout à fait. Voici en effet du pur cinéma de genre avec de l’horreur qui ne se voile pas la face mais aussi une aventure dans laquelle on se glisse avec une réelle aisance. Probablement parce que cet univers de Barbies trop souriantes où tout n’est qu’apparence nous est familier. Là où la cinéaste réussit son coup, c’est lorsqu’elle revendique le côté extrême de son film, l’excès, la non-subtilité, le lâcher-prise. Au risque de secouer et heurter, elle ne s’est en effet privée de rien. Avec un discours féministe qui a l’intelligence de ne pas nier la complexité des choses, Coralie Fargeat distille une fable sur la chair et la métamorphose, sur la mutation des corps et l’inévitable finitude mais aussi une parabole de la reconnaissance et de l’amour qu’on va chercher dans les yeux des autres. Tout ce qui se passe dans The Substance, est lié au corps, qu’il soit beau et triomphant ou, plus tard, dans le délabrement. Tandis qu’Elizabeth Sparkle quête une sorte d’éternelle jeunesse ou tente au moins d’arrêter les outrages du temps, Sue, clone né de son dos, vit l’ivresse d’une célébrité aussi instantanée que forcément passagère. Le souci, c’est que l’une et l’autre vont rapidement oublier que la voix qui vend cette modification cellulaire de leur ADN, répète « You are One », autrement dit tout ce qui est pris d’un côté est perdu de l’autre… En limitant beaucoup les dialogues, The Substance repose sur une mise en scène rapide, rythmée, allègre et colorée, qui apprécie les plongées, les images anamorphiques, les cadrages en très gros plan. Enfin, cette odyssée de deux belles virant à des freaks peut s’appuyer sur deux comédiennes qui se donnent à fond. Demi Moore et Margaret Qualley (Sue) s’emparent avec brio des deux faces d’une même entité. A 61 ans, la star de Ghost (1990), primée aux Golden Globes, n’a pas dit son dernier mot. Elle donne toute la mesure de son talent, n’hésitant pas à se montrer nue pour affronter sa jeune concurrente dans cette monstrueuse parade en forme de quête absolue de la beauté. (Metropolitan)
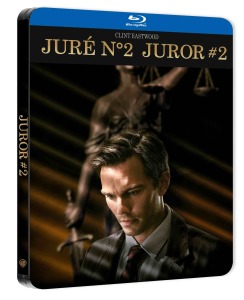 JURÉ N°2
JURÉ N°2
Clint Eastwood est tout simplement une légende, peut-être la dernière, d’Hollywood. Acteur d’abord (ah, Harry Callahan, matricule n°221 de la police de San Francisco) puis, au début des seventies, réalisateur avec une carrière remarquable (Pale Rider, Bird, Impitoyable, Un monde parfait, Sur la route de Madison, Mystic River ou Million Dollar Baby). Et si l’aventure devait maintenant toucher à sa fin ? Le 41e film d’Eastwood, 94 ans, a été annoncé comme l’ultime œuvre du maître. Justin Kemp a tout d’un bon futur père de famille. Il chouchoute son Ally et est prêt à tout pour se faire exempter de son rôle de juré. Il a été tiré au sort pour un procès qui doit juger un certain Sythe accusé d’avoir assassiné sa petite amie Kendall Carter. Kemp demande à être dispensé de son rôle de juré pour rester au côté de sa femme. En fait, il sait qu’il est à l’origine de l’acte criminel qui vaut à Sythe de comparaître.. Kemp se trouvait en effet dans le bar où Sythe et Kendall s’engueulaient copieusement. Dehors, le couple continue à se quereller avant que l’une et l’autre s’éloignent. Kemp, lui, est monté dans sa voiture et a aussi pris la route. Dans la nuit noire, sous une pluie battante, il heurte ce qu’il pense être une bête sauvage. Bientôt, il découvre qu’il a percuté Kendall, la jetant dans le fossé où elle succombe à ses blessures. Avec ce Juré n°2, Eastwood s’inscrit complètement dans les codes d’un genre qui a toujours été en vogue dans le cinéma américain : le film de procès. On retrouve donc ici la grande salle d’audience, la présidente sur son estrade, et, sur leurs bancs, l’avocat de la défense et le représentant de l’accusation, en l’occurrence la procureure adjoint Faith Killebrew, une battante, habillée d’un tailleur très couture, qui ne lâche jamais son os. A travers le décorum du procès et ses péripéties, Eastwood cerne les différentes personnalités en lice, ainsi Faith Killebrew (Toni Collette) en campagne politique pour son élection au poste de procureure générale. Une lourde condamnation de Sythe serait une aubaine dans cette campagne. Mais, évidemment, c’est Justin Kemp qui se trouve au centre du dispositif filmique. Car le juré n°2, taraudé par le dilemme moral « se protéger ou se livrer » va, petit à petit, révéler les facettes troubles de sa personnalité. On retrouve ainsi ce jeune type, rédacteur dans un petit magazine, dans une réunion des Alcooliques anonymes où l’animateur lâche un prémonitoire « On ne souffre que de nos secrets ». Quand, enfin, l’audience sera achevée, vient le temps du délibéré. On ne peut alors s’empêcher de songer au célèbre Douze hommes en colère (1957). L’accusé est (forcément) coupable et tout le monde a envie de vite rentrer chez soi. Justin Kemp va vouloir instiller le doute chez ses confrères jurés. A cette nuance près, que le personnage d’Henry Fonda chez Lumet avait relevé les failles de l’enquête alors que Kemp, pris dans la tourmente, connaît la vérité et semble souvent sur le point de se prendre les pieds dans le tapis… Nicholas Hoult incarne ce garçon propre sur lui, pilier d’une idéale famille américaine. Mais, comme souvent chez Eastwood, le mal est à l’oeuvre et le venin du mensonge comme le dysfonctionnement de la société viennent « pourrir » une image idyllique. La violence est toujours tapie dans un coin et jusque sur le pare-chocs d’une Toyota verte. Indécrottable Américain et vrai humaniste, Clint Eastwood s’applique souvent à glisser un once d’espoir dans ses films. Mais, ici… (Warner)
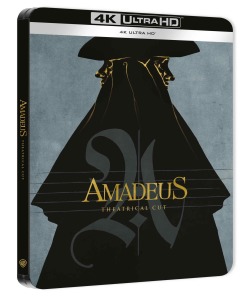 AMADEUS
AMADEUS
Vienne novembre 1823. Au beau milieu de la nuit, un vieil homme égaré crie : « Pardonne, Mozart, pardonne à ton assassin ! ». Sa chambre étant verrouillée, ses serviteurs tentent de l’allécher avec des pâtisseries mais n’entendent que des sons étouffés suivis d’un cri tranchant. Ils enfoncent la porte et tombent sur leur maître tenant un couteau dans la main et la gorge ruisselante de sang. Cet homme n’est autre qu’Antonio Salieri, jadis musicien réputé et compositeur de la Cour. Sa tentative de suicide le conduit tout droit à l’hôpital psychiatrique, où il est entendu en confession par un prêtre, le père Vogler. L’homme se souvient de ses années d’enfance et de jeunesse où son talent lui vaut durant quelques années les plus hautes distinctions. C’est alors que le monde entend parler d’un jeune garçon du nom de Wolfgang Amadeus Mozart, promu à travers toute l’Europe par son père Léopold. Son brio enchante les plus grands personnages et les cours les plus brillantes… En 1781, le jeune Mozart fait irruption à Vienne. Son génie éclate. Salieri en est le premier convaincu. Quand on a du talent mais qu’on est confronté au génie, comment survivre ? Comprenant la menace que représente pour sa carrière le jeune Mozart, Salieri, fou d’orgueil, rejette Dieu et essaie d’évincer Mozart tout en l’approchant pour savoir pourquoi il est si doué. En 1984, émigré à Hollywood depuis 1971, le cinéaste tchèque Milos Forman donne son cinquième film américain en adaptant la pièce éponyme de Peter Shaffer (également auteur du scénario) pour signer une œuvre brillante et fastueuse. A travers le personnage d’un Mozart génial mais sans grande éducation et d’une spontanéité (le grand gamin ne craint pas le caca-prout !) qui détonne dans l’univers compassé de la cour, Forman va construire une image de Mozart qui va s’ancrer dans l’imaginaire populaire tout en faisant aussi de Salieri (l’excellent F. Murray Abraham) un être maléfique. Enorme succès mondial (4,6 millions de spectateurs en France) couronné de huit Oscars dont celui de meilleur film et meilleur réalisateur, Amadeus ressort, en version restaurée 4K, dans une belle édition collector présentée en steelbook avec un livret, des cartes collector et posters. On n’a pas fini -et on s’en réjouit- d’entendre le rire de crécelle de Tom Hulce et, évidemment, les airs des Noces de Figaro, de La flûte enchantée ou les accents tragiques du Requiem. (Warner)
 MAI ZETTERLING – LE CINEMA SUEDOIS AU FEMININ
MAI ZETTERLING – LE CINEMA SUEDOIS AU FEMININ
Née en 1925 en Suède, Mai Zetterling fut d’abord comédienne, tournant notamment avec des cinéastes britanniques mais aussi avec l’incontournable Ingmar Bergman (Musique dans les ténèbres en 1948). Dans les années soixante, elle oriente sa carrière vers la réalisation et va signer, entre 1964 et 1986, une dizaine de longs-métrages. Elle va alors s’imposer, par sa voix franche et puissante, comme une pionnière du cinéma féministe. Ainsi, présenté en sélection officielle au Festival de Cannes 1965, Les amoureux est le premier d’une série de films consacrés prioritairement à l’étude de la condition féminine, interprétés par les stars les plus emblématiques du septième art suédois comme Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Erland Josephson, Gunnel Lindblom, Anita Björk ou Eva Dahlbeck… Dans sa remarquable politique de défense et de promotion du cinéma de répertoire, Carlotta Films sort, pour la première fois en Blu-ray et dans une nouvelle restauration 2K, un beau coffret regroupant quatre films majeurs (et volontiers provocants) de la cinéaste suédoise disparue en mars 1994. On retrouve ainsi Les amoureux (1964) où, dans la Stockholm de 1915 et alors que la guerre vient d’éclater, trois femmes sont ensemble dans une clinique au moment d’accoucher. Elles se remémorent les instants marquants de leurs existences comme autant de jalons de la condition féminine en Suède depuis le début du siècle. Dans Le Monde, Jean de Baroncelli observe : « On connaît la franchise des Suédois à l’égard des problèmes sexuels. Ils disent et montrent le plus tranquillement du monde des choses que l’on n’évoque ailleurs que par de prudentes allusions. Certaines images des Amoureux ont choqué le public ». Le baroque Jeux de nuit (1966) raconte le retour de Jan dans la demeure de sa jeunesse où il fut (à peine) élevé par des parents hédonistes et négligents. Ce retour, sur fond de souvenirs, va bouleverser son existence et celle de sa compagne. Les filles (1968) met en scène la tournée d’une troupe de théâtre dans la province suédoise. Trois comédiennes amies jouent ensemble Lysistrata d’Aristophane. Le message de prise de conscience et de révolte féministe avant la lettre contenu dans cette comédie antique, agit sur les actrices comme un révélateur. Chacune va se rebeller à sa façon. Amorosa (1986) évoque la vie de la romancière Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) dont les écrits traitent de la folie, de l’émancipation des femmes et de sexualité. Enfin, le coffret contient plus de trois heures de suppléments. Ainsi trois courts-métrages dont Le jeu de la guerre (1962, 15 mn), la toute première réalisation de Mai Zetterling. Avec Michèle Rozier, la cinéaste co-signe Réalité Fiction : Mai Zetterling (1977 – 50 mn) avec quatre segments où fiction et documentaire s’entremêlent pour former une mise en abyme passionnante, d’une humanité profonde. Dans Des phoques et des hommes (1981- 30 mn), la cinéaste capte, sur les vastes étendues glacées du Groenland, de saisissantes images de chasse au phoque. Trois actrices dans leurs rôles de Christina Olofson (1996 – 77 mn) réunit, après le décès de la cinéaste, les trois actrices des Filles dans sa maison en France. Enfin, on trouve ici deux entretiens avec la cinéaste : Ciné 3 : Mai Zetterling à Paris (1975 – 7mn) où elle aborde l’importance à la fois cinématographique et politique d’un regard de femme sur les femmes et sur leur condition et Rencontre avec Mai (1984 – 10 mn) où elle revient sur son parcours de cinéaste et sur la misogynie de son milieu, dont elle déconstruit les a priori sexuels. (Carlotta)
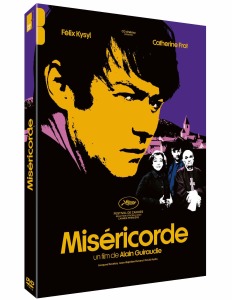 MISERICORDE
MISERICORDE
Jérémie Pastor retourne à Saint Martial, son village d’enfance de l’Aveyron, pour l’enterrement du boulanger, son ancien patron. Martine Rigal, sa veuve, touchée par sa présence, lui propose de passer la nuit dans leur maison, dans la chambre de leur fils Vincent, aujourd’hui marié, et qui fut un camarade de collège de Jérémie. Le trentenaire apprécie de passer à nouveau du temps dans ce village et décide de s’y attarder quelques jours. Il y retrouve aussi Walter, un autre ancien camarade qui vit isolé dans sa ferme, et fait connaissance avec Philippe Griseul, un curé aux intentions étranges. Entre Jérémie et ces différents personnages, entre une disparition mystérieuse et un voisin menaçant, le désir et la violence commencent à circuler. Les films d’Alain Guiraudie laissent rarement indifférents. Il n’est que de se souvenir de L’inconnu du lac (2013) découvert au Festival de Cannes. Et ce sera encore le cas avec Rester vertical (2016), également découvert sur la Croisette. Avec Miséricorde, le cinéaste, originaire de l’Aveyron, en fondant partiellement son scénario sur son roman Rabalaïre (en occitan, un homme qui va chez les uns et chez les autres et qui ne tient pas en place) publié en 2021, entreprend à nouveau un périple dans ces contrées qui lui sont familières et qui emportent le spectateur dans une ruralité impressionnante où l’homme se débat, en toute ambiguïté, autant avec la nature qu’avec ses élans et ses désirs. Mêlant le polar, la tragédie avec même une pointe de burlesque et d’humour noir, le réalisateur explore, non sans malice, les pulsions refoulées d’un village aveyronnais au travers d’un « étranger » qui tisse ou renoue des liens. Distillant un cinéma sous tension dans un récit initiatique mâtiné de fantastique, Alain Guiraudie met aux prises un homme disponible avec une série de types avec lesquels il va partager des émotions sensuelles ou sexuelles. Le cinéaste développe toujours une profonde empathie pour des comédiens qu’il regarde, lui aussi, avec sensualité. C’est le cas de Félix Kysyl, la découverte de Miséricorde, dans le rôle de Jérémie mais aussi de Jacques Develay (le curé Griseul), de Davaid Ayala (Walter) ou encore de Catherine Frot qui, avec sa Martine Rigal, se trouve fort loin, de ses emplois habituels… Miséricorde (qui propose, en supplément, un entretien d’une demi-heure avec le metteur en scène) a obtenu le prix Louis-Delluc 2024 et a été nominé pas moins de huit fois aux César 2025. (Blaq Out)
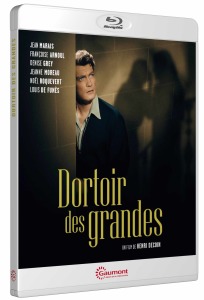 DORTOIR DES GRANDES
DORTOIR DES GRANDES
Etablissement privé pour jeunes filles (riches) dans une petite ville de province, le collège de Méremont est en émoi. Vissia, une jeune pensionnaire, a été découverte étranglée et ligotée sur son lit. Le commissaire Broche, après un tour dans les lieux, confie le dossier à l’inspecteur Désiré Marco, lui mettant le pied à l’étrier pour réussir sa première enquête criminelle. Marco déboule dans le collège et va semer la « panique » autant chez Madame Hazard-Habran, la revêche directrice que chez les profs, toutes femmes, sans oublier des élèves qui n’entendent pas se laisser bousculer par le séduisant flic et qui vont même le harceler… En 1953, Henri Decoin, prolifique metteur du cinéma français des années trente à soixante, qui venait de tourner La vérité sur Bébé Donge avec Jean Gabin et Danielle Darrieux, son épouse de 1935 à 1941, adapte 18 fantômes, le roman du Belge Stanislas-André Steeman. Il réussit un allègre policier dans lequel il enchaîne, autour des recherches de Désiré Marco, de bonnes séquences tant dans les rapports entre le flic et la directrice (l’épatante Denise Grey à l’impressionnant abattage) qu’avec des gamines plutôt déssalées parmi lesquels on reconnaît Françoise Arnoul et une débutante, Dany Carrel, qui se désolait de ce film dans lequel elle se trouvait ronde et moche ! In fine, l’ingénu inspecteur Marco mettra tout ce petit monde au pas avec l’aide de Julie (Jeanne Moreau), la serveuse du restaurant La jument verte tenu dans le village par Emile (Noël Roquevert) et après avoir compris les agissements du peu reluisant Triboudot (Louis de Funès) qui tient la boutique de photographies de Méremont. Au terme d’une reconstitution où le cinéma tient une place de choix (Vissia avait la passion des images!), la vérité tombera ! Jean Marais incarne, ici, un Désiré Marco très tombeur et qui ne laisse aucune des collégiennes (pas si angéliques que ça) indifférentes. Le comédien, qui avait déjà joué dans Orphée (1950), Nez de cuir (1952) et Le comte de Monte Cristo (1953), s’impose alors comme le grand jeune premier du cinéma français. Dortoir des grandes contient des allusions, rares pour l’époque, aux relations homosexuelles entre une élève et sa professeure de maths. Dans les suppléments de ce film qui ressort en Blu-ray, on évoque aussi la manière dont Decoin joue avec l’ambiguïté de Jean Marais à travers la fétichisation de son corps et de son visage… (Gaumont)
 LOUISE VIOLET
LOUISE VIOLET
Dans un bureau poussiéreux, un fonctionnaire informe Louise Violet qu’elle a obtenu un poste d’institutrice. Et observe que la République a été bien généreuse avec la jeune femme, compte tenu de son passé… Le type est persuadé qu’elle ne tiendra pas trois mois dans son poste. Voilà donc Louise Violet, longue robe sombre et petit bibi sur la tête, partant dans de vastes paysages de la campagne française. Dans un petit village, elle a pour mission, en cette année 1889, d’imposer l’école de la République, une école gratuite, obligatoire et laïque. Mais l’institutrice est bien mal accueillie… Joseph, le maire de la commune, doit bien fournir à Louise Violet, un endroit pour vivre. Ce sera une vieille étable. Louise dormira sur la paille, avec une vache pour lui tenir chaud. Mais la jeune femme, qui remarque « qu’elle vit en hiver depuis tellement longtemps », n’est pas vraiment du genre à baisser les bras… Alors que l’actualité tourne constamment le projecteur sur l’Education nationale, Louise Violet apporte un éclairage « ancien » sur les rudes combats de ceux qu’on surnommait, selon la formule de Péguy, les Hussards noirs de la République. Car Louise Violet est l’une de ces institutrices de la IIIe République envoyée sur le terrain pour propager le savoir en étant convaincue que «les capacités sont partout ». Dans le village reculé où elle débarque (le tournage a eu lieu dans la Haute-Loire et le Puy de Dôme), elle est loin d’être la bienvenue. D’abord, elle est une étrangère et si elle entend imposer l’école, elle deviendra une ennemie. Pour aborder les concepts de République et d’éducation, Eric Besnard a tourné un film sur l’école de Jules Ferry puis sur les premières institutrices envoyées dans les campagnes et projetées dans un monde d’hommes à la fin du 19e siècle. Autour de Louise Violet, femme qui porte un terrible secret, voici une chronique rurale, avec le temps et les saisons qui passent, avec des paysans dont l’identité passe par la terre, un bien inestimable. Lorsqu’une « partageuse », nourrie aux thèses de Proudhon et du fameux « La propriété, c’est le vol », vient leur imposer l’école, la tension est inévitable. Avec une Alexandra Lamy en femme forte qui cache ses blessures et un Gregory Gadebois en maire massif mais bouleversé par cette nouvelle venue, Louise Violet est un film attachant et sans doute nécessaire. (Studiocanal)
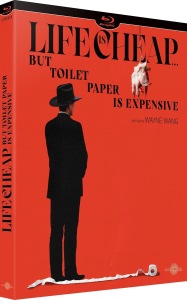 LIFE IS CHEAP… BUT TOILET PAPER IS EXPENSIVE
LIFE IS CHEAP… BUT TOILET PAPER IS EXPENSIVE
Un jeune homme est chargé de transporter une mallette menottée à son poignet de San Francisco à Hong Kong pour la remettre à un certain M. Lo. Mais une fois sur place, le destinataire est introuvable. Impliqué dans la mafia chinoise, celui-ci doit faire face à des dissensions au sein de son organisation. Après s’être fait dérober la mallette par deux truands, le jeune homme va se rapprocher de Money, la mystérieuse et superbe maîtresse de M. Lo… Si le pitch du film (dont le titre provocateur indique d’emblée le ton) ressemble à celui de bien des polars hong-kongais, force est de reconnaître que l’on découvre vite un univers de cinéma qui la joue joyeusement et furieusement déjanté, quelque part entre une avant-garde américaine et une Nouvelle vague asiatique. Reconnu dans les années 1990 avec Smoke (1992) et Brooklyn Boogie (1995), ses deux adaptations de Paul Auster, Wayne Wang a débuté, dans les années 1970, en jouant la carte de l’irrévérence comme en atteste Life is Cheap, sorti en 1989 et inédit en France. Le film est désormais disponible pour la première fois en Blu-ray dans sa version Director’s Cut et une nouvelle restauration 4K. Wang arrive dans sa ville natale avec un tournage libre sans scénario préétabli ou presque mais autour d’un principe directeur : une succession de portraits de personnages hors normes flirtant avec la pègre locale. Il tourne dans les rues de la mégalopole pour capturer la mythologie et l’esprit d’une ville et d’une époque aujourd’hui disparues, celles du Hong Kong d’avant la rétrocession. Voici un vibrant kaléidoscope avec des bouchers tueurs de canards, des familles aisées organisant des mariages pour leurs enfants, des prostituées râlant contre leurs clients, des techniciens enregistrant des bruits de sexe pour des bandes-son porno ou des taxis fonçant dans les rues… Autour d’un personnage sans nom (Spencer Nakasako), portant un chapeau digne du western classique et qui constitue une sorte de fil rouge au coeur de l’action, Wang a construit une comédie néo-noire à l’esprit punk qui ne craint même pas la scatologie… Dans les suppléments, on trouve un entretien avec Wayne Wang (24 mn) dans lequel le cinéaste, né à Hong Kong de parents chinois et exilé aux États-Unis pour ses études, parle de son éducation et de ses influences, avant d’évoquer ses premiers pas au cinéma et le rapport qu’il entretient avec son pays d’origine. Dans Retour sur Life is cheap… (29 mn), Wayne Wang et Spencer Nakasako, acteur, scénariste et coréalisateur du film, reviennent en détail sur la genèse et le tournage de Life is Cheap… ainsi que sur le lien existant à l’époque à Hong Kong entre le milieu de la mafia et celui du divertissement. Enfin on découvre la version longue (10 mn) de la scène de la poursuite en caméra subjective qui est l’un des moments-culte du film. (Carlotta)
 JE VOUS TROUVE TRES BEAU
JE VOUS TROUVE TRES BEAU
Agriculteur dans la Drôme, Aymé Pigrenet vient de perdre son épouse lors d’un accident domestique. Il ne tenait pas vraiment à sa femme, une vraie mégère, mais elle était bien utile pour le travail à la ferme et pour s’occuper de la maison. Il lui faut trouver une nouvelle femme de toute urgence pour l’aider dans ses tâches car, seul, il ne s’en sort plus. Ne sachant pas comment retrouver une épouse, il s’inscrit dans une agence matrimoniale. La responsable lui conseille d’aller en Roumanie, où les filles sont prêtes à tout pour quitter leur misère. Il ramène Elena, une jeune Roumaine qui cache à Aymé qu’elle a une petite fille, Gaby. Aymé prétexte auprès de ses proches qu’elle est une lointaine parente de sa défunte épouse, venue en France pour un stage dans sa ferme. Face à un Pigrenet incapable d’un once de tendresse, Elena va vite ressentir la nostalgie de son pays. Les efforts d’Elena pour séduire Aymé semblent vains. Mais lorsqu’il se rend compte qu’il va perdre Elena, Aymé va, pour lui redonner le moral, retirer toutes ses économies de la banque et les remettre à la jeune femme en lui faisant croire qu’il a gagné aux courses. Mais, convaincu qu’Elena n’est pas à sa place à la ferme, il la laisse repartir en Roumanie. Elena utilise l’argent pour ouvrir une école de danse… Pour sa première réalisation en 2005, l’actrice, scénariste, dramaturge, chroniqueuse de radio (notamment les Grosses têtes sur RTL) Isabelle Mergault signe une bonne comédie dramatique qui sera d’ailleurs couronnée du César du meilleur premier film. Loin de ses prestations comiques au sein de la troupe du Splendid, Michel Blanc compose, avec le personnage d’Aymé Pigrenet, un homme torturé par la vie qui, en cherchant une « épouse de remplacement » pour les travaux de la ferme, va peu à peu se révéler sous son meilleur jour. Pour le rôle d’Elena, la cinéaste a trouvé la ravissante comédienne roumaine Medeea Marinescu et les deux acteurs se donnent joliment la réplique… Ce film, dont le titre correspond à la phrase standard en français apprise par toutes les candidates roumaines au mariage lors de l’entretien de l’agence matrimoniale, a enfin été un succès commercial sur les écrans français avec plus de 3,3 millions de spectateurs. (Gaumont)
 CASIER JUDICIAIRE
CASIER JUDICIAIRE
Au sortir de prison, Joe Dennis, gangster repenti, est engagé dans un grand magasin dont le directeur recrute une partie de son personnel chez les anciens détenus afin d’aider à leur réinsertion professionnelle et morale. Dans le même magasin, travaille Helen Roberts (Sylvia Sidney), elle aussi libérée sur parole, ce qui, selon la loi américaine, est un motif d’interdiction de mariage. Epris d’elle, Joe (George Raft) épouse Helen qui, de peur de le décevoir, lui cache son passé criminel. Lorsqu’il découvre la vérité sur sa femme qui a tout fait pour tenir leur union secrète, Joe, trahi et déçu, revient vers ses anciens complices et se lance par désespoir dans la préparation d’un mauvais coup. Mais Helen parvient à convaincre la bande de renoncer à son projet, en expliquant, craie en main au tableau noir, que « le crime ne paie pas ». Un enfant scellera in fine l’amour d’Helen et de Joe, en présence de tous leurs amis réunis à la maternité… Au terme d’une brillante carrière allemande marquée par des chefs d’oeuvre comme Metropolis (1927) ou M le maudit (1931), Fritz Lang tourne le dos à l’Allemagne nazie alors même que Goebbels voulait lui confier les clés de l’industrie du cinéma allemand. Lang répondit qu’il était juif. Et Goebbels rétorqua : « M. Lang, c’est nous qui décidons qui est juif… » Après un passage par Paris, Lang arrive à Hollywood où il va tourner une trilogie réaliste et sociale, trois films tous interprétés par Sylvia Sidney. Furie (1936) est un pamphlet sur le lynchage et la volonté de puissance. L’année suivante, J’ai le droit de vivre est une tragédie sur un couple pourchassé par la police inspirée par l’histoire de Bonnie et Clyde. Enfin Casier judiciaire (1938) est, cette fois, une fantaisie sur l’inutilité du vol. Si les deux premiers volets de la trilogie sont remarquables, You and me (titre original) apparaît comme une œuvre mineure mais efficace dans la filmographie de Lang sur une thématique qui semble plutôt appartenir à l’univers d’un Capra. Pour Lang, l’affaire ne fut pas de tout repos puisque le grand Kurt Weill, chargé d’écrire la musique (on en entend un peu de sa part qui donne au film une petite coloration de musical) trouva un autre travail et laissa Lang en plan. Dans You and me, Helen lance : « Les gros bonnets ne sont pas des petits truands comme vous. Ils font de la politique. » Savoureux ! (Rimini éditions)
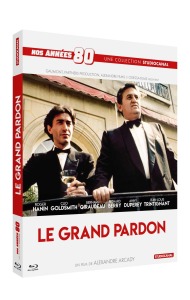 LE GRAND PARDON
LE GRAND PARDON
A Pascal Villars, l’ambitieux truand qui a décidé de prendre sa place, Raymond Bettoun lance : « Tu n’as pas peur au moins ? T’as aucune raison d’avoir peur. Tu sais pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui chez les Juifs, c’est le Kippour. Tu te rends compte de la chance que tu as ? C’est le Grand Pardon… Ce jour-là, le Grand Pardon, on peut rien faire ; ni travailler, ni recevoir de l’argent, ni… rien quoi. Sinon on est rayé du Livre. Aujourd’hui, dans le monde entier, tous les Juifs, ils pardonnent à ceux qui leur ont fait du mal. Tous les Juifs. Sauf un, moi. Moi, je pardonne pas ! » En 1982, Alexandre Arcady raconte l’aventure du clan Bettoun, une famille mafieuse qui évolue dans le milieu du crime organisé français et de son patriarche, Raymond, un Juif pied-noir du sud de la France, toujours soucieux de cultiver « l’esprit de famille méditerranéen ». On a parfois tenté une comparaison entre Le grand pardon et le Parrain de Coppola. C’est quand même aller très vite en besogne ! Car le film d’Arcady est surtout la saga (policière), volontiers truculente et passablement folklorique, d’une grande famille séfarade. Le tout sur fond de règlements de comptes sanglants. Dans son combat pour garder le pouvoir, notamment en évinçant son concurrent Carreras du casino de Biarritz ; Raymond Bettoun est ciblé par le commissaire Duché, un flic teigneux décidé à le mettre à genoux. Un flic qui ose : « Je ne vous aime pas Bettoun. Vous sentez l’huile. Et j’ai l’odorat délicat. » Le grand pardon (qui sort dans la collection Nos années 80) doit beaucoup à la stature et à la faconde pataouète de Roger Hanin qui fait de son Bettoun une figure aussi flamboyante qu’inquiétante. Pour faire bonne mesure, Hanin est entouré d’une sacrée galerie de comédiens : Richard Berry, Bernard Giraudeau, Jean-Pierre Bacri, Gérard Darmon, Jean-Louis Trintignant, Clio Goldsmith, Richard Bohringer, Anny Duperey, Robert Hossein, Sam Karmann, Jean Benguigui, Armand Mestral. Excusez du peu ! Le succès du Grand pardon donna naissance à une suite. Un n°2 où la famille Bettoun part à la conquête de l’Amérique. (Gaumont)
 A TOUTE ALLURE
A TOUTE ALLURE
Marianne est officier sous-marinier et commandant en second du sous-marin nucléaire d’attaque Le Fringant. Marco Mariani est steward dans les longs-courriers d’une compagnie aérienne. Au hasard d’une escale, ils se rencontrent et c’est le pur coup de foudre. Mais leur belle histoire va vite se heurter à la rigueur des règlements de la Royale. Qu’à cela ne tienne ! Quand il est amoureux, Marco est prêt à tout, y compris à monter clandestinement à bord du Fringant pour rapporter à son aimée le médaillon qu’elle avait égarée. Secrètement séduite par l’aplomb de son amoureux, Marianne est cependant consciente qu’il sera bien difficile de filer le parfait amour à bord. D’autant que le patron, le capitaine de frégate Benazech, n’hésite pas une seconde à mettre Marco aux fers. Et du côté des autorités, on commence à se demander si l’amoureux têtu n’est pas un espion ! On avait remarqué Lucas Bernard en 2019 avec Un beau voyou, une bonne et intrigante comédie policière avec Charles Berling et Swan Arlaud. Le réalisateur est de retour, ici, avec un second film en forme, cette fois, de comédie romantique. Pour porter cette aventure sentimentale qui se regarde avec plaisir, il peut s’appuyer sur un Pio Marmaï savoureux en steward qui a toujours le mot pour rire et capable d’aller jusqu’au bout du monde ou des océans. A ses côtés, en Marianne, Eye Haïdara, une habituée des comédies (on l’avait vu en 2017 en chef de rang dans Le sens de la fête de Nakache et Toledano) ou encore José Garcia en gradé de la Marine. A toute allure joue la carte de quelques références de thrillers sous-marins (Octobre rouge ou USS Alabama) et de comédies d’espionnage dans la lignée d’OSS 117. Sur la chanson Le coup de soleil (celle qui dit : J’ai attrapé un coup de soleil, un coup d’amour, un coup d’je t’aime – J’sais pas comment, il faut qu’j’me rappelle, si c’est un rêve, t’es super belle – J’dors plus la nuit, j’fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage…), le scénario tient bon la route et l’ensemble distille une agréable bonne humeur. (Gaumont)
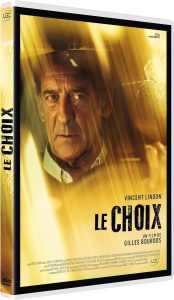 LE CHOIX
LE CHOIX
Chef de projet dans une importante entreprise de construction immobilière, Joseph Cross doit diriger une manoeuvre particulièrement importante, avec la coulée de plusieurs centaines de tonnes de béton pour les fondations d’une tour qui devrait s’élever particulièrement haut. Mais, en fin de journée, il répond à un appel téléphonique qui l’incite à prendre la route sans tarder. Tout en conduisant sa voiture, il passe de nombreux appels téléphoniques et répond également à beaucoup d’autres, parfois avec les mêmes interlocuteurs. Parmi ceux-ci, sa femme Catherine, Damien, son assistant sur le chantier, Garcia un autre collègue, ainsi qu’une autre voix féminine répondant au prénom de Béatrice et un gamin, en l’occurrence son fils Lucas qui regarde un match de foot à la télé et qui attend son père qui devait le regarder avec lui. Sauf qu’il y a un imprévu, car Joseph ne se dirige pas vers son domicile, mais vers une maternité… Autant de coups de fil pour faire face aux conséquences de ce qu’il vient d’apprendre. Les choix qu’il va faire vont remettre en question sa vie professionnelle comme personnelle. Connu pour son beau Renoir (2013) où Michel Bouquet était le grand peintre impressionniste et Christa Théret son modèle Dédé Heuschling, Gilles Bourdos signe, ici, le remake du film américain Locke réalisé en 2013 par Steven Knight avec Tom Hardy dans le même rôle principal du chef de projet dans l’immobilier. Tourné dans une voiture fonçant, de nuit, sur de grandes et larges routes de la région parisienne, Le choix se construit sur une succession de choix cruciaux avec le risque, pour Cross, de démolir tout ce qu’il a bâti. Comme il le fait souvent, Vincent Lindon incarne, ici, un type solide comme le béton qu’il manipule dans sa vie professionnelle. Mais sa vie parfaitement organisée va, en une nuit, se lézarder. Et Cross sait qu’il peut tout perdre : son travail, sa femme, ses enfants et même sa fierté. (UGC)
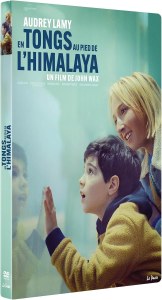 EN TONGS AU PIED DE L’HIMALAYA
EN TONGS AU PIED DE L’HIMALAYA
Pauline, la maman d’Andréa, six ans et demi, est au bout du rouleau. Son adorable petit garçon a été diagnostiqué TSA, autrement dit, il souffre d’un « trouble du spectre autistique ». Même s’il n’est pas vraiment au niveau, il est toujours scolarisé et s’apprête à faire sa rentrée en grande section de maternelle. Pour Pauline, sans revenus fixes et récemment séparée de Fabrice, le père d’Andréa, tout semble concourir à faire de sa vie une succession d’échecs. Or pour Andréa, c’est une année cruciale qui va déterminer s’il peut ou non rester scolarisé et obtenir ainsi une meilleure chance de voir son état s’améliorer. Mais pour cela, Andréa a besoin de stabilité. Pour Pauline, lui apporter cette dimension indispensable, c’est un peu (beaucoup) gravir l’Himalaya en tongs… Avec En tongs au pied de l’Himalaya, John Wax réalise son premier long-métrage en s’appuyant sur un « seule en scène » éponyme montée, juste avant le confinement, par son amie Marie-Odile Weiss qui y évoquait une histoire personnelle, celle de mère d’un enfant autiste. Celle-ci n’en donna qu’une représentation… C’est Marie-Odile Weiss qui co-signe, ici, le scénario de cette comédie dramatique qui explore, avec une touchante humanité, les défis quotidiens d’une famille face à la maladie. Sans tomber dans le pathos, le film alterne l’humour et la tendresse autour d’un thème évidemment assez lourd. John Wax a trouvé avec Audrey Lamy la comédienne idéale pour se glisser dans la peau d’une femme et d’une mère perdue face à l’ampleur du problème incarné par un gamin supposé « invivable ». « Mais, dit le cinéaste, ce n’est pas un film que sur l’autisme, c’est une histoire qui raconte comment on se reconstruit quand on est une femme de 40 ans, séparée avec un enfant. Ayant deux enfants de deux femmes dont je suis séparée, c’est un sujet qui me parle… » (Le Pacte)
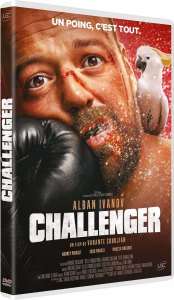 CHALLENGER
CHALLENGER
Surnommé le Kid d’Amiens, Luka Sanchez rêve d’être un grand boxeur… Malheureusement, pour l’instant, il n’est qu’amateur (il bosse dans la restauration), un peu trop enveloppé et doit se contenter de petits combats foireux. Mais un jour, le destin frappe à sa porte et propulse notre héros au sommet ! Challenger, c’est l’histoire d’un boxeur très modeste, pour ne pas dire un parfait loser, qui se raconte de belles histoires dans sa tête mais qui n’ira jamais très loin. Mais évidemment depuis qu’un certain Rocky Balboa est monté sur le ring… du cinéma, on sait que rien n’est impossible entre les cordes. Rocky s’était promis de tenir deux rounds et on sait ce que ça a donné. Alors Luka Sanchez se prend, lui aussi, à rêver. Lorsque, dans un combat truqué où il devait même pas toucher son adversaire, Sanchez l’allonge pour le compte, tout le monde veut savoir qui est ce cogneur. Même Camara, champion d’Europe en titre, veut l’affronter. Tout en le prévenant : « Je vais te tuer. En moins de deux rounds ! » Ce qui était bien inutile. On avait déjà prévenu Luka : « Chaque coup de poing de Camara, c’est comme si tu tombais du 20e étage ! » Autour d’un véritable genre du cinéma qu’est le film de boxe, Varante Soudjian a construit une agréable comédie. Le rythme est bon, les dialogues sont souvent enlevés et, dans le rôle de Sanchez, Alban Ivanov peut donner toute sa mesure, un peu gentil, un peu bas du front. Autour de lui, il y a du beau monde, à commencer par Audrey Pirault, dans le rôle de Stéphanie, la coach/manageuse de Luka. Les deux comédiens s’étaient déjà retrouvés, en 2022, dans La traversée, également de Varante Soudjian. Bref, un petit air de Rocky à la française. En version, c’est juste pour rire. (UGC)
LES BATAILLES D’AZNAVOUR ET LE COMBAT DE SOULEYMANE 
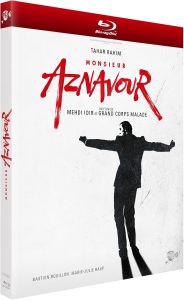 MONSIEUR AZNAVOUR
MONSIEUR AZNAVOUR
Ah, il en a pris pour son compte, le jeune Charles Aznavour ! Rastaquouère, nabot, Juif, infirme à la voix cassée et nasillarde. Un journaliste écrit : « Les Arméniens sont bons pour compter les sous. M. Aznavour devrait se lancer dans la comptabilité… » Face à ces critiques qui tiennent clairement de l’insulte, le chanteur fait le dos rond, convaincu qu’il aura un jour son nom en haut de l’affiche mais aussi que, seul, un travail acharné lui permettra de percer et de concrétiser son rêve. Ce sont les pages d’un livre d’histoire(s) que tournent Medhi Idir et Grand Corps Malade. Le livre de la vie de Charles Aznavour (1924-2018) dont les chapitres portent les titres de chansons de légende comme Je m’voyais déjà, La bohème ou Emmenez-moi. Autant dire que les fans du chanteur s’y retrouveront sans peine. Et que d’aucuns fredonneront probablement devant leur Blu-ray. Tout commence pendant la guerre lorsque la famille Aznavourian peine à joindre les deux bouts, sans perdre pour autant une joie de vivre profondément ancrée dans l’âme de Micha, le père, de Knar la mère ou d’Aïda, la grande sœur qui couve le petit Charles. Les premières séquences de Monsieur Aznavour mixent ces scènes de liesse familiale, de fête permanente où la joie doit damer le pion à la misère tandis que se déroulent les images d’archives du dramatique exil arménien, une origine qui hantera toujours le chanteur et fera de lui un militant actif de cette cause. En brossant de bons portraits de Pierre Roche, le partenaire des débuts ou d’Edith Piaf, la « grande soeur », le film s’attache à montrer combien, porté par sa passion et élevé par ses parents dans une atmosphère de musique et de théâtre, Charles Aznavour ne cessera de se battre avec une absolue ténacité. Dans le milieu de la chanson, peu d’artistes ont réussi à percer et à convaincre sans coup férir. Mais on a, ici, le sentiment que les obstacles ont été encore plus nombreux sur le chemin d’Aznavour. Et l’émotion étreint le spectateur quand, ce soir de décembre 1960, le chanteur, après avoir interprété Je m’voyais déjà et son fameux complet bleu « qui était du dernier cri » devant « ce Tout-Paris qui nous fait si peur », se tient derrière le rideau de l’Alhambra. Il est sûr que sa carrière est finie. On le pousse à aller saluer. Il revient dans la lumière. Le public l’applaudit à tout rompre. Aznavour est né. Pour incarner le chanteur, Medhi Idir et Grand Corps Malade ont trouvé en Tahar Rahim (né au cinéma dans Un prophète de Jacques Audiard en 2009) un interprète époustouflant qui a réussi à se fondre dans le personnage sans jamais imiter le grand Charles mais en jouant la ressemblance sans tomber dans le masque. Fils d’immigrés et d’apatrides, Aznavour est devenu l’un des symboles de la culture française, un « ambassadeur de la chanson française à travers le monde ». Un monument, en somme ! Que le film parvient, avec aisance, à nous rendre proche et humain. (Pathé)
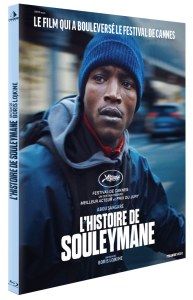 L’HISTOIRE DE SOULEYMANE
L’HISTOIRE DE SOULEYMANE
Tandis qu’il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Souleymane répète inlassablement son histoire. Dans deux jours, il a rendez-vous dans les locaux de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour passer son entretien de demande d’asile, le sésame pour obtenir des papiers. Mais Souleymane n’est pas prêt. Révélation de la dernière sélection Un Certain Regard à Cannes où il a obtenu le prix du jury et le prix d’interprétation masculine pour Abou Sangare, L’histoire de Souleymane est le troisième long-métrage de Boris Lojkine après Hope (2014) qui racontait l’histoire de Léonard et de Hope, un Camerounais et une Nigériane qui se rencontrent sur leur chemin vers l’Europe puis Camille (2019) centré sur la vie de la photo-reporter Camille Lepage, durant la guerre civile de République centrafricaine de 2013-2014 où elle perdra la vie. « Depuis quelques années, dit le cinéaste, j’avais envie de réaliser un film sur ces livreurs à vélo qui sillonnent la ville avec leurs sacs bleu turquoise ou jaune vif, siglés de l’application pour laquelle ils travaillent, tellement visibles et pourtant totalement clandestins – la plupart sont sans- papiers. » Autour de la figure omniprésente de Souleymane, dont l’existence est fortement compressée par trois exigences : «gagner de quoi manger, s’assurer un toit pour dormir, préparer son entretien de demande d’asile», le film montre Paris comme une ville étrangère dont on ne connaîtrait pas les codes, où chaque policier est une menace, où les habitants sont hostiles, pleins de morgue, difficiles d’accès… Des HLM de grande banlieue aux immeubles haussmanniens du centre, des MacDo aux immeubles de bureau, des centres d’hébergement d’urgence aux wagons de RER, Lojkine montre Paris sous un angle radicalement différent. « L’autre dans le film, dit-il, c’est nous : le travailleur pressé qui commande son burger, le passant bousculé qui peste contre les livreurs à vélo, la fonctionnaire qui se tient face à Souleymane… » En s’appuyant sur un époustouflant comédien non-professionnel (dans les suppléments, on peut voir les nombreux essais réalisés par Abou Sangare qui, dans la vie, est mécanicien), L’histoire de Souleymane apparaît comme un film haletant. Parce qu’il suit au plus près un livreur constamment en mouvement, le tout dans une mise en scène qui supprime tout ce qui ne relève justement pas de ce mouvement permanent qu’est la vie de Souleymane. Stressant aussi parce que l’existence de ce livreur aux prises avec un système sans pitié est suspendue à la décision de l’OFPRA et d’une fonctionnaire anonyme (Nina Meurisse, déjà présente dans Camille). Souleymane a acheté un récit factice selon lequel il serait un opposant politique membre de l’ Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Après les trépidantes 48 heures dans la vie de Souleymane, presque toujours filmées à l’arrache dans les rues de Paris, l’entretien à l’OFPRA, dans un cadre soudain rigide, est presque un film dans le film. « Je voulais, souligne encore le réalisateur, que cet entretien soit comme un duel, où jusqu’au bout Souleymane se batte bec et ongles, et que le spectateur épouse sa cause, jusqu’au moment où tout se renverse ». Lorsqu’à la fin Souleymane raconte enfin pourquoi et comment il a quitté la Guinée, il a peut-être tout perdu, mais au moins, pour la première fois, il a parlé en vérité. Il est redevenu lui-même. Une œuvre bouleversante et magnifique ! (Pyramide)
 TROIS AMIES
TROIS AMIES
En voix of, Victor plante le décor. Voici des rues et des places, des façades et des parcs de Lyon, voici enfin le couloir d’un lycée, celui où Joan, la femme de Victor, enseigne l’anglais. A Alice, sa meilleure amie, prof comme elle, Joan confie, en s’effondrant, qu’elle n’est plus amoureuse de Victor. Pire, elle souffre de se sentir malhonnête avec lui qui l’adule tant. Mais Alice la rassure : elle-même n’éprouve aucune passion pour Eric et pourtant leur couple se porte à merveille… Ce qu’Alice ignore, c’est qu’Eric entretient une liaison secrète avec Rebecca, leur amie commune… Lorsque, finalement, Joan décide de quitter Victor, l’existence des trois amies est largement bouleversée. D’autant que Victor disparaît dans un accident de la circulation… Avec Trois amies, son douzième long-métrage, Emmanuel Mouret poursuit dans cette veine qui lui est chère, celle qui traite de l’art d’aimer et de toutes ses nombreuses variations. Mais là où l’on pouvait s’attendre au ton enjoué et allègre qui caractérise ses films précédents, le réalisateur marseillais adopte une gravité mâtinée de mélancolie pour évoquer, une nouvelle fois, l’amour et le hasard. Avec ses accents de mélodrame, voici une comédie dramatique dans le sens où le comique et le tragique y sont enlacés tout du long. Joan est sentimentale et raisonnable mais en souffrance, Alice joue la carte de la sécurité mais se laisse aller à rêver lors de longs appels téléphoniques avec Stéphane, un peintre de renom. Quant à Rebecca, sa générosité en amour lui joue des tours « inamicaux ». Ces personnages n’ont rien de héros. Ils sont affectés, peuvent être égoïstes, capricieux, réagissent parfois avec maladresse, mais sont aussi capables de considération, de scrupules. Et tous se posent la même question : comment font les autres ? Ils sont parfois beaux, parfois un peu ridicules mais ne se retournent jamais contre les autres. Avec pudeur et délicatesse, un poil d’irrationnel et toujours une étonnante musicalité, Mouret construit une narration complexe qui donne un peu l’impression d’une histoire sans fin dont on a toujours envie de connaître la suite. D’autant que les comédiennes, India Hair (Joan), Camille Cottin (Alice) et Sara Forestier (Rebecca) sont en verve ! Les hommes (Damien Bonnard, Grégoire Ludig, Vincent Macaigne et Eric Caravaca) tentent de suivre le rythme dans les arcanes féminines de l’art d’aimer. (Pyramide)
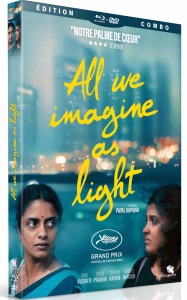 ALL WE IMAGINE AS LIGHT
ALL WE IMAGINE AS LIGHT
Sans nouvelles depuis des années de son mari parti travailler en Allemagne, Prabha, infirmière à Mumbai, ancrée dans les traditions, s’interdit toute vie sentimentale même si Manoj, un timide médecin échographiste tente de la courtiser en lui écrivant des poèmes. Un jour, cette femme grave et tourmentée reçoit de la part de son mari un autocuiseur à riz. De son côté, Anu, sa colocataire, plus jeune, plus moderne, plus enjouée, fréquente en cachette Shiaz, un jeune homme musulman qu’elle n’a pas le droit d’aimer mais qu’elle retrouve dans des endroits isolés de la ville. Lors d’un séjour dans un village côtier, ces deux femmes empêchées dans leurs désirs entrevoient enfin la promesse d’une liberté nouvelle. Chronique des travailleurs nocturnes à Mumbai (l’ancienne Bombay), le film s’attache plus particulièrement aux portraits intimes de trois femmes : Prabha et Anu, les deux infirmières colocataires mais aussi Parvaty, une cuisinière qui travaille également dans le même hôpital. Veuve, Parvaty est en attente d’expulsion de son logement, qui doit être démoli, mais elle ne parvient pas à prouver son droit à être relogée ou obtenir une compensation, car son défunt mari ne lui a laissé aucun document. Prabha va l’aider dans ses démarches… Après avoir mis en scène, en 2021, Toute une nuit sans savoir (2021), mélange assez politique d’histoire d’amour et de révolte étudiante, la cinéaste indienne Payal Kapadia signe ici All We Imagine as Light présenté en compétition officielle à Cannes 2024 où il a remporté le Grand prix. Cette chronique de trois femmes d’âges et de conditions différentes semble, de prime abord, moins politique mais la cinéaste précise : « Je pense que tout est fondamentalement politique. L’amour, en Inde, c’est une affaire extrêmement politique. Je ne dirais donc pas que ce film-ci n’est pas politique. Savoir qui on peut épouser est une chose très complexe en Inde. La caste et la religion, entre autres choses, ont une influence profonde sur le choix de la personne avec qui vous allez passer votre vie, ainsi que sur les conséquences de ce choix. L’amour impossible, qui compte parmi les thèmes principaux d’All We Imagine as Light, est une question très politique. » Le film s’appuie sur les décors de l’impressionnante et cosmopolite mégalopole indienne (le tournage a eu lieu dans un véritable hôpital… promis à la destruction), ses lumières, ses trains, ses bus, son métro, ses boutiques, ses sous-sols même et surtout tous ceux qui viennent de tout le pays pour y travailler. La cinéaste s’intéresse aussi au boom immobilier et à la vitesse à laquelle la ville se transforme dans une sorte d’étrange gentrification. Ce film immergé dans la ville s’ouvre, vers la fin, lorsque et Anu et Prabha vont au bord de la mer. Le propos ressemble alors à un conte de fées ou un long rêve qui permet à Prabha d’exprimer les choses qu’elle veut dire à son mari ou lui entendre dire. Enfin, les trois comédiennes Kani Kusruti (Prabha), Divya Prabha (Anu) et Chhaya Kadam (Parvaty) offrent une interprétation remarquable. (Condor)
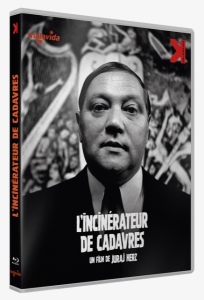 L’INCINERATEUR DE CADAVRES
L’INCINERATEUR DE CADAVRES
Dans la Tchécoslovaquie de 1938, M. Kopfrkingl travaille dans un crématorium. Plus qu’un métier, il voit dans l’incinération des cadavres la beauté, la transcendance, un salut pour l’humanité. Ce type peu avare de sa personne croise un jour un ancien compagnon d’armes, sympathisant nazi, qui lui suggère que du sang allemand coule dans ses veines. Alors que les Allemands envahissent le pays, Kopfrkingl, trouvant l’opportunité de montrer son savoir-faire et de perfectionner ses compétences, va se prendre à rêver d’une race pure, à commencer dans sa propre famille. Son crématoire va pouvoir tourner à plein régime. Peut-être parce qu’il a oeuvré dans le domaine des marionnettes, au côté du maître Jan Svabkmajer, le réalisateur slovaque Juraj Herz (1934-2018) a été boudé par les cinéastes de la Nouvelle vague tchèque. Il a cependant donné une suite de films marquants. En 1968, en adaptant un récit de Ladislav Fuks, Herz réalise, avec L’incinérateur de cadavres, son premier film pour lequel il a les mains entièrement libres. Cependant des scènes seront coupées et lorsque l’auteur et scénariste tombera en disgrâce, le film est censuré. Juraj Herz signe, ici, un grand film formaliste qui scrute le labyrinthe mental de son protagoniste principal en le filmant le plus souvent en gros plan, voire avec un objectif fish-eye. De ce fait, Kopfrkingl semble remplacer la réalité par ses propres désirs et fantasmes. Avec sa tête ronde qui lui donne l’air d’un bébé dans un corps d’adulte, le comédien Rudolf Hrusinsky incarne un esprit pervers et faible qui va se comporter comme un parfait rouage de la sinistre Solution finale. Le cinéaste a d’ailleurs eu à connaître de la machine nazie. En 1943, sa famille est déportée au camp de Ravensbrück, tandis que Juraj, âgé de 9 ans, est placé dans la partie russe du camp de Sachsenhausen. Avec sa fascinante mise en scène (le travail du directeur de la photo Stanislav Milota est somptueux) et aussi un montage brillant, L’incinérateur de cadavres prend la forme d’un puissante manifeste contre toutes les formes de totalitarisme. Présenté dans une belle édition (Blu-ray et DVD), le film est accompagné de multiples suppléments. Ainsi on découvre Brutalités récupérées (1965),le premier court métrage (32 mn) de Juraj Herz mais aussi This way to the cooking chambers, un documentaire de Daniel Bird (2017 – 22 mn). On trouve aussi des interviews de Juraj Herz, Stanislav Milota et Vlata Chramostova (2008 – 16mn), – Histoire, politique et nouvelle vague tchécoslovaque par Christian Paigneau réalisateur de Un conte de fées tchécoslovaques (2024 – 38mn) et Juraj Herz et l’incinérateur de cadavres, par Christian Paigneau et Garance Fromont chercheuse et enseignante en cinéma et spécialiste de la nouvelle vague tchécoslovaque. (2024 – 55 mn), enfin une analyse esthétique (10 mn) par Garance Fromont.(Potemkine – Malavida)
 ICHI THE KILLER
ICHI THE KILLER
Le chef d’un gang de yakuzas vient de disparaître sans laisser de trace, emportant avec lui une grosse somme d’argent. Persuadé que son patron s’est fait enlever par une bande rivale, son bras droit, Kakihara, va laisser libre court à ses instincts de psychopathe pour débusquer le coupable. Durant sa traque, le nom d’« Ichi » est sur toutes les lèvres. Mais qui se cache derrière ce tueur solitaire aux méthodes aussi abjectes que celles de Kakihara ? Dans un style outrancier où l’ultra-violence et l’insoutenable deviennent peu à peu jubilatoires, Takashi Miike (auteur de la trilogie Dead or Alive) réalise, en 2001, avec Ichi the Killer l’un de ses films les plus fous, les plus aboutis et les plus controversés. Adapté du manga culte éponyme de Hideo Yamamoto et porté par de nombreux acteurs de la scène contemporaine nippone, Ichi the Killer se fait fort de repousser les limites de la bienséance et du bon goût, valant à son prolifique réalisateur d’être affublé des étiquettes « violent, déjanté et provocateur ». Film de tous les excès, Ichi occupe une place à part dans l’oeuvre de Miike. La violence extrême fut initialement employée pour promouvoir le film : pendant la première internationale au Toronto International Film Festival en 2001, le public reçut, comme objets promotionnels, des sacs pour vomir incrustés du logo du film. Il est vrai qu’une scène de tuerie particulièrement extravagante présente un personnage qui tranche un homme en deux de la tête aux pieds, ainsi que le visage d’un autre homme, qui glisse le long d’un mur proche… Si le scénario ne brille pas par sa finesse, il faut reconnaître à Miike un sens certain du rythme, une invention graphique évidente, un goût pour le gore cartoonesque, une représentation très sombre de Tokyo et une absence de sobriété dans la mise en scène qui a dû faire se retourner Ozu dans sa tombe. Dans une nouvelle restauration, Ichi the Killer sort pour la première fois en 4K Ultra HD et Blu-ray. Une sortie accompagnée de nombreux suppléments dont trente minutes de making-of sur les coulisses des scènes culte ainsi que quatre entretiens avec le réalisateur Takashi Miike (33 mn), et les comédiens Alien Sun (15 mn), Tadanobu Asano (10 mn) et Shinya Tsukamoto (15 mn). Enfin Miike et la génération Manga (10 mn) est un extrait d’un documentaire réalisé par Yves Montmayeur en 2003, avec les témoignages de Takashi Miike, Shinya Tsukamoto et du réalisateur Alejandro Jodorowsky… (Carlotta)
 A SON IMAGE
A SON IMAGE
Une jeune femme shoote des photos de mariage sous le soleil au bord de la Méditerranée… Sur le chemin du retour, elle s’endort au volant de sa voiture. C’est l’accident mortel. Autour du corps de la jeune femme, ses proches, effondrés, se retrouvent… Avec A son image, sélectionné à la Quinzaine des cinéastes à Cannes 2024, Thierry de Peretti signe son quatrième long-métrage de fiction et propose une œuvre qui réunit les fragments de la brève mais riche existence d’Antonia, jeune photographe de Corse Matin à Ajaccio. Comédien et metteur en scène de théâtre, acteur au cinéma et donc cinéaste, Thierry de Peretti est natif d’Ajaccio et il fait, ici, son retour dans l’île de Beauté après s’être penché sur les arcanes de la police française dans Enquête sur un scandale d’État (2022). Déjà, en 2017, avec Une vie violente, il évoquait l’histoire du Bastiais Stéphane qui retourne en Corse pour assister à l’enterrement de son ami d’enfance Christophe, compagnon autonomiste assassiné la veille. Stéphane se rappelle alors l’enchaînement des événements qui ont fait de lui un nationaliste radical, puis un clandestin. En adaptant le roman éponyme de Jérôme Ferrari, paru chez Actes Sud en 2018, le cinéaste va détailler, de la fin des années 70 aux années 90, le parcours d’Antonia, son engagement, ses amis, ses amours qui se mêlent intimement aux grands événements de l’histoire politique de l’île jusqu’à l’aube du 21esiècle. La vie d’Antonia est très vite placée sous le signe de son amour fulgurant pour Pascal (Louis Starace), militant nationaliste dont l’engagement lui vaudra différents séjours en prison et feront d’Antonia ou la réduiront à être « la femme de Pascal ». Car, dans cette fresque d’une génération, Antonia, tout en étant reporter-photographe et donc témoin, est aussi impliquée dans la confrontation entre le combat des indépendantistes et le pouvoir central parisien. Elle vit au plus proche les incarcérations de son amant, les risques pour sa vie mais aussi les événements (ah, les fameuses conférences de presse des membres cagoulés du FNLC!) qu’elle couvre pour son journal. Mais Thierry de Peretti (qui incarne le prêtre et parrain d’Antonia) ne fait pas qu’un film politique. Il décrit des destinées intimes et s’interroge aussi sur la question de l’image et de son contenu. Photographe de presse, est-ce un métier honorable, se demande Antonia lorsqu’elle bataille, dans le bureau de son patron à Corse Matin, pour aller à Lyon couvrir un procès concernant les luttes nationalistes. Son chef lui répond proximité, fait-divers locaux, nécrologies et fêtes de village… Alors, pour se confronter à l’Histoire, à la guerre et à l’image, Antonia partira suivre, du côté de Vukovar, le début du conflit yougoslave. Porté par la figure d’Antonia (excellente Clara-Maria Laredo), A son image est une œuvre âpre et attachante qui questionne, avec finesse, l’innocence et l’absence de pitié. (Pyramide)
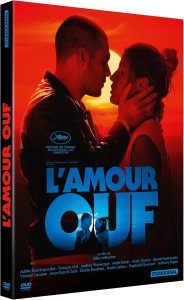 L’AMOUR OUF
L’AMOUR OUF
Quelque part du côté des cités du nord de la France, dans les années 1980, Clotaire, petit loubard, perdu dans les difficultés du monde ouvrier, traîne avec sa bande de copains. Un jour, sortant d’un bus scolaire, il aperçoit Jacqueline, récemment orpheline de sa mère et très proche de son père, une bonne élève sérieuse. Clotaire s’emballe et Jacqueline n’est pas insensible à son côté rebelle à belle petite gueule. Lorsque Clotaire lance : « Je t’appellerai Jackie ! », la jeune fille répond : « Moi, je ne t’appellerai pas… » Pourtant, ces deux-là vont tomber follement amoureux et vivre une passion dévorante, malgré des différences de condition sociales et d’aspirations personnelles. Dans les années 1990, après avoir passé dix années en prison pour un crime qu’il n’a pas commis, Clotaire est toujours hanté par Jackie et tente désespérément de la revoir. Mais Jackie est désormais mariée, installée dans une nouvelle vie rangée, et semble avoir définitivement tourné le dos à leur passé. Mais en réalité, aucun des deux n’a oublié cet amour qui les a consumés adolescents et qui pourrait bien ressurgir et bouleverser à nouveau leurs vies. Second long-métrage (en solo) de Gilles Lellouche après Le grand bain (2018), comédie dramatique sur sept hommes cabossés par la vie et qui reprennent espoir en s’investissant dans la natation synchronisée, L’amour ouf est une belle réussite vue par 4,2 millions de spectateurs en France. C’est aussi un film « générationnel » qui accroche un public de jeunes filles et femmes. Sans doute emballées par les punchlines du Clotaire de 17 ans et (surtout?) par le charme canaille de Malik Frikah, jeune comédien qui décroche, ici, son premier grand rôle de cinéma. Comme Mallory Wanecque est une Jackie très à son aise aussi, ces deux jeunes acteurs dament quasiment le pion aux deux stars du film, en l’occurrence François Civil et Adèle Exarchopoulos à l’âge adulte. Le duo est entouré de visages connus du cinéma français : Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Elodie Bouchez, Karim Leklou, Raphaël Quenard et Anthony Bajon. Un beau casting ! Présenté en compétition officielle au dernier festival de Cannes (où l’accueil n’a pas été très chaleureux), L’amour ouf, adaptation du roman éponyme de l’auteur irlandais Neville Thompson, publié en 2000, est un projet que Lellouche porte depuis longtemps et qu’il décrit comme « une comédie romantique ultra-violente ». En citant des références qui vont de West Side Story (le film contient de bonnes séquences chorégraphiées) aux œuvres de Scorsese et Tarantino, Lellouche a imaginé, dit-il, « un doux mélange entre violence et sentiments exacerbés, entre chaud et froid, entre sucré et âpre ». Au total, le film apparaît comme un patchwork, pas forcément indigeste, de polar musclé et de drame romantique. (Studiocanal)
 SEPTEMBRE SANS ATTENDRE
SEPTEMBRE SANS ATTENDRE
Après quinze années de vie commune, Ale et Alex ont une idée un peu folle : organiser une fête pour célébrer leur séparation. Si cette annonce laisse leurs proches perplexes, le couple semble certain de sa décision. Mais l’est-il vraiment ? Huitième film de fiction du réalisateur espagnol Jonas Trueba, Septembre sans attendre (Volveréis en v.o.) met en scène un couple interprété par Itsaso Arana (Ale) et Vito Sanz (Alex) également co-scénaristes du film et déjà ensemble à l’écran pour Eva en août (2020) et Venez voir (2022) du même réalisateur. Cette comédie dramatique repose sur une idée répétée de manière littérale tout au long du film. Quasiment jusqu’à épuisement ! Pourtant, le motif de la séparation n’est jamais clairement exprimé. « Pour moi, dit Trueba, c’est important qu’il n’y ait pas de raison concrète, que cela soit presque un mystère, pour éviter que le film devienne trop réaliste. Habituellement, les films sur des couples et des ruptures contiennent un drame évident : les enfants, une infidélité… Pas ici. Je voulais vider le film de tout élément commun, reconnaissable ; qu’il reste éthéré. Ce qui le fait résonner avec les comédies romantiques classiques. » Le cinéaste cite ainsi Cette sacrée vérité (1937) de Leo McCarey. Dès la première séquence, le couple interprété par Cary Grant et Irene Dune annonce : « Nous allons nous séparer ». Chacun soupçonne l’autre de l’avoir trompé mais, en réalité, cela n’a pas d’importance. L’enjeu c’est la nécessité de se défier l’un l’autre avec cette idée de séparation, car ils savent sûrement que c’est la seule manière de se pardonner et d’éprouver à nouveau leur amour. Le rythme de Septembre sans attendre repose sur l’annonce répétée de cette drôle d’idée, célébrer les séparations plutôt que les unions. Le couple répète sans cesse la même annonce, presque toujours avec les mêmes mots. La variation se trouve dans les réactions de ceux qui les écoutent. Et chez Ale et Alex aussi, de manière subtile, à mesure qu’ils perdent leur certitude sur ce qu’ils disent. Enfin Septembre… opère une mise en abyme. On découvre que ce film est aussi le film qu’Ale est en train de terminer. Du coup, le travail de montage s’inscrit dans un jeu avec le spectateur. Le film est ainsi truffé de petits jeux de montage qui sont comme des expérimentations : le split-screen, la transition au volet, les changements d’axes… Ces marques apparaissent à partir du moment où l’on comprend que le personnage d’Ale est en train de monter le même film que celui que le spectateur voit. Une manière de dire comme nos vies et les films s’entremêlent. Une belle chronique désenchantée mais drôle. (Arizona Distribution)
 MEGALOPOLIS
MEGALOPOLIS
À New Rome, allégorie de New York, une jeune femme, Julia Cicero, est partagée entre la loyauté envers son père Franklyn Cicero, le maire de la ville, et son amant, l’architecte Cesar, artiste de génie ayant le pouvoir d’arrêter le temps. Si le premier a une vision archi-conservatrice de la société, Cesar est plus progressiste et tourné vers l’avenir. Après une catastrophe qui a ravagé la ville, l’architecte veut recréer la cité et en faire une utopie, alors que le maire, cupide et corrompu, y est totalement opposé… Megalopolis est un projet de longue date du réalisateur (l’écriture du film a débuté dans les années 80), qu’il rêvait de concrétiser depuis plusieurs décennies. Après plusieurs échecs pour y aboutir, Coppola décide de risquer l’endettement en investissant une grande partie de sa fortune personnelle dans le budget, estimé entre 100 et 120 millions de dollars. Afin de donner vie à son probable ultime film, il s’entoure également d’une distribution de luxe, constituée de jeunes acteurs du moment, tels qu’Adam Driver (qui incarne Cesar Catalina, l’architecte) ou Shia LaBeouf, des vétérans du cinéma américain, que ce soit Jon Voight, Dustin Hoffman ou Laurence Fishburne et des proches de son entourage comme sa sœur Talia Shire et son neveu Jason Schwartzman. Prononcer le nom de Francis Ford Coppola, c’est faire résonner, dans nos mémoires, le souvenir de la trilogie des Parrain (1972-1990), de Conversation secrète (1974), de Rusty James (1983), de Cotton Club (1984), du mélancolique Peggy Sue s’est mariée (1986) et évidemment de ce monument du film de guerre qu’est Apocalypse Now (1979). Excusez du peu ! A Cannes, l’an dernier, où il était en compétition officielle (50 ans après sa palme pour le formidable Conversation secrète et 45 ans après celle d’Apocalypse!), le vétéran américain (85 ans) s’est fait méchamment étrillé par la critique. On en passe des vertes et des pas mûres sur ce drôle d’objet cinématographique qui confronte les créateurs et les bureaucrates. Sans aucune allusion à une situation politique contemporaine ? Faut-il se risquer à voir Megalopolis ? Oui, si on ne craint pas un délire kitsch et futuriste pour s’offrir quelques instants flamboyants… (Le Pacte)
 TRANSFORMERS : LE COMMENCEMENT
TRANSFORMERS : LE COMMENCEMENT
Dans la cité d’Iacon, Orion Pax et D-16, deux mineurs d’Energon, vont découvrir une piste quant à la disparition de la Matrice du Commandement. Leur quête de l’artéfact va les mener à la surface de leur planète, Cybertron, accompagnés de B-127 et d’Elita-1. Ce qu’ils ignorent, c’est que cette aventure les mènera à devenir respectivement Optimus Prime et Mégatron, deux frères d’armes qui passés ennemis jurés, vont mener au plus grand des combats entre les Autobots (faction de Transformers qui représentent le Bien) et les Decepticons qui tentent d’imposer la force, la puissance et la domination des Transformers dans l’univers par tous les moyens en combattant les Autobots. Réalisé par Josh Cooley, ce film d’animation 3D est une préquelle à la franchise Transformers créée par les entreprises japonaise Takara Tomy et américaine Hasbro, toutes deux productrices de jouets. La franchise commença avec une ligne de jouets constituée de robots pouvant être transformés en véhicules. Ces robots constituent deux groupes, les Autobots et les Decepticons, qui se combattent. Par la suite la franchise a été la source de comics, de dessins animés, de jeux vidéo et de films. Mêlant action et science fiction, ces derniers se comptent, à ce jour, au nombre de huit, le premier datant de 2007, réalisé par Michael Bay et produit par Steven Spielberg. Avec une réflexion pas malvenue sur le pouvoir, voici un blockbuster familial qui ne révolutionne pas le genre mais qui fait bien le job. (Paramount)
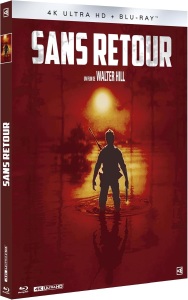 SANS RETOUR
SANS RETOUR
En 1973, neuf membres de la Garde nationale de Louisiane participent à un banal exercice militaire dans un bayou au coeur d’une forêt épaisse et touffue en territoire cajun. Pressés de finir au plus vite cet exercice, dont le sens leur échappe, ils volent des barques aux autochtones afin d’accéder plus rapidement au point de ralliement. Intrigués par cette incursion et par la prise de leur matériel, les habitants des marais se manifestent, alors que les militaires ont déjà commencé à quitter le rivage à bord des embarcations. Crawford Poole, le plus haut gradé, décide de retourner sur la rive, pour y restituer les barques. Mais, l’un de ses hommess tire alors une rafale de balles à blanc, par simple provocation. Cet acte est malheureusement pris très au sérieux par les Cadiens qui ripostent aussitôt avec de vraies balles. Poole est tué sur le coup. Pour les neuf autres membres de la garde nationale, c’est le début d’une lutte acharnée pour survivre dans des marécages qu’ils ne connaissent pas et avec peu de moyens de se défendre. Réalisateur de seconde équipe pour Norman Jewison et Peter Yates, respectivement sur L’affaire Thomas Crown (1968) et Bullitt (1968), scénariste pour Guet-apens (1972) de Sam Peckinpah et Le piège (1973) de John Huston, le vétéran Walter Hill a ensuite connu une solide carrière de réalisateur avec des films comme Les guerriers de la nuit (1979) ou 48 heures (1982). Plutôt mal accueilli aux USA mais avec de bonnes critiques dans le reste du monde, Southern Comfort (titre original), réalisé en 1981, est pourtant un bon huis-clos dans les décors hostiles et oppressants (le tournage a été difficile) d’un bayou. Pour les gardes nationaux (incarnés par des comédiens encore peu connus à l’époque mais excellents comme Keith Carradine, Powers Boothe ou Fred Ward), tout devient vite une angoissante question de survie. Sur une musique de Ry Cooder, du bon cinéma d’action brutal et efficace. (L’Atelier d’images)
 ANGELO DANS LA FORET MYSTERIEUSE
ANGELO DANS LA FORET MYSTERIEUSE
Angelo, 10 ans, se rêve aventurier et explorateur. Jusqu’au jour où, partant en voiture avec sa famille pour se rendre au chevet de sa chère grand-mère bien malade, il est brusquement mis au défi de prouver son courage… Oublié par erreur sur une aire d’autoroute, Angelo décide de couper à travers la forêt pour rejoindre la maison de Mémé. Il s’enfonce alors dans un territoire mystérieux peuplé d’êtres étranges que menace un ennemi pire encore que l’ogre de la région… Au départ du film d’animation réalisé en France par Vincent Paronnaud (déjà co-auteur avec Marjane Satrapi de Persepolis en 2007 et Poulet aux prunes en 2011) et Alexis Ducord, il y a la bande dessinée Dans la forêt sombre et mystérieuse du même Vincent Paronnaud parue en 2016. Dans une belle adaptation, l’intrigue se concentre sur un gamin à l’imagination débordante, qui va être amené à pénétrer dans une forêt peuplée d’êtres aussi excentriques que mystérieux. Très vite, pour le gamin aux grandes lunettes carrées, l’aventure va devenir une exploration inédite et inoubliable. Avec un petit côté Alice au pays des merveilles, le film réussit à capter l’attention des petits (comme des grands) à travers une histoire bourrée de rebondissements autant que de personnages étranges, attachants et drôles. Retenons ainsi Fabrice, l’écureuil qui rêve de devenir un oiseau et qui s’exprime avec la voix si reconnaissable de Philipe Katerine. Quant à Angelo, il n’est pas avare en commentaires et en vannes dignes de son jeune âge. Enfin, du point de vue visuel, Angelo est une réussite par sa maîtrise de différentes formes d’animation. Comme quoi, l’animation française existe et elle a de vraies qualités! (Le Pacte)
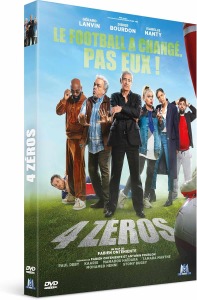 QUATRE ZEROS
QUATRE ZEROS
Si l’on fait exception de Coup de tête (1979) de Jean-Jacques Annaud ou Looking for Eric (2009) de Ken Loach, les films de fiction, notablement bons, sur le football ne sont pas légion. Alors que Mercato sort sur les grands écrans, voici les aventures de Sylvie Colonna, José Pinto (Didier Bourdon) et leur fils Manu lancés dans le foot-business. Là où Mercato est un thriller, Quatre zéros est une comédie qui n’a pas la prétention, du moins on l’imagine, de s’aligner dans la Ligue des champions. En 2002, Fabien Onteniente, qui n’était pas encore l’heureux auteur de Camping (oui, le film avec Jacky Pic et Patrick Chirac) donnait Trois zéros, une histoire de jeune Hongrois, prodige du ballon rond… Gérard Lanvin y tenait déjà le rôle d’Alain Colonna, agent de joueur. On retrouve le même Alain Colonna, désormais paisible retraité du côté de Tahiti. Or voilà que Sylvie (Isabelle Nanty), la sœur d’Alain, lui demande un coup de main. Car Manu, qui se rêve agent de joueur, a découvert, lors d’un défi de la lucarne, le jeune mais talentueux Kidane (Mamadou Haïdara). Le problème, c’est que Manu n’est pas vraiment une lumière. L’autre problème, c’est que les affaires vont mal. La survie du Churrasco, le restaurant portugais du couple, ne tient qu’à un fil. Alors les Pinto voient en Kidane l’occasion de sortir de la galère. Alain revient donc mais le football a changé… Tous ensemble, ils vont devoir affronter DZ, l’agent le plus influent du métier, un homme au bras long et à la mauvaise réputation… Avec comme objectif de permettre à Kidane d’intégrer le club de ses rêves : le PSG. Alors que l’on voit passer là des guests comme Paul Pogba, Rai, Guy Roux ou Rolland Courbis, il faut se rendre à l’évidence, cette satire des dérives du foot-business est une entreprise modeste. Pas méchante, pas passionnante non plus. (M6)
FEMMES D’IRAN, MAMIES DU MORVAN ET BUSINESSMAN NEW-YORKAIS 
 LES GRAINES DU FIGUIER SAUVAGE
LES GRAINES DU FIGUIER SAUVAGE
Une poignée de balles tombe, en gros plan, sur une table… Iman, robuste quinquagénaire barbu, ne sait pas encore que ces projectiles vont l’entraîner dans une terrible spirale. Après avoir longtemps oeuvré comme un fonctionnaire discret et zélé, Iman vient d’être promu juge d’instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran. Une nomination qui va lui assurer un sérieux bien-être matériel. Mais il devra être exemplaire dans un tribunal où l’atmosphère n’est pas des plus sereines. A cause de ses responsabilités, on lui a confié une grosse arme de poing qu’il range soigneusement tous les soirs dans un tiroir de sa chambre… Alors qu’Iman vient juste de prendre son poste, un immense mouvement de protestations populaires commence à secouer le pays. Nous sommes en septembre 2022, la jeune Mahsa Amini, 22 ans, vient de mourir dans un commissariat et le mouvement « Femme, Vie, Liberté » prend de l’ampleur. Dans la famille d’Iman, Rezvan et Sana, les deux filles, constamment sur leurs téléphones portables, soutiennent le mouvement avec virulence. Najmeh, leur mère, tente de ménager les deux camps. Iman, qui part à l’aube et revient tard le soir, est de plus en plus déconnecté des siens. Pire, dépassé par l’ampleur des évènements, Iman bascule dans la paranoïa lorsque son arme de service disparait mystérieusement… Plutôt qu’un brûlot politique, Les graines du figuier sauvage a la beauté d’une véritable chronique familiale. L’appartement cossu est un refuge pour la mère et les filles qui suivent les images, prises clandestinement par des portables et diffusées partout sur les réseaux sociaux, des manifestants et des militants des droits civiques traqués et frappés par la police. Lorsque Rezvan veut héberger, pour la nuit, Sadaf, une amie étudiante, sa mère s’y oppose. Mais Najmeh soignera Sadaf lorsque Rezvan ramènera son amie, le visage massacrée par un tir de chevrotines. De son côté, Iman perd complètement pied. Dans son travail, il est devenu suspect depuis que son arme a disparu. Persuadé que sa femme ou ses filles ont volé le pistolet, il va jusqu’à les jeter entre les mains des pires enquêteurs de la police islamique. Convaincu que le danger est partout, Iman décide de partir loin de Téhéran dans la maison où il a grandi… Du huis-clos de l’appartement de Téhéran à celui de la maison dans les montagnes, Mohammad Rasoulof construit un film constamment sous tension. Il passe même quasiment par la case thriller lorsque Iman, au volant de sa voiture, entame un rodéo pour échapper à des activistes qui l’interpellent pour pointer ses exactions. Quand, enfin, Iman sera parvenu dans sa maison, il perdra tout contrôle, allant jusqu’à mener, sur les siens, les mêmes sinistres interrogatoires qu’il pratique dans ses bureaux. De la même manière que le pistolet du film est une métaphore du pouvoir au sens large, l’immense bâtisse ocre, véritable labyrinthe dans lequel se poursuivent Iman, sa femme et ses filles, est une métaphore d’un pays où la liberté est un vain mot. Les graines du figuier sauvage est une œuvre puissante, sobre, bouleversante et utile. (Pyramide)
 QUAND VIENT L’AUTOMNE
QUAND VIENT L’AUTOMNE
Le jour de la Toussaint, Michelle attend la visite de sa fille Valérie qui doit venir lui rendre visite, dans son ravissant coin de la campagne bourguignonne, pour déposer son fils Lucas pour une semaine de vacances auprès de sa grand-mère. Celle-ci est partie, dans les bois, avec son amie Marie-Claude pour cueillir des champignons. Quelques heures plus tard, Michelle a cuisiné les champignons et se réjouit d’accueillir sa fille et son petit-fils. Si Lucas est ravi de retrouver Michelle, les relations de Valérie avec sa mère sont beaucoup plus tendues. Las, l’assiette de champignons passe mal. Valérie est transportée à l’hôpital pour un lavage d’estomac. De retour, elle décide de quitter immédiatement la Bourgogne avec Lucas. Le cinéaste de Grâce à Dieu (2018) et Eté 85 (2020) plante son décor dans la Nièvre, du côté de Donzy et de Cosne-sur-Loire pour un drame bien servi par les lumières mordorées du chef opérateur Jérôme Alméras. Un paysage automnal apaisé et quasiment immobile qui va venir en rupture avec l’histoire de Michelle, avec les doutes qui s’installent puisque rien n’est totalement volontaire ou clair dans ses actes. Car, pour être placée sous le signe de la douceur et de la simplicité, la mise en scène ne cesse jamais de distiller une tension et un suspense sur les véritables enjeux des personnages, confrontés à des cas de conscience complexes, au-delà du bien et du mal. Quand vient l’automne fait la part belle à deux femmes âgées. Véritable thriller avec ses fausses pistes (à chacun de se faire son opinion sur les motivations de Michelle), le film questionne le temps qui passe, le vieillissement, les silences du quotidien, les brèves absences, les douleurs muettes et infligées, une forme de protection comme moyen de survie, le poids de l’héritage mais aussi l’amour intangible pour un petit-fils. Magnifique quand, la gorge serrée par les rebuffades de sa fille, elle traverse, désabusée et perdue, son jardin potager, Michelle offre à Hélène Vincent, 81 ans, l’inoubliable Madame Le Quesnoy de La vie est un long fleuve tranquille (1988), l’un de ses plus beaux rôles au grand écran. Avec sa doudoune rose, Michelle partage une vraie amitié avec Marie-Claude, superbement incarnée par une Josiane Balasko dont la démarche, le corps, le visage dégagent une forte humanité. A côté de ces deux remarquables comédiennes, on retrouve, avec plaisir, Ludivine Sagnier (Valérie) qui revient au cinéma d’Ozon plus de vingt ans après Swimming Pool (2003) et Sophie Guillemin, lumineuse en femme-flic. Et puis on découvre, à chaque apparition un peu plus, Pierre Lottin qui fit ses débuts dans le rôle de l’aîné de la saga des Tuche (2011-2025) et qui impressionne, ici, dans le rôle de Vincent, le fils de Marie-Claude qui vient de sortir de prison. Avec une énergie qui fait songer au Depardieu des jeunes années, Lottin campe brillamment un type ambigu, vulnérable et inquiétant dont on se dit qu’il peut vriller à tout moment. (Diaphana)
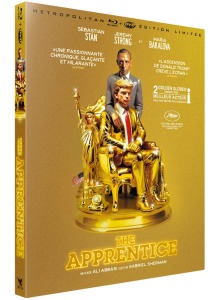 THE APPRENTICE
THE APPRENTICE
Bien avant de devenir milliardaire, star d’une émission de télé-réalité ou président des États-Unis, Donald J. Trump a été, dans les seventies, un travailleur acharné, déterminé à faire fortune sur le marché immobilier new-yorkais. Même si, à l’époque, Manhattan était considéré comme un quartier miséreux et gangréné par la criminalité, Trump était convaincu que la ville allait renaître de ses cendres et qu’il était l’homme de la situation pour mener cette renaissance – si seulement il avait les bons appuis. Ces appuis, il va les trouver en écumant les boîtes de nuit réservées à l’élite new-yorkaise. C’est là qu’il croise Roy Cohn, avocat aussi pugnace que sulfureux. D’emblée, les deux hommes se rapprochent dans la même volonté d’intégrer la haute société de New York qui les bat froid alors même que l’un et l’autre appartiennent à des milieux aisés. Connu pour Les nuits de Mashad (2022), le cinéaste irano-danois Ali Abbasi n’entend pas balayer tout le parcours de Trump. Il porte un regard plus intime sur un épisode de la vie de Trump qui aura des répercussions majeures sur la culture américaine et le monde dans son ensemble. Le projet du film date du printemps 2017. Trump est président depuis quelques mois seulement. Le scénariste Gabriel Sherman observe que, pendant sa campagne et ses premiers jours à la Maison Blanche, Trump se servait de tactiques auxquelles Cohn l’avait initié, notamment utiliser les médias. Car faire parler de soi aux infos est un moyen d’obtenir du pouvoir. La relation entre Trump et Cohn donne naissance à un conte moral en forme de thriller sans coups de feu mais non sans violence. On y voit comment un jeune entrepreneur qui cherche ses mots tout comme l’approbation et la reconnaissance de son père, tombe sous le charme d’un Cohn qui va lui livrer toutes les ficelles pour mettre à profit un système corrompu en usant de méthodes aussi sournoises que féroces. Ainsi Roy Cohn lui fournit trois commandements capitaux. Règle n°1 : Attaquer. Attaquer. Attaquer. Règle n°2 : Ne rien reconnaître. Tout nier en bloc. Règle n°3 : Revendiquer la victoire et ne jamais reconnaître la défaite. De son côté, le credo de Trump est simple comme bonjour. « Dans la vie, dit-il, il y a deux types de gens. Les tueurs et les losers ». On a compris que lui se situe du côté des gagnants. Donc des tueurs. Sebastian Stan campe un jeune Trump excessif et haineux et à la morale sinon absente, du moins très élastique. L’excellent Jeremy Strong se glisse dans la peau de Roy Cohn, conseiller juridique de Trump de 1974 à 1986. Type sulfureux dont l’existence lui vaudra d’être emporté par le sida, Cohn, dans l’ombre, va façonner un disciple qui en viendra in fine à le dominer après avoir compris ses leçons les plus inquiétantes. On le sait bien, le cinéma n’a jamais changé le monde mais il peut nous éclairer. Cette évocation de Trump est à la fois distrayante tout en faisant froid dans le dos. (Metropolitan)
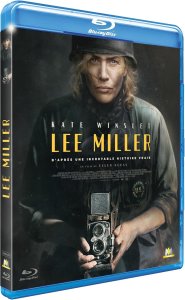 LEE MILLER
LEE MILLER
C’est le temps béni des vacances sur la Côte d’Azur, les heures de farniente avant que les ombres de la Seconde Guerre mondiale s’avancent sur l’Europe. A Mougins, à la fin des années trente, Lee Miller, qui fut mannequin pour Vogue, passe du bon temps avec Pablo Picasso, les Eluard… C’est là que l’existence de Lee va croiser celle de l’écrivain surréaliste Roland Penrose. Elle épousera le Britannique dans l’Angleterre de 1947. Auparavant la vie de Lee Miller aura été bouleversée pour toujours par sa participation à la guerre en tant que reporter de guerre, témoignant, dans les rangs de la 83e division américaine, des combats de Normandie avant de poursuivre vers l’Allemagne en étant, l’une des premières, avec David E. Scherman, correspondant du magazine Life, à découvrir l’horreurs des camps de concentration de Buchenwald et Dachau… Il faudra à Lee Miller batailler dur pour que ses photos soient publiées. Elles le seront dans un numéro du Vogue américain dans l’immédiat après-guerre… C’est en tombant, à New York, sur un livre consacré à Lee Miller qu’Ellen Kuras prend connaissance de l’extraordinaire destin de l’artiste américaine (1907-1977). Comme elle trouve un air de ressemblance entre Lee et Kate Winslet, elle décide d’envoyer un exemplaire à la comédienne. Quelques années plus tard quand Kate Winslet songe à incarner Lee Miller, elle va demander à Ellen Kuras de la mettre en scène. Lee Miller est une bonne occasion de découvrir cette partie de la vie de Lee que furent les années de guerre. Une époque où celle qui fut la muse et la compagne de Man Ray dira : « Je préfère faire des photos que d’être dessus ». Et puis ce personnage de femme déterminée, quand même peu connue du grand public, permet à la cinéaste de brosser le portrait d’une femme habitée par un esprit de liberté et de révolte contre l’ordre social établi, tant dans sa vie amoureuse, sa carrière. Sans oublier de précurseurs idéaux féministes. Cet agréable biopic offre à Kate Winslet un nouveau personnage de femme forte et indépendante même si ses fêlures sont abondantes et douloureuses. L’inoubliable interprète de Rose DeWitt dans Titanic (1997) se glisse avec aisance dans la peau d’une rebelle qui ira jusqu’à essuyer ses bottes boueuses sur le tapis de bain blanc de l’appartement privé d’Hitler. Le 30 avril 1945, Lee et Scherman sont à Munich. Au 16 de la Prinzregentenplatz, ils montent à l’appartement privé d’Hitler. Le même jour, le Führer vient de se suicider dans son bunker de Berlin. Avisant la salle de bain, Lee décide de se baigner. Scherman shoote la photo qui sera publiée dans Vogue en 1945. Comme un défi à l’horreur du nazisme et du totalitarisme. La séquence fameuse fit entrer Lee Miller dans la légende de la photographie. (M6)
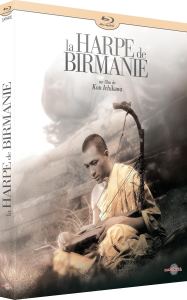 LA HARPE DE BIRMANIE
LA HARPE DE BIRMANIE
Dans la jungle birmane, en juillet 1945, une section de l’Armée Impériale japonaise est en déroute. Apeurés, les soldats craignent de tomber sur l’ennemi et rêvent de rentrer au pays, même s’ils se doutent bien qu’il est en piteux état. Parmi les soldats se trouve Mizushima, un joueur de harpe, qui ravive le moral des hommes et sert d’éclaireur grâce à son instrument. Lors d’une halte dans un village, la section est cernée par les troupes britanniques. Alors qu’il sait bien que la cause est perdue et afin d’éviter un massacre, le capitaine Inoue, chef de choeur dans le civil, ordonne à ses hommes de chanter pour signifier leur pacifisme. En face, les soldats anglais répondent à leur tour en chantant There is No Place Like Home. Les soldats nippons se rendent sans violence. Mizushima est alors chargé de convaincre un groupe de soldats japonais, réfugiés sur un piton montagneux, de cesser de se battre et de se livrer aux Anglais. Mizushima est très mal accueilli par ses compatriotes qui le traitent de lâche. La négociation est un échec, les soldats japonais tous éliminés et le joueur de harpe laissé pour mort. Plusieurs jours plus tard, alors que ses compagnons, désormais prisonniers de guerre, s’inquiètent du sort de Mizushima, ils croisent un moine birman qui lui ressemble de façon troublante… En 1956, le cinéaste japonais Kon Ichikawa adapte un classique de la littérature nippone signé de Michio Takeyama qui s’intéresse à l’histoire vraie du soldat Kazuo Nakamura. Attiré très jeune par le bouddhisme, ce soldat se destinait à devenir moine avant d’être enrôlé et de combattre notamment en Birmanie. Outre ses activités chorales, Nakamura se consacra à la mémoire des soldats tués au combat. Avec son trentième long-métrage, Ichikawa (1915-2008) va connaître son premier grand succès international, le film étant en compétition à la Mostra de Venise et en sélection pour l’Oscar du meilleur film étranger. Dans une mise en scène limpide qui évolue entre la tension guerrière et un apaisement musical, La harpe de Birmanie se présente comme un conte humaniste et une émouvante fable pacifiste portée par la belle musique d’Akira Ifukube. Face à la guerre qui met à l’épreuve l’âme humaine, Mizushima (Shoji Yasui), désormais bonze, s’isole du groupe des soldats et entame un trajet mystique dans un monde en ruine où, partout, il est confronté aux méfaits de la guerre. Ichikawa construit son film sur deux voies, celle, collective, de la vie et de la reconstruction et celle, personnelle, du travail de deuil. Dans une nouvelle restauration 4K, La harpe de Birmanie sort pour la première fois en Blu-ray. Dans les suppléments, une préface de Diane Arnaud, universitaire et critique de cinéma et L’histoire d’un soldat (24 mn) dans lequel Claire Akiko-Brisset raconte l’aventure du soldat Nakamura. (Carlotta)
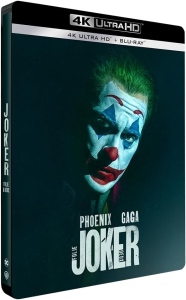 JOKER : FOLIE A DEUX
JOKER : FOLIE A DEUX
Deux ans après ses crimes sous les traits de Joker, Arthur Fleck est, en 1983, interné au sinistre hôpital psychiatrique Arkham de Gotham City dans l’attente prochaine de son procès. Toujours déchiré entre ses deux identités, Arthur est la cible des gardiens qui le chambrent sans arrêt : « T’as pas une blague pour nous, ce matin ? » Mais le détenu de la cellule 258 s’enferme dans un mutisme souvent inquiétant tant son regard transperce ses interlocuteurs. La première fois qu’il lâche quelques mots : « Je peux avoir une cigarette ? » Tandis que Maryanne Stewart, son avocate, prévoit de plaider un trouble dissociatif de l’identité pour faire valoir que le personnage de Joker est responsable des crimes commis deux ans plus tôt, Arthur tombe en arrêt devant l’atelier de musicothérapie. Il remarque d’emblée Lee Quinzel qui ne le lâche pas des yeux. Comme le détenu se tient bien, un gardien l’autorise à fréquenter l’atelier. Pour Arthur, c’est l’occasion de se rapprocher de Lee qui, complètement fascinée par lui, affirme qu’elle a vu pas moins de dix fois le téléfilm consacré à Arthur/Joker. Alors que son procès va s’ouvrir, Fleck va rejoindre Lee dans une folie commune au travers de la musique alors qu’à l’extérieur du tribunal, les nombreux partisans de Joker affichent leur soutien pour qu’il soit libéré. Cinq ans après la sortie de Joker, voici donc Joker : Folie à deux qui s’ouvre en dessin animé, façon Merrie Melodies (co-signé du Français Sylvain Chomet) dans lequel le Joker se bagarre avec une ombre qui veut son indépendance… Todd Phillips revient derrière la caméra pour une approche cette fois, très musical de son récit. Bien sûr, le film s’inscrit dans deux sous-genres bien déterminés : le film de prison et le film de procès mais en y intégrant de multiples références aux grandes heures de la comédie musicale, avec, par exemple, Fred Astaire chantant That’s Entertainment. On entend aussi Get Happy, Fly Me to the Moon, That’s Life, voire même une variation sur le Ne me quitte pas de Brel. Si le thriller perd, petit à petit, de son rythme et peine alors à captiver, il reste qu’on demeure impressionné par la brillante performance d’un Joaquin Phoenix, toujours aussi habité. Le visage émacié, l’oeil brûlant, le mot rare puis entraîné dans un torrent verbal, son Arthur Fleck est à la fois pathétique et effrayant. A ses côtés, Lady Gaga (qu’on avait vu, pour la dernière fois au cinéma, dans House of Gucci en 2021) est crédible dans le personnage trouble et tordu de Lee Quinzel. Sur les ailes de la transe… (Warner)
 SECONDS
SECONDS
Banquier âgé d’une quarantaine d’années, Arthur Hamilton est las de son quotidien routinier. Un jour, il reçoit un jour un appel surprenant, venant d’un ancien ami que tout le monde croyait mort, et qui lui propose de changer de vie. Intrigué, Hamilton pousse ses recherches, et atterrit entre les mains d’une mystérieuse société, fonctionnant sur le bouche-à-bouche, lui faisant effectivement miroiter d’avoir la vie dont il a toujours rêvé… S’il hésite d’abord, Hamilton va s’engager dans un programme lui permettant de démarrer une nouvelle vie en échange de 30 000 dollars. Cet argent couvre entre autres les frais de chirurgie esthétique du faciès, de l’acquisition et la transformation d’un cadavre qui permet de simuler sa mort. S’ensuit la chirurgie esthétique qui change son visage, ce qui le rajeunit considérablement, puis Arthur doit suivre une période de rééducation. Enfin, pour découvrir sa future carrière, il apprend qu’il avait effectué avant l’opération chirurgicale une analyse psychologique sous substance psychotrope, qui révèle qu’il souhaite être un artiste peintre. La compagnie lui fournit alors une nouvelle identité, Antiochus Wilson, peintre diplômé d’une école d’art, qui a déjà réalisé plusieurs expositions, et qui habite à Malibu. En 1965, John Frankenheimer, qui avait déjà à son actif des films comme Le prisonnier d’Alcatraz (1962), Sept jours en mai (1964) et Le train (1964) tourne Seconds qui deviendra L’opération diabolique pour sa distribution française. Pour tenir le double rôle d’Hamilton/Wilson, le cinéaste avait pensé à Kirk Douglas ou Laurence Olivier. Il choisira finalement Rock Hudson qui parviendra à convaincre Frankenheimer qu’il ne pouvait qu’incarner Wilson. Le cinéaste confiera le rôle d’Hamilton à John Randolph, un comédien longtemps demeuré sans travail à cause de son inscription sur la sinistre liste noire d’Hollywood. Le film est présenté en sélection officielle au festival de Cannes 1966 et il est très mal accueilli par la presse européenne. Il faudra attendre une ressortie au milieu des années 2010 pour que Seconds soit enfin perçu comme une œuvre radicale, visuellement splendide (le générique de Saul Bass est remarquable) fonctionnant comme un cauchemar paranoïaque et qui dénonce, au passage, les mirages du rêve américain. Un thriller psychédélique dissonant qui mérite d’être redécouvert et qui sort dans une édition digibook avec une présentation par Jean-Baptiste Thoret, des interviews du cinéaste et de Rock Hudson, enfin un livre de 48 pages écrit par Olivier Père. (Sidonis Calysta)
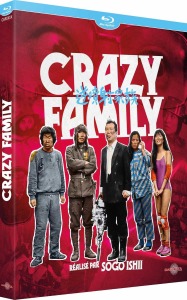 CRAZY FAMILY
CRAZY FAMILY
Katsukuni Kobayashi est sur un petit nuage : le voilà heureux propriétaire d’une moderne maison de banlieue dans laquelle il vient d’emménager avec sa famille. Maintenant c’est sûr, tous ses problèmes vont s’envoler! Chacun à sa propre occupation. Le père Katsuhiko se consacre obsessionnellement à son travail, la mère Saeko est un modèle idéal de femme au foyer, le fils Masaki se consacre sérieusement à ses examens et Erika est une gentille petit fille fan de J-pop et de catch qui aspire à devenir célèbre par le biais du cinéma ou de la chanson. Mais le père déchante rapidement lorsqu’il découvre que la maison est infestée de termites. Mais ce petit monde va basculer dans la plus pure folie lorsque débarque Kobayashi, le grand-père venu sans crier gare rendre visite à son fils et sa famille. Le patriarche va s’incruster petit à petit, semant la discorde et la folie au sein de la famille. Avec des personnages qui semblent sortis d’un manga foutraque, Sogo Ishii va pousser le bouchon de plus en plus loin alors que Katsukuni décide de prendre des mesures drastiques pour sauver les siens… Le père va fermer toutes les issues possibles, imaginant entraîner les siens dans un harakiri collectif. Autant dire que la maisonnée va devenir un champ de bataille. Toutes les armes sont bienvenues pour estourbir les adversaires. Alors, on travaille au couteau, à la batte de baseball, au sabre, pourquoi pas au marteau piqueur (Katsukuni avait imaginé de construire une pièce au sous-sol pour son père), voire même aux prises de catch qu’Erika apprécie tant. Tout cela fait de Crazy Family un vaste et savoureux délire ! Fidèle à son style outrancier et punk, Sogo Ishii (Crazy Thunder Road) signe, en 1984, une comédie déjantée teintée d’humour noir, qui s’attaque à la sacro-sainte institution que représente la famille au Japon. Dans ce home invasion où la menace vient de l’intérieur, le cinéaste explose les idées préconçues sur le bonheur familial, cauchemar déguisé qui finit par étouffer ses personnages. Influence revendiquée par Takashi Miike pour son déjanté Visitor Q (2001), Crazy Family est un réjouissant jeu de massacre. Cette satire drôle, jouissive et dérangeante est disponible pour la première fois en Blu-ray dans sa version restaurée 2K et est accompagnée de bons suppléments. Dans un entretien (28 mn), le réalisateur Gakuryu Ishii ex-Sogo Ishii, secondé par le mangaka Yoshinori Kobayashi et la troupe de la Directors Company, explique avoir voulu élaborer avec Crazy Family un nouveau genre de drame familial, traitant de la violence au Japon. Avec Crazy Family : l’enfant rebelle de Sogo Ishii (19 mn), James Balmont, spécialiste du cinéma de l’Asie de l’Est, analyse la place de Crazy Family au sein de la filmographie du réalisateur. (Carlotta)
 MAD FATE
MAD FATE
Par une nuit d’orage, un maître de feng shui tente de sauver une prostituée d’une mort certaine, mais le destin en a décidé autrement. Arrivé à son domicile, il découvre le corps de la jeune femme, victime d’un abject serial killer. Un livreur déboule à son tour sur la scène de crime, hypnotisé et fasciné par ce qu’il voit. Le maître de feng shui (Gordon Lam) prédit au garçon un avenir sombre et meurtrier. Mais cette fois, il jure de tout faire pour changer le cours des choses. Sauf que l’inspecteur chargé de l’enquête est convaincu que le livreur est un psychopathe-né dont la soif de sang ne peut être arrêtée.. Deux ans après son virtuose et ultra-violent Limbo, le réalisateur hongkongais Soi Cheang signe, en 2023, un nouveau coup d’éclat avec Mad Fate qui porte dans son ADN l’héritage des stylistes de genre qui ont marqué le cinéma d’action hongkongais, de Ringo Lam (City on Fire) à Johnnie To (Mad Detective), qui officie ici en tant que producteur. Abandonnant le noir et blanc crasseux pour une palette de couleurs très « giallesque », le surdoué Soi Cheang livre une vision hallucinée et jubilatoire de Hong Kong, qui lorgne aussi bien du côté du thriller désenchanté que de la comédie décalée et surnaturelle. Mélange détonnant entre polar et fantastique, Made Fate, avec une énergie folle, embarque le spectateur dans un impressionnant chaos de spiritualité volontiers dérisoire et de pulsions morbides, le tout dans un récit bouillonnant qui s’achève dans une folie totale. En suppléments, on trouve Le poids du destin (16 mn), un entretien inédit dans lequel Soi Cheang parle de sa collaboration avec Johnnie To et son scénariste phare Yau Nai-hoi, tous deux à l’initiative de Mad Fate, puis revient sur la notion de destinée et sur le message de son film. (Carlotta)
 CONSTANTINE
CONSTANTINE
Condamné à errer en enfer à cause d’un suicide raté, John Constantine, exorciste et médium capable de voir l’autre monde, tente de racheter son salut. Afin de gagner sa place au paradis, il a accepté de lutter sans relâche contre les créatures du Mal. Alerté par une série d’événements étranges liés au mystérieux suicide d’Isabel, la soeur jumelle de Katelin Dodson, une inspectrice de police (Rachel Weisz) plutôt incrédule, John Constantine découvre bientôt que la pire des menaces pèse sur le monde, et sur les habitants de la ville de Los Angeles en particulier. Et surtout Constantine représente le seul espoir de l’humanité. Réalisateur fétiche de la saga Hunger Games, l’Américain Francis Lawrence s’était fait remarquer avec Je suis une légende (2007) avec Will Smith puis de De l’eau pour les éléphants (2011) avec Reese Witherspoon et Robert Pattinson. Mais il avait débuté, en 2005, dans la réalisation avec cette adaptation de la série de comics Hellblazer. Tournant le dos aux héros en collant hollywoodiens, Lawrence a fait le choix de placer Constantine dans un univers démoniaque qui, pour être distrayant, n’est pas spécialement « excité ». Mieux, l’atmosphère sombre et oppressante du récit s’adresse plutôt à un public adulte. Comme la mise en scène est soignée et que les effets spéciaux sont bons, l’ensemble avance avec une suite de temps forts. Après avoir été Neo dans les trois opus de la saga Matrix (1999-2003), Keanu Reeves se glisse, ici, dans la peau d’un extralucide anticonformiste qui se lance dans une enquête qui lui fera découvrir l’univers des anges et des démons qui hantent les sous-sols du Los Angeles d’aujourd’hui. Vingt ans après sa sortie en salle, ce film d’action fantastique revient dans une version restaurée 4K exclusive en édition collector Blu-ray présentée dans un Steelbook comprenant des bonus inédits notamment Deux décennies de damnation dans lequel Keanu Reeves et le réalisateur Francis Lawrence se retrouvent face caméra pour célébrer le 20e anniversaire de ce film culte. Avec également les commentaires audio du cinéaste, des scènes coupées et une fin alternative. (Warner)
 MA VIE MA GUEULE
MA VIE MA GUEULE
Dire que Barberie Bichette est complètement à l’ouest, est un doux euphémisme. Celle qu’on appelle à son grand dam, Barbie, a peut-être été belle, peut-être été aimée, peut-être été une bonne mère pour ses enfants, une collègue fiable, une grande amoureuse, oui peut-être… Mais aujourd’hui, c’est noir, c’est violent, c’est absurde et ça la terrifie : elle a 55 ans (autant dire 60 et bientôt plus !). C’était fatal mais comment faire avec soi-même, avec la mort, avec la vie en somme… Alors Barbie parcourt l’existence comme une sorte de zombie. Oh, pas un méchant zombie mais un zombie quand même. Qui traverse sans s’arrêter la salle de réunion de son boulot dans la com’ ou qui croise, dans un jardin public à l’heure du déjeuner, Philippe Katerine. Avec Ma vie ma gueule, Sophie Fillières invite le spectateur à observer un monde dont l’inintelligible parfois nous dépasse, nous écrase, nous effraie et parfois nous rehausse, nous hisse, là où on ne s’y attend pas. Voici, entre sourire et détresse, une manière de conte fortement poétique dans ce sens où il déstabilise et émeut tout à la fois. Emportée par la maladie en 2023 alors qu’elle venait d’achever le tournage de son film, la cinéaste de 58 ans, expliquait: « Je voudrais essayer de traiter de plein fouet, pif, paf, youkou !, comment se débrouiller et faire avec l’énigme de soi. Car nous en sommes toutes et tous une. Comment nous admettre comme personnage, ce qui nous inscrira enfin dans une histoire qui serait la nôtre propre ? » Bien sûr, il faut, ici, se laisser prendre, se laisser promener par le bout du nez sous peine de décrocher assez vite. Mais, comme la cinéaste, on peut faire confiance à cette épatante comédienne qu’est Agnès Jaoui. Habituée des rôles « normaux » bien ancrés dans le réel, elle s’offre, ici, de la fragilité, de l’instable, du déséquilibre. Avec elle, Barbie se débat comme elle peut sur un fil à peine encore assez tendu, en équilibriste trompe-la- mort, trompe-la-détresse, trompe-le-craquage… (jour2fête)
 C’EST LE MONDE A L’ENVERS
C’EST LE MONDE A L’ENVERS
Le climat s’emballe, l’économie s’effondre… Stanislas, un trader parisien redouté des buildings de La Défense, se retrouve démuni : plus d’eau, plus d’électricité, plus de connexion, et plus de compte en banque. Sa femme, Sophie, le convainc d’aller trouver refuge avec leur fils à la campagne chez Patrick, un agriculteur dont Stanislas vient d’acheter la ferme dans un but spéculatif et dans une démarche de greenwashing. Mais Patrick et Constance, sa femme, ont aussi tout perdu avec la crise, et ils n’entendent pas céder leurs terres à ces Parisiens fraichement débarqués sur leur propriété. Malgré tout ce qui les oppose, ces deux familles vont devoir apprendre à vivre ensemble avec comme seules ressources, celles que la nature offre et ainsi inventer les codes d’un nouveau monde. Quand tout déraille et que tout s’effondre à cause de la crise économique, que peut faire le genre humain ? Connu autant comme aventurier avec des expéditions à travers la Laponie, l’Alaska ou la Sibérie que comme écrivain, Nicolas Vanier compte également pas moins d’onze longs-métrages de fiction à son actif. On se souvient ainsi du Dernier trappeur (2004), Belle et Sébastien (2013) d’après la série télé éponyme ou Donne-moi des ailes (2019) inspiré de l’histoire vraie de Christian Moullec, l’homme qui vole avec les oiseaux, cygnes, grues et oies. Il signe, ici, une comédie dramatique d’anticipation où la ville et la campagne vont devoir cohabiter, au propre comme au figuré, et plus encore accepter de bâtir des compromis. Si la dimension de la comédie est bien présente dans cette aventure rurale (le film a été tourné à Vézelay dans le Morvan), le réalisateur invite cependant le spectateur à se questionner sur une apocalypse où l’argent n’aura plus de valeur, pas plus que les biens matériels non plus et où il convient de revenir aux sources pour survivre. Pour porter ce message qui a des accents contemporains, Nicolas Vanier se repose sur une belle distribution avec Michaël Youn en trader, Eric Elmosnino en homme de la campagne, Barbara Schulz, Valérie Bonneton, François Berléand et Yannick Noah qui débute au cinéma. Quand le retour à la nature s’impose ! (Gaumont)
 QUAND LE CLAIRON SONNERA
QUAND LE CLAIRON SONNERA
Dans le Texas des années 1830, Jim Bowie, un grand propriétaire terrien marié à une Mexicaine, débarque à Anahuac où les colons ne supportent plus le despotisme grandissant du président mexicain Antonio López de Santa Anna qui refuse leurs demandes de réformes gouvernementales. Pour mater la rébellion, ce dernier envoie sur place plusieurs garnisons. Une poignée de Texans décident alors de prendre les armes pour défendre leurs droits. Jim Bowie se rallie à eux. Les combats deviennent vite intenses entre les résistants et les renforts mexicains… Evidemment, on songe au célèbre Alamo réalisé en 1960 par John Wayne. Le Duke y incarnait aussi le trappeur Davy Crockett dans cette page fameuse de la guerre d’indépendance du Texas. Cinq ans plus tôt, Frank Lloyd signait The Last Command (en v.o.) qui allait être son dernier long-métrage et qui racontait également l’aventure du fort Alamo, cette fois du point de vue d’un autre héros de cette bataille inégale, en l’occurrence Jim Bowie qui y laissera, comme Crockett ou Travis, la vie. Dans l’Alamo de Wayne, c’est Richard Widmark qui tenait le rôle de Bowie. Ici, c’est Sterling Hayden qui est impressionnant en Bowie ami avec le général Santa Anna et qui tente de le convaincre de prendre en compte les préoccupations des Texans. En vain. Bowie retrouvera une ultime fois Santa Anna, sous drapeau blanc, pendant le siège du fort, chacun comprenant le point de vue de l’autre et convenant que les événements sont devenus incontrôlables. Si le film est parfois un peu bavard, Frank Loyd, célèbre pour avoir réalisé en 1935, Les révoltés du Bounty avec Clark Gable et Charles Laughton qui lui valut l’Oscar du meilleur film en 1936, réussit de remarquables scènes d’action. L’assaut final sur Alamo est aussi remarquable que celui de Wayne. (Sidonis Calysta)
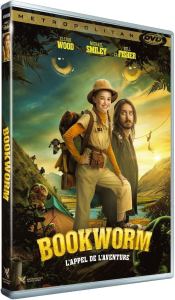 BOOKWORM
BOOKWORM
Parce que sa maman a été hospitalisée à la suite d’un accident de grille-pain, le monde de Mildred, 11 ans, va être complètement bouleversé. Car voilà que débarque Straw, son père, qu’elle n’a jamais connu. Celui-ci est un magicien en rupture de ban qui vient s’occuper d’elle et qui accepte, soucieux de faire plaisir à la gamine, de l’emmener camper à la recherche de la légendaire panthère de Cantorbery et ainsi pouvoir récupérez le prix de 50 000 dollars offert à tout explorateur intrépide qui réussira la mission de prouver que la bête mythologique existe. Comme, en plus d’être blessée, la mère de Mildred est lourdement endettée, la fillette y voit l’occasion d’une surprise lorsqu’elle se réveillera en payant ses factures… Voici, dans les magnifiques décors naturels de Nouvelle-Zélande, une aventure familiale qui a tous les atours du feel good movie tout en traitant de thèmes comme la monoparentalité, les liens du sang ou la prise de responsabilité Avec d’un côté une Mildred (la douée Nell Fisher) intelligente, indépendante et débrouillarde et d’autre part, un père, magicien raté (il préfère qu’on dise illusionniste) qui n’a jamais rien accompli de sa vie. Ou quand les enfants montrent le (bon) chemin à leurs parents ! Ecrit pour Elijah Wood dans le rôle d’un père aussi maladroit que pathétique mais qui finit par être chaleureux, le film d’Ant Timpson permet donc de trouver le comédien américain devenu mondialement célèbre en interprétant le Hobbit Frodon Sacquet dans la trilogie Le seigneur des anneaux (2001-2003) de Peter Jackson. Si, par la suite, Wood a tenu de bons rôles dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) ou Sin City (2005), il a depuis un peu disparu des grands écrans. Le voilà donc, bien attachant en magicien raté mais en père humain. (Metropolitan)
 ELEVATION
ELEVATION
Dans un monde post-apocalyptique où l’humanité, déjà détruite à 95 %, s’est réfugiée en altitude, parce que plein de vilaines bêtes bouffent tous ceux qui s’aventurent sous la ligne de 2400 mètres d’altitude, un gamin a disparu… Un père célibataire et deux femmes s’allient pour affronter ces affreuses créatures (qui localisent leurs victimes grâce à leur souffle) afin de sauver la vie de l’enfant. Le quatrième long-métrage de l’Américain George Nolfi, connu aussi comme scénariste notamment d’Ocean Twelve (2004), se range dans la catégorie des thrillers d’action « postapo ». Ici, pour sauver la vie de son jeune fils Hunter, qui souffre d’une maladie entraînant des difficultés respiratoires, Will part avec la scientifique Nina et une jeune femme nommée Katie pour obtenir les médicaments dont Hunter a besoin. Cela les amène à descendre sous la limite des montagnes Rocheuses, que les créatures ne peuvent pas franchir. Bien que le père méprise la scientifique, elle pourrait détenir la clé pour vaincre les monstres. Nina pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils découvrent comment tuer les créatures. Si Elevation n’est pas spécialement passionnant du côté de son scénario, cette série B comporte cependant des séquences captivantes. Et comme le trio d’aventuriers est expert dans le maniement des armes à feu, on comprend que les sales bestioles vont prendre cher… Nolfi a confié le rôle de Will à Anthony Mackie vu dans Million Dollar Baby (2004) et qui sera prochainement Captain America dans Captain America : Brave New World, celui de Nina à Morena Baccarin qui fut Vanessa Carlysle dans Deadpool (2016), Deadpool 2 (2018) et Deadpool et Wolverine (2024) et enfin le personnage de Katie à Maddie Hasson connue pour son rôle de Willa Monday, une Gitane délinquante juvénile dans la série de la Fox The Finder. Pas surprenant mais plutôt efficace. (Metropolitan)
 LES YEUX DE FEU
LES YEUX DE FEU
En 1750, un pasteur, chassé de son village pour adultère, s’enfuit avec quelques fidèles dans une région inexplorée d’Amérique du Nord. Le petit groupe finit par trouver un endroit où s’installer, inconscient des dangers qui se cachent dans les bois environnants. Avec son univers peuplé d’esprits hostiles, avec une jeune femme aux dons extraordinaires et une forêt hantée par une terrifiante sorcière, le premier film d’Avery Crousne frappe par son originalité, son atmosphère étrange et onirique. Situé en 1750, une période historique riche peu exploitée dans le cinéma de genre, le film mêle habilement l’horreur surnaturelle avec des éléments folkloriques et historiques. En relatant l’histoire d’un groupe de pionniers aux croyances chrétiennes rigides durant la colonisation américaine, le réalisateur, qui fut photographe, propose une reconstitution historique impeccable. L’ajout du surnaturel et de l’horreur témoigne des angoisses liées à la colonisation, à la nature sauvage et au climat de danger qui entoure l’homme lorsqu’il s’éloigne de la civilisation. Les yeux de feu repose sur un style visuel original. Les effets spéciaux psychédéliques peuvent d’abord paraître datés mais au final, ils donnent à l’ensemble une allure de cauchemar biscornu, pour une terreur psychologique teintée d’onirisme. Les arbres ornés de plumes, les visages des esprits prisonniers des troncs noueux, ou encore la présence de l’étrange jeune fille aux pouvoirs surnaturels donnent une puissance visuelle évocatrice. Pour embarquer dans un voyage envoûtant et angoissant en terre inconnue… Dans son combo Blu-Ray + dvd + livret de 24 pages, l’édition propose un dvd avec la version longue du film, plus mystérieuse et plus atmosphérique, intitulée Crying Blue Sky. (Rimini Editions)
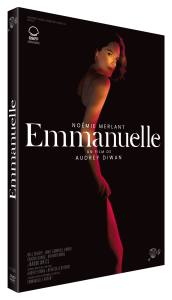 EMMANUELLE
EMMANUELLE
En ce temps-là (1974), Sylvia Kristel, charmante bimbo batave, lovée dans un fauteuil Peacock, affolait, avec ses seins nus, les jeunes spectateurs (les vieux, aussi) et bousculait la sexualité des Trente glorieuses. Le film de Just Jaeckin, solide success story, aura été vu par 8 894 000 millions de spectateurs dans les salles de l’hexagone ! L’Emmanuelle d’Audrey Diwan (remarquée avec L’événement en 2021) embarque le fameux personnage dans une aventure censément féministe, retenant qu’Emmanuelle Arsan, l’auteure du livre-support des deux films, avait écrit un récit à la première personne. « Son héroïne, dit la cinéaste, en est le sujet plus que l’objet. (…) Le premier parti pris qui m’a animé était de redonner à Emmanuelle cette puissance d’être sujet du récit. » La première Emmanuelle était une jeune femme parfaitement oisive qui partait rejoindre à Bangkok un mari libertin. L’Emmanuelle d’aujourd’hui est une executive woman solitaire et sans états d’âme en route pour Hong Kong avec pour pour mission de faire du « contrôle qualité » au coeur du Rosefield, un immense palace de luxe. Elle y croise un couple, Zelda, une jeune étudiante/escort et surtout le mystérieux et insaisissable Kei Shinohara. Qui à la différence des précédents, ne semble pas intéressé par Emmanuelle. Las, le film, avec ses images léchées, ne distille rien de lascif, d’impur, d’érotique pour tout dire. L’Emmanuelle nouvelle est une grande cérébrale qui paraît quasiment se méfier de la gaudriole et du jeu de la bête à deux dos. Noémie Merlant, dont le sex-appeal ne fait aucun doute comme en attestent aussi bien Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma ou Les Olympiades de Jacques Audiard, parvient pourtant à tirer son épingle du jeu. On se demande presque comment tant ce drame érotique manque de fièvre. (Pathé)
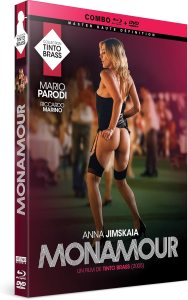 COLLECTION TINTO BRASS
COLLECTION TINTO BRASS
Ce qu’il y a de bien avec Tinto Brass, c’est qu’on n’est jamais surpris par son travail ! Voilà encore, dans la collection qui lui est consacrée, deux occasions de vérifier le goût du cinéaste italien pour le porno soft, pour les situations vaguement scabreuses et pour les femmes voluptueuses qui savent précisément ce qu’elles aiment (en fait, tout). En 1994, il signe L’uomo che guarda (Le voyeur, en vf) dont il tire le scénario d’une nouvelle de l’incontournable Alberto Moravia. C’est l’histoire d’un professeur d’université qui devient obsédé par l’idée que sa femme (la comédienne polonaise Katarina Visilossa) qui prend de plus en plus de distance avec lui, le trompe avec son père invalide. Quant à Monamour, réalisé en 2005, c’est à ce jour le dernier long-métrage réalisé par le metteur en scène aujourd’hui âgé de 91 ans. Jeune femme au foyer, Marta est clairement nymphomane. Elle est mariée à Dario, un éditeur de livres à succès. Bien qu’elle aime toujours son mari, Marta (la comédienne ouzbek Anna Jimskaya) n’a pas pu atteindre la satisfaction sexuelle depuis des mois en raison de leur vie amoureuse terne et prévisible. Alors qu’elle séjourne à Mantoue pour la foire du livre Festivaletteratura, Marta suit les conseils de son amie Sylvia et entame une liaison avec un bel et mystérieux artiste nommé Leon, ce qui entraîne des résultats surprenants concernant son mariage défaillant avec Dario. (Sidonis Calysta)
LES AVENTURES DE JIM, AYMERIC, MASSAMBA, MATI ET CHRISTIANE F. 
 LE ROMAN DE JIM
LE ROMAN DE JIM
C’est l’histoire d’Aymeric, un jeune type qui vit tranquillement dans son coin perdu de province, du côté du Haut-Jura. Une existence sans heurts même si, entraînés par des copains un peu voyous, il s’est laissé embarquer dans le cambriolage d’une villa qui lui valut une paire de mois derrière les barreaux… L’existence d’Aymeric bascule lorsqu’au hasard d’une soirée à Saint-Claude, il croise Florence, une ancienne collègue de travail. Ils se reconnaissent et sont ravis de se revoir. En riant, elle lui dévoile son ventre rond. Elle est enceinte de six mois et célibataire. Aymeric et Florence décident de vivre ensemble sur les hauteurs verdoyantes du Jura. « Qui va s’en occuper de ce loustic ? » interroge Monique, la mère de Florence. « Ben, moi… Avec celui qui sera là quand il sortira. » Quand Jim nait, Aymeric est bien là. Commencent alors de belles années où Jim et Aymeric sont ensemble, jouent, s’amusent, fraternisent au point que, pour le gamin, Aymeric ne peut être un autre que son père. Jusqu’au jour où Christophe, le père naturel de Jim, débarque… C’est un homme complètement cabossé -il a perdu sa femme et ses deux filles dans un accident- que Florence accueille puis, petit à petit, installe chez eux. Tout en s’inquiétant confusément, Aymeric donne le change. N’avait-il pas répondu à Jim qui lui demandait pourquoi ils n’avaient pas le même nom, « Nous avons décidé de ne pas faire les choses comme tout le monde ». Arnaud et Jean-Marie Larrieu, avec leur 9e long-métrage, signent une comédie dramatique qui semble réunir les codes du mélo, à cette nuance près, mais elle est capitale, qu’il n’y a aucun côté « tire-larmes » dans Le roman de Jim. Bien, au contraire, le film repose sur une émotion aussi forte que contenue pour traiter, avec finesse et tendresse, d’une vraie odyssée de la paternité. Le scénario s’appuie, autour donc du thème de la paternité, sur l’adaptation du roman éponyme de Pierric Bailly (paru en 2021 aux éditions P.O.L.) Dans un récit qui s’étend sur presqu’un quart de siècle, entre la naissance de Jim et son (jeune) âge adulte, les Larrieu jouent avec le plaisir de l’ellipse et le spectateur est amené à reconstruire ce qui est arrivé, à deviner ce qui va survenir, à s’interroger évidemment sur les liens du sang et les liens du coeur. Au centre du récit, il y a la figure d’Aymeric qui vit de beaux moments avec ce fils qu’il a fait sien, avant de se voir « dépouiller » de cette paternité, de devoir assumer cette perte, de se reconstruire dans une autre vie et enfin de renouer -douloureusement- le fil avec Jim. Si le film est une belle réussite, c’est aussi parce que les frères ont peaufiné de superbes personnages. Florence (Laetitia Dosch) est une mère qui fait des choix de vie atypiques qu’elle défend avec aplomb. Christophe est incarné tout en fragilité par Bertrand Belin qui signe aussi, ici, en conjointement avec Shane Copin, une bonne musique originale. La lumineuse Olivia (Sara Giraudeau) apporte un vent frais dans le quotidien d’Aymeric.. Enfin, Karim Leklou trouve, avec ce rare, au cinéma, garçon gentil (mais pas benêt) qu’est Aymeric, l’un des plus beaux rôles de sa carrière. Un personnage tout en justesse, délicatesse, tendresse et résilience. Il faut voir le regard d’Aymeric chavirer lorsqu’il entend, au téléphone, le petit Jim dire : « C’est toi, mon vrai papa ! » (Pyramide)
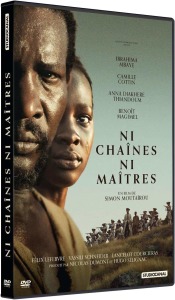 NI CHAINES, NI MAITRES
NI CHAINES, NI MAITRES
1759. Isle de France (l’actuelle île Maurice). Massamba et Mati, esclaves dans la plantation d’Eugène Larcenet, vivent dans la peur et le labeur. Lui rêve que sa fille soit affranchie, elle de quitter l’enfer vert de la canne à sucre. Une nuit, elle décide de s’enfuir. Elle sera traquée sans relâche par Madame La Victoire. Massamba n’a d’autre choix que de s’évader à son tour. Par cet acte, il devient un « marron », un fugitif qui rompt à jamais avec l’ordre colonial. Scénariste chevronné (il a notamment signé le thriller aéronautique Boîte noire (2021) de Yann Gozlan et le thriller « agrochimique » Goliath (2022) de Frédéric Tellier), Simon Moutaïrou passe, ici, pour la première fois à la réalisation. « Instinctivement, explique le cinéaste, je savais que mon premier film traiterait de l’esclavage. Avec du recul, je comprends que cet appel venait de loin. Adolescent, j’ai été profondément marqué par une vision : celle d’une immense porte de pierre rouge face à l’océan. Elle se dresse sur le rivage de la ville côtière de Ouidah, au Bénin, le pays de mon père. Elle se nomme La Porte du Non-Retour. C’est ici que des familles entières étaient arrachées au continent et déportées vers des horizons inconnus. » Lors d’un séjour à Maurice, Moutaïrou va trouver un des grands décors de son film, en l’occurrence le monolithe du Morne Brabant, et entendre le récit de l’un des mythes locaux liés à la période coloniale française de l’île Maurice, faisant état d’un suicide collectif d’esclaves marrons au sommet de ce monolithe, point culminant de l’île. Ayant trouvé un ultime refuge en ce lieu, ces derniers, pourchassés par des soldats et des chiens, choisissent d’y mourir en se jetant du haut de la falaise plutôt que se laisser capturer… Tourné presqu’entièrement en extérieurs, Ni chaînes, ni maîtres, axé sur le thème du marronnage, raconte une terrible traque dans les tréfonds de la nature sauvage et jusque sur les rives de l’océan. Massamba et sa fille Mati, esclaves dans la plantation d’Eugène Larcenet, connaissent les règles. Et d’ailleurs Larcenet ne se prive pas de les annoncer haut et fort. En cas de fuite, le marron est marqué de la fleur de lys. S’il récidive, il aura les oreilles et les jarrets coupés. Et la troisième fuite se soldera par la mort. Massama semble avoir renoncé à toute velléité d ‘évasion. Mati, elle, est prête à tout pour conquérir sa liberté. Bientôt père et fille seront pourchassés par une impitoyable chasseuse d’esclaves engagée par Larcenet. Le personnage de Madame La Victoire a réellement existé. Elle est décrite par l’écrivain et botaniste Bernardin de Saint-Pierre comme « une grande créole sèche qui allait nus pieds suivant l’usage du canton … (…) Elle allait dans les bois, à la chasse aux Noirs marons ; elle s’en faisait honneur… » Par son aspect quasiment documentaire (la résistance à l’esclavage dans la France du 18e siècle) autant que par sa dimension spectaculaire, Ni chaînes, ni maîtres est une chronique épique qui a le souffle du thriller et du film d’action. Enfin, le cinéaste a constitué un solide casting avec Ibrahima Mbaye (vu dans Atlantique de Mati Diop) dans le rôle de Massama, Thiandoum Anna Diakhere (Mati), Benoît Magimel (Larcenet), Felix Lefebvre (le fils Larcenet) et Camille Cottin (Madame La Victoire). (Studiocanal)
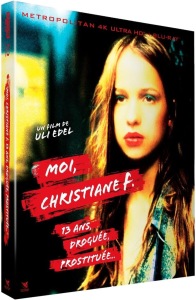 MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS, DROGUÉE, PROSTITUÉE
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS, DROGUÉE, PROSTITUÉE
Jeune Berlinoise de treize ans, Christiane vit très mal le divorce de ses parents et entretient une relation compliquée avec sa mère. La jeune fille qui habite dans un appartement social d’un immeuble délabré de la périphérie de Berlin-ouest, rêve de s’intégrer à une bande d’amis et de s’en approprier les codes. Lorsqu’elle sort en boîte de nuit pour la première fois, sa descente aux enfers commence. La drogue puis la prostitution vont venir ternir le reste de sa jeunesse. En 1978, Kai Hermann et Horst Rieck, deux collaborateurs du magazine Stern, rencontrent Christiane Felscherinow à la sortie d’un tribunal de Hambourg. Les deux journalistes veulent faire un reportage sur les jeunes SDF en Allemagne, récent phénomène de société à cette époque. Leur enquête durait depuis un an, lorsqu’ils ont rencontré Christiane. Dans le cadre de leur projet, ils comptaient brièvement interroger la jeune fille mais, fascinés par l’histoire de cette adolescente de 15 ans, ils ont continué à l’écouter pendant deux mois d’audition à un rythme de quatre à cinq jours par semaine. L’article se transformera finalement en un livre intitulé Wir Kinder vom Bahnhof Zoo publié en Allemagne en 1979 et qui sera vendu, dans le pays, à cinq millions d’exemplaires. En 1981, le cinéaste allemand Uli Edel va adapter le livre en se concentrant sur sa partie centrale (globalement l’année qui précède son témoignage auprès des reporters), en l’occurrence la chute d’une mineure dans la drogue et la prostitution. Le film, qui révèle la jeune Natja Brunckhorst dans le rôle-titre (dans les bonus, la comédienne revient longuement sur la genèse et le tournage), connaîtra un grand succès dans les salles allemandes (4,6 millions d’entrées) et obtiendra immédiatement un statut de film culte en Europe, en sensibilisant le public aux méfaits de l’addiction à l’héroïne. La popularité du film est accrue par la participation de David Bowie (Christiane F. est une fan du chanteur anglais) dans son propre rôle et en tant que principal contributeur à la bande sonore. Moi, Christiane F. (qui sort dans une édition Blu-ray 4K Ultra HD) offre, en décrivant crûment la vie dans les milieux marginaux de Berlin, une plongée poignante et réaliste dans les réalités sombres de l’existence des jeunes toxicomanes, tout en abordant des thèmes tels que la perte d’innocence, la dépendance et la marginalisation sociale. Même avec le recul, le film d’Uli Edel reste un très intéressant témoignage sur la drogue. Le cinéaste, sans tomber dans le sensationnalisme, détaille, en scrutant les visages crayeux des junkies, les irrémédiables ravages physiques et psychologiques des stupéfiants. Dans le night-club qu’elle fréquente, Christiane F. s’initie d’abord au LSD avant de prendre régulièrement de l’héroïne, quitte à se prostituer pour payer ses doses. Lorsqu’elle tentera, avec son ami et amoureux Detlev, de se sevrer brutalement, l’expérience sera atroce avant la rechute dans la schnouf… Une vision sans concession mais bouleversante! (Metropolitan)
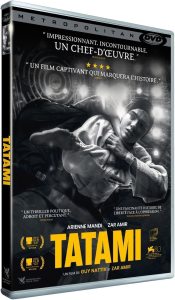 TATAMI
TATAMI
Excellente judoka, Leila Hosseini veut devenir championne du monde à l’occasion des championnats qui se déroulent à Tbilissi en Géorgie. Cette sportive qui remporte les combats à la suite, est soutenue, chez elle, par son mari, son jeune fils et toute une famille enthousiaste. Les choses se compliquent lorsque Leila pourrait affronter, en finale, Shani Lavi, une judoka israélienne. Maryam Ghanbari, la coach de Leila, reçoit alors un appel téléphonique de la fédération iranienne de judo: Leila doit feindre de s’être blessée et déclarer forfait. Surprise, Maryam finit par transmettre cet ordre à Leila, qui refuse catégoriquement. Les pressions se font de plus en plus fortes sur les deux femmes dont les relations se tendent. Leurs familles restées en Iran sont directement menacées… Premier long-métrage co-réalisé par l’Israélien Guy Nattiv et l’actrice iranienne Zar Emir Ebrahimi, couronnée meilleure actrice à Cannes 2022 pour son rôle dans Les nuits de Mashhad, Tatami se présente comme un thriller politique sportif, résolument féministe qui met en scène le combat d’un athlète iranienne pour son droit à la liberté, tant pour conquérir un titre mondial que pour le respect dû à une femme libre et indépendante. Dans un film qui ne laisse pas le spectateur souffler une seconde, le duo de cinéastes (Zar Emir Ebrahimi incarne aussi le personnage de Maryam, la coach déchirée entre le respect des règles et une évidente soif de liberté) montre comment, autour d’une compétition sportive de haut niveau, le régime iranien, tétanisé à l’idée que Leila Hosseini (l’excellente Arienne Mandi connue pour le rôle de Dani Núñez dans la série The L Word: Generation Q) puisse être battue par une compétitrice israélienne, va mettre en œuvre une véritable machination usant de moyens illicites. Tandis que deux officielles de la Fédération internationale tout comme des journalistes sportifs remarquent que quelque chose cloche, Leila Hosseini, le corps indompté mais meurtri, demeure déterminée dans son choix. Mais, à Téhéran, la police vient arrêter les membres de sa famille… Un film courageux et captivant sur deux femmes en lutte. (Metropolitan)
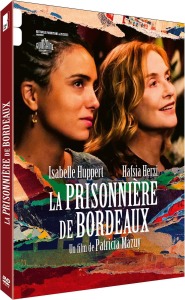 LA PRISONNIERE DE BORDEAUX
LA PRISONNIERE DE BORDEAUX
Grande bourgeoise de province, Alma, la bonne cinquantaine, attend, dans les locaux d’un centre pénitentiaire, de pouvoir se rendre au parloir pour voir son mari incarcéré. Elle remarque une jeune femme, Mina, qui peste parce que les surveillants ne veulent pas lui donner accès au parloir. Las, la femme s’est trompée de jour. Alma propose de l’héberger pour la nuit dans sa vaste maison en ville. Rapidement, les deux femmes s’engagent dans une amitié aussi improbable que tumultueuse… La réalisatrice Patricia Mazuy a souvent donné, dans ses œuvres, de beaux personnages de femmes. C’est encore le cas, ici, où, 25 ans après Saint-Cyr (1999), elle retrouve Isabelle Huppert qui incarnait, alors, Madame de Maintenon. L’actrice incarne Alma, femme fantasque et parfois déroutante qui semble s’accommoder plutôt bien de l’incarcération de son mari. Autant par jeu que par compassion, elle va faire entrer Mina dans une nouvelle existence. La cinéaste observe comment ces deux femmes ont organisé leur vie autour de l’absence de leurs deux maris détenus au même endroit… Tout en montrant l’univers carcéral avec les maisons d’accueil, les parloirs mais aussi l’attente, les femmes entre elles, la cinéaste s’attache à détailler comment Alma et Mina vont devenir poreuses l’une à l’autre. L’arrivée de la seconde dans la grande maison et dans la vie solitaire de la première catalyse chez Alma la conscience de sa vie misérable dans les dorures et les fleurs. « Métaphore renversée de l’amour, dit la réalisatrice, les dames dehors, les maris en prison. » Avec parfois une allure de comédie italienne pour les « délires » d’Alma, La prisonnière de Bordeaux présente cependant quelques coups de moins bien dans son scénario. Mais tout cela est gommé par le brio de l’interprétation d’Isabelle Huppert qui joue à la perfection la dépression, l’appartenance de classe, l’idée fixe, l’absence ou la folie. Avec sa Mina, Hafsia Herzi (qui venait de croiser Huppert dans Les gens d’à côté de Téchiné) se hisse sans peine à sa hauteur dans un mélange d’amitié, de complicité et d’alliance d’occasion. (Blaq Out)
 LANGUE ÉTRANGÈRE
LANGUE ÉTRANGÈRE
Sur le quai de la gare de Leipzig, Fanny, 17 ans, est venue retrouver Léna, sa correspondante allemande pour un séjour linguistique. La première n’ose pas trop parler allemand et la seconde est trop stressée à l’idée de parler français. Heureusement, Susanne, la mère de Léna, maîtrise bien le français, pour avoir vécu quelques années dans le sud de la France… Au fil des premières journées, alors qu’elles se retrouvent régulièrement dans le jacuzzi familial, les deux grandes adolescentes finiront par aller doucement l’une vers l’autre, se découvrant mutuellement et trouvant ensemble un terrain d’entente sentimentalo-sexuel… Fanny embarque aussi la jeune Allemande dans des histoires qui l’impressionnent, ainsi lorsqu’elle lui explique qu’elle a une demi-sœur qu’elle n’a jamais rencontrée et qui milite au sein des black blocs… Découverte avec Party Girl (Caméra d’or à Cannes 2014) co-réalisé avec Marie Amachoukeli et Samuel Theis, Claire Burger dresse un portrait d’une jeunesse européenne. Avec la volonté de faire, moitié à Leipzig, moitié à Strasbourg, un film lumineux qui privilégie un mouvement fluide, Claire Burger réussit à montrer deux jeunes filles à la fois anxieuses et politiquement engagées. Sans jamais lâcher ses deux personnages principaux (Lilith Grasmug incarne Fanny et Josefa Heinsius est Léna), la cinéaste évoque des questions comme les changements de repères et d’idéologies qui ont fait suite à la chute du Mur ou encore, pour les jeunes, des convictions politiques qui passent dorénavant beaucoup par la radicalité. Dans cette mise en perspective de jeunes qui veulent s’incarner politiquement mais qui se sentent un peu impuissants et fantasment la question du politique sans nécessairement rentrer dans un groupe,la réalisatrice laisse une place intéressante aux adultes. Spécialement à deux mères (Nina Hoss et Chiara Mastroianni), encore fortes mais un peu larguées et presque dépressives qui ont été pleine d’espoirs et d’idéaux avant de se faire rattraper et miner par le quotidien matériel, la réalité. (Ad Vitam)
 BEETLEJUICE BEETLEJUICE
BEETLEJUICE BEETLEJUICE
Après une terrible tragédie, la famille Deetz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail menant à l’Après-vie. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne prononce trois fois le nom de Beetlejuice et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille… C’est en 1988 que Tim Burton arrive sur le devant de la scène avec son second long-métrage qui sera un grand succès commercial et critique. Racontant l’histoire Adam et Barbara Maitland, deux jeunes mariés, récemment décédés, qui, devenus des fantômes, viennent hanter leur ancienne maison et font appel à un « bio-exorciste » pour faire fuir ses nouveaux occupants, Beetlejuice (qui gagnera l’Oscar du meilleur maquillage) lancera définitivement la carrière de Michael Keaton dans le rôle de Beetlejuice et révèlera Winona Ryder au grand public. Plus de 35 ans après, Tim Burton, devenu un grand d’Hollywood avec des films comme Ed Wood (1994), Sleepy Hollow (1999), Big Fish (2003), Charlie et la chocolaterie (2005) et évidemment le remarquable Edward aux mains d’argent (1990) remet le couvert avec ce nouveau Beetlejuice qui n’était probablement pas nécessaire mais avec lequel Burton semble prendre un malin plaisir dans le registre horrifique-comique. Tim Burton, que certains auraient voulu enterrer lorsqu’il est allé s’acoquiner avec Disney (Dumbo en 2019), n’a pas perdu la main. Il s’amuse à multiplier les gags mais aussi les clins d’oeil en jouant sur ses propres références. Quant à Michael Keaton, Winona Ryder et Catherine O’Hara, qui étaient de l’aventure de 1988, ils sont de retour ici et prennent, manifestement, plaisir à réveiller le bon Beetlejuice. Après tout, il suffit de prononcer trois fois son nom pour que… (Warner)
 RUE DU CONSERVATOIRE
RUE DU CONSERVATOIRE
« En 1996, j’ai passé le concours du conservatoire. Je l’ai raté. Il y a un an on m’a demandé d’y faire une masterclass sur le jeu d’acteur au cinéma. J’y suis allée. J’ai rencontré une jeunesse vivante, joyeuse et passionnée. Parmi mes élèves, il y avait Clémence. L’année d’après, elle m’a demandé de filmer leur dernier spectacle. J’ai ressenti son urgence et la peur qu’elle avait de quitter ce lieu mythique. Alors j’ai accepté. En filmant cette jeunesse, j’ai revisité la mienne. » C’est Valérie Donzelli qui évoque ainsi la genèse de son documentaire consacré, à travers la dernière année d’une promo du conservatoire, au portrait de l’une de ses jeunes recrues. La réalisatrice de La reine des pommes (2009), Marguerite et Julien (2015), L’amour et les forêts (2023) et bien sûr de l’admirable La guerre est déclarée en 2010, a raté deux fois le conservatoire. Ironie du sort, elle y retourne trente ans plus tard. A l’occasion d’une master class, elle rencontre Clémence Coullon, comédienne et apprentie metteuse en scène sur le point de (re)monter Hamlet de Shakespeare et soucieuse de garder une trace de cette dernière année de conservatoire. En s’appuyant sur le tournage du court-métrage, Valérie Donzelli se fait le témoin de la vie collective des jeunes comédiens, de leur travail, de leur ardeur, de leurs belles aspirations et aussi du cheminement intime de la création. Est-ce qu’à travers Clémence Coullon qu’on’a vu dans la saison 2 de la série d’Arte En thérapie), Valérie Donzelli observe son propre parcours ? La question mérite évidemment d’être posée. On pense évidemment aussi au travail sur la création menée par Valeria Bruni-Tedeschi dans le récent Les amandiers. En tout cas, la cinéaste nous offre, dans une approche sensible, une belle et riche galerie d’actrices et d’acteurs. Une plongée dans le quotidien des élèves du prestigieux Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris qui est aussi une ode à la jeunesse et à la transmission intergénérationnelle dans le milieu du théâtre. (Diaphana)
 LES BARBARES
LES BARBARES
À Paimpont, en Bretagne, la communauté villageoise, menée par son maire, prépare l’accueil d’une famille de réfugiés ukrainiens. Toutefois la personne à l’origine de ce projet doit bientôt expliquer à l’édile qu’en raison de la « pénurie » d’Ukrainiens parmi les réfugiés, la préfecture a pris sur elle de leur envoyer une famille originaire de Syrie. Rapidement, face aux demandeurs d’asile syriens, tous les préjugés et les idées préconçues resurgissent. Dans ce qui est déjà son huitième long-métrage en tant que réalisatrice, Julie Delpy pose une question simple mais brûlante : qui sont les barbares ? Pour traiter cette histoire sur le vivre-ensemble, elle choisit le ton de la comédie sociale, une spécialité bien française. « Bien que nous soyons sur le ton de la comédie, je voulais que tout ce qui se passe dans le film s’appuie sur la réalité. (…). Les Barbares est un film choral où chaque personnage devait exister au-delà de l’image qu’il renvoie de prime abord, chacun possédant une fantaisie plus ou moins secrète. Dans cette histoire les personnages sont très nombreux, réussir à les faire coexister sur le papier a été un travail de longue haleine. » Tourné notamment dans les beaux paysages de la forêt de Brocéliande, le film ne surprend guère malgré tout l’engagement et la bonne volonté de Julie Delpy pour mettre à mal les idées reçues et pointer du doigt les défaillances individuelles autant que collectives face à un sujet, on le sait, très clivant. Si on rit pas aux éclats, l’humour sur les braves gens de la campagne profonde nous arrache des sourires, d’autant que ces clichés sur la ruralité sont illustrés par des comédiens en verve. Outre Julie Delpy elle-même, on croise, ici, Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, India Hair, Mathieu Demy, Ziad Bakri, Albert Delpy ou Brigitte Roüan. Du beau monde ! (Le Pacte)
 ANZU CHAT FANTOME
ANZU CHAT FANTOME
Karin, 11 ans, arrive chez son grand-père, moine dans une petite ville côtière du Japon. Son père, immature, qui est venu demander de l’aide financière au vieil homme, a décidé de lui confier sa fille. Le moine demande alors à son chat Anzu, doué de la parole, de prendre soin de la fillette. Celle-ci va demander au curieux greffier de la conduire à Tokyo sur la tombe de sa mère, disparue trois années plus tôt. Présenté notamment au festival d’Annecy et à la Quinzaine des cinéastes à Cannes 2024, Anzu chat fantôme est l’adaptation d’un manga de Takashi Imashiro dans le cadre d’une collaboration franco-japonaise entre les studios Myu Productions (connus pour Linda veut du poulet) et Shin-Ei Animation. Utilisant la technique de la rotoscopie, le film a été tourné en prises de vue réelles par Nobuhiro Yamashita, pour mieux capturer mouvements et expressions de vrais acteurs, avant d’être ensuite retravaillé en animation par Yoko Kuno. Anzu est certainement, à ce jour, le chat le plus cool du cinéma d’animation nippon. Pour être un esprit (à ce titre, il ne peut mourir), Anzu n’en est pas moins un joyeux drille. Il roule en scooter sans permis, ne quitte jamais son téléphone portable, ne s’embarrasse pas de pisser n’importe où, pète sans vergogne, aime boire des coups, jouer aux machines à sous, dispenser des massages à ses voisins et ne déteste pas en griller une. C’est ce chat joyeusement goguenard et… si humain qui va prendre sous son aile, la petite Karin pour lui permettre de s’éloigner d’une certaine fatalité, de faire le deuil de sa mère et de dire un peu adieu à son enfance. Voici, avec des personnages aux traits épurés et une belle richesse graphique, un beau voyage initiatique à la fois fantastique et déjanté. (Diaphana)
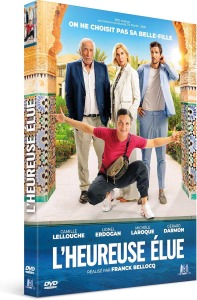 L’HEUREUSE ÉLUE
L’HEUREUSE ÉLUE
Parfait jean-foutre et rejeton de riches bourgeois, Benoît est, cette fois, vraiment mal barré. S’il a souvent monté des affaires foireuses, cette fois, il se retrouve, ligoté dans un local des pompes funèbres par des malfrats qui se proposent de l’incinérer s’il se rembourse pas ses dettes dans les trois jours. Evidemment, Benoît n’a pas le premier sou des 100 000 euros qu’il doit. Acculé, il appelle sa mère, qui vit à Marrakech, espérant lui soutirer de l’argent. À court d’idées, il lui annonce son mariage avec une mannequin. Planté par la copine qui devait faire office de mariée, il finit par se rabattre sur Fiona, la conductrice de Uber, qui doit l’amener à l’aéroport. Evidemment, Benoît propose de rémunérer Fiona… Connu comme l’interprète du journaliste Franky Ki dans les émissions Groland sur Canal+, Frank Bellocq signe, ici, son second long-métrage comme réalisateur et donne une comédie gentiment déjantée. Evidemment, on ne nous demande pas de croire à cette histoire de mariage organisé en deux temps trois mouvements mais bien de goûter une suite de gags souvent enlevés. D’emblée, la « négo » sur la rémunération de Fiona donne le ton. Et puis Bellocq apporte un soin particulier à ce personnage issu de la banlieue (elle donne du « frérot » ou du « cousin » à volonté) qui rêve d’avoir son salon de coiffure. En attendant, complètement brute de décoffrage, Fiona débarque dans un palace marocain de luxe et sème une certaine tempête sur son passage… Gérard Darmon et Michèle Laroque jouent les parents de Benoît (Lionel Erdogan) mais c’est évidemment l’actrice et humoriste Camille Lellouche qui tient la baraque avec sa Fiona en complet lâcher-prise. Il faut voir comment elle met au pas les insupportables neveux de Benoît ou encore comment elle offre une séance d’épilation assez hot à sa future « belle mère »… Un buddy movie plutôt enlevé. (M6)
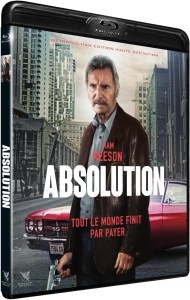 ABSOLUTION
ABSOLUTION
Un homme vieillissant travaillant pour le mafieux Charlie Conner (l’excellent Ron Perlman dans un petit rôle) découvre qu’il souffre d’une encéphalopathie traumatique chronique, une maladie neuro-évolutive liée à son passé de boxeur. Sachant qu’il ne lui reste que peu de temps à vivre, il tente d’oublier son passé criminel et de renouer avec sa fille Daisy, qu’il n’a pas vue depuis des années et de rencontrer son petit-fils. Le tueur à gages va par ailleurs devoir affronter plusieurs gangsters d’un clan mafieux adverse. Ah, il en aura joué de ténébreux agents secrets malmenés (la série Taken) et des hommes d’action auxquels il convenait de ne pas venir se frotter, le cher Liam Neeson ! Mais reconnaissons aussi que le comédien nord-irlandais, aujourd’hui âgé de 72 ans, a aussi participé à des films de qualité, qu’il s’agisse de Michael Collins (1996), l’admirable Liste de Schindler (1993), Love Actually (2003) sans oublier, évidemment, Star Wars, épisode 1 : La menace fantôme (1999). Si Neeson a annoncé vouloir prendre sa retraite des films d’action, le voilà donc encore dans une histoire de tueur sans nom, malade et fatigué, qui entend boucler, avec élégance et humanité, la boucle auprès des siens. Le comédien retrouve, ici, le réalisateur norvégien Hans Petter Moland qui l’avait dirigé, en 2019, dans Sang froid, un film d’action où il incarnait un conducteur de chasse-neige bouleversé par la mort de son fils, emporté par une overdose… Ici, son personnage, en quête de rédemption, se pose bien des questions et n’a plus beaucoup à faire. (Metropolitan)
 A L’ANCIENNE
A L’ANCIENNE
Jean-Jean et Henri, deux amis de toujours vivent sur une petite ile de Bretagne. Lorsqu’ils découvrent que l’un des habitants a gagné le gros lot à la loterie nationale, les deux vieilles canailles se mettent à la recherche du mystérieux gagnant afin de s’assurer ses faveurs avant que la nouvelle ne se répande. Mais lorsqu’ils apprennent que ce dernier est mort, ticket gagnant en main, ils décident d’organiser avec la complicité de tout le village une grande arnaque au loto pour prendre sa place… Révélé comme réalisateur avec Tout ce qui brille (2010) puis remarqué avec Un homme pressé (2018) où Fabrice Luchini incarnait un PDG antipathique qui s’humanise après un AVC, Hervé Mimran signe, ici, une comédie d’escroquerie qui permet à Gérard Darmon et à Didier Bourdon de composer un duo comique et de s’amuser avec deux personnages de crapules… sympathiques. Mais le scénario ne tient pas vraiment la route et la réalisation est plutôt poussive. Si ce film, qui traite d’une certaine manière de la désertification rurale, est une adaptation de Waking Ned Devine (Vieilles canailles en v.f.) un film irlando-anglais de 1998, il n’arrive pas vraiment à reproduire l’habituelle efficacité de la comédie britannique. Reste alors, pour les amateurs, les pitreries du tandem Darmon-Bourdon. (Studiocanal)
DANS D’IMPRESSIONNANTS MAIS TRAGIQUES COMBATS… 
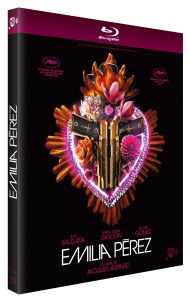 EMILIA PEREZ
EMILIA PEREZ
Jeune avocate à la fois surqualifiée et surexploitée, Rita Moro-Castro est au bout du rouleau. Tel un prologue shakespearien, s’adressant à un auditoire imaginaire (et donc au spectateur), Rita, écoeurée devant la bouffonnerie de ses patrons, interroge: De quoi parlons-nous? S’élever? Se soumettre? Combien de temps encore, faudra-t-il baisser la tête? De galère, la vie de l’avocate mexicaine va, par un simple coup de fil, devenir odyssée. Une voix grave et douce, un rendez-vous devant un kiosque à journaux, un enlèvement sac sur la tête. Celui qui l’attend dans sa cachette défendue par une armée de nervis, se nomme Manitas del Monte. Il est le patron redoutable et redouté d’un des cartels de la drogue au Mexique. Rita tombe des nues quand cette brute douce à la voix d’ange lui dit qu’il veut devenir une femme, être celle qu’il a toujours secrètement rêvé et voulu être. Une proposition simplement impossible à refuser. Car le chef de cartel veut se retirer des affaires et disparaître à jamais. Il donne carte blanche et moyens illimités à Rita pour mettre en oeuvre cette transition. En présentant Emilia Perez en compétition à Cannes, Jacques Audiard a donné un chef- d’œuvre, à la fois film de cartel et comédie musicale extraordinaire sur le féminin et la transidentité. Avec, à la clé, le prix du jury et le prix d’interprétation pour l’ensemble des femmes du film. Depuis Emilia Perez est favori, avec dix nominations, pour les Golden Globe de janvier prochain et en lice aux Oscars parmi les meilleurs films internationaux. Avec Emilia Perez, Jacques Audiard se sert des cartels comme d’une toile de fond (omniprésente!) qui lui permet d’aborder des thèmes qui traversent toute sa filmographie: d’une part, la paternité, de l’autre la transmission de la violence. Là où le dixième long-métrage d’Audiard fascine, c’est qu’il réussit, avec aisance et une impressionnante force de conviction, à mêler le thriller, le noir, la comédie de moeurs, le musical, la télénovela et même le pur mélodrame au travers d’un opéra guerrier et bouleversant, le tout dans une langue -l’espagnol- très forte, très physique, à la musicalité très accentuée. Ce film « sur des gens qui, emprisonnés dans des situations impossibles, conçoivent pour en sortir des solutions impossibles » séduit par son incessant mouvement, ses temps suspendus (« Tante » Emilia avec son jeune fils qui se souvient de l’odeur de son père), par une dynamique reposant sur des dialogues chantés dans des séquences brillamment chorégraphiées et, évidemment, par quatre comédiennes qui apportent une formidable énergie à ce qui apparaît vite comme une magnifique réflexion sur le pouvoir des femmes à changer le monde! Rita est incarnée avec grâce, âprêté et courage par Zoé Saldana. Selena Gomez est Jessi qui fut la femme de Manitas et la mère de ses deux enfants. Epifania (Adriana Paz) représente une parenthèse enchantée puisqu’elle apporte son amour à Emilia… Enfin, il y a l’époustouflante Karla Sofia Gascon qui incarne Manitas et Emilia. Fine, rapide, inventive et talentueuse, la comédienne s’empare avec brio d’une femme qui décide de faire de sa nouvelle vie une oeuvre vertueuse. Avant que la violence, une nouvelle fois, la rattrape… (Pathé)
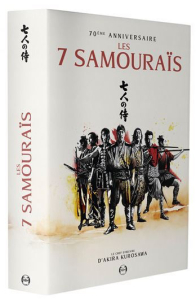 LES SEPT SAMOURAIS
LES SEPT SAMOURAIS
En 1586, à l’époque Sengoku, dans un Japon médiéval ravagé par des guerres civiles, les paysans sont fréquemment opprimés par des brigands qui les rançonnent. Une troupe de bandits à cheval s’apprête ainsi à attaquer un village mais décide de reporter l’attaque en attendant la prochaine récolte. Yohei, un des paysans, a surpris la discussion et court aussitôt avertir les autres villageois. Ces derniers sont effondrés, à l’exception de Rikichi, qui essaie de trouver une solution. Ils finissent par consulter Gisaku, l’ancien du village, qui, à la surprise de tous, rejoint l’avis de Rikichi et conseille d’engager des samouraïs pour défendre le village… Des émissaires partent donc vers le bourg voisin pour recruter des samouraïs. Réalisé par le Japonais Akira Kurosawa et sorti en 1954, Les sept samouraïs a largement contribué à la renommée internationale de son auteur, bien plus encore que Rashōmon sorti quatre ans plus tôt. A l’occasion du 70eanniversaire du film, Les sept samouraïs, inédit en Blu-ray 4K en France, est présenté en version intégrale d’origine, restauré par la célèbre société de production Toho. Cette version intégrale (3h20) transforme le simple film d’action en épopée subtile en montrant les rapports complexes entre de pauvres paysans empêtrés dans leurs préjugés et des guerriers de métier. Sans doute, le plus célèbre au monde des films japonais, Les sept samouraïs est une référence en matière de film de samouraïs et parfois considéré comme l’un des meilleurs films d’action de l’histoire du cinéma. Il n’a cessé d’exercer une grande influence sur le cinéma mondial et a connu plusieurs adaptations plus ou moins libres, dont le western américain Les sept mercenaires (1960) de John Sturges. Kurosawa ose construire son récit à l’encontre du suspens. On sait dès la troisième phrase tout ce qu’il va se passer, place au spectacle pur. Plus d’histoire à proprement parler, c’est désormais le regard qui règnera en maître. Comme les assiégés dans l’attente de l’attaque, le spectateur doit décoder les gestes et les regards pour s’approcher de tous les secrets que les personnages tentent de surmonter en les taisant. Le cinéaste fait preuve d’une maîtrise exceptionnelle en distillant une suite de petites histoires et en organisant autant des batailles réglées comme des ballets de fins portraits psychologiques. Et ce sont les humbles et les faibles qui sortent vainqueurs de l’aventure, plus que les guerriers et les « méchants » voués à la mort. Ce coffret anniversaire prestige contient deux heures de bonus dont le documentaire It is wonderful to create produit par la Toho et la BBC, inédit en France. Par ailleurs, on trouve un livre (336 pages) contenant des textes et analyses de Fabrice Arduini (programmateur de La Maison du Japon), des archives inédites, notamment des extraits des notes de Kurosawa pendant le tournage du film et de rares photos de tournage ainsi qu’une retranscription intégrale du film, issu du montage européen d’époque. La retranscription consiste en une forme hybride entre le script de tournage, le découpage technique et l’analyse de montage. Elle met en lumière la mise en scène et le travail rythmique de Kurosawa, à mettre en perspective avec le film. (The Jokers)
 1984
1984
Le monde de 1984 est divisé en trois grandes puissances qui se livrent une guerre perpétuelle. L’une d’elles, Océania, est dirigée par un parti unique et soumise à un régime totalitaire, personnifié par Big Brother, dont le portrait est omniprésent. Employé au Ministère de la Vérité, Winston Smith a de plus en plus de mal à croire aux mensonges du régime… À l’heure où la montée des extrêmes en Europe inquiète, la dystopie imaginée dès 1949 par George Orwell dans 1984, son fameux roman d’anticipation, semble plus que jamais d’actualité. On y découvre en effet une société totalitaire, de contrôle et d’oppression permanents. Alors que la télévision n’existait pas encore, l’auteur visionnaire inventait le célèbre concept de Big Brother, une entité qui surveille tout le monde via des écrans disposés chez chaque individu. C’est aussi dans ce roman qu’apparait la Novlangue, qui désigne aujourd’hui un langage destiné à déformer une réalité. Fidèle au livre, le Britannique Michael Radford donne une adaptation des plus marquantes. Tournée à Londres, sa sortie en 1984 est hautement symbolique, à une période où la guerre froide touchait à sa fin. Le réalisateur crée dans son film un univers glaçant, gris et déshumanisé, à l’atmosphère angoissante et désespérée très réussie. En refusant le spectaculaire pour se concentrer sur le message d’Orwell, le cinéaste réussit un film magistral où l’horreur est avant tout psychologique. Si l’adaptation est réussie (le film sera récompensé dans de nombreux festivals ) ce n’est pas uniquement grâce au travail minutieux de son réalisateur, mais aussi grâce à la performance impeccable de son casting, en particulier le trio principal. La composition de John Hurt, alors au sommet de sa carrière, est d’une incroyable sincérité tandis que Suzanna Hamilton est remarquable. De son côté, Richard Burton est terrifiant, offrant une prestation glaçante de cynisme et d’inhumanité pour son dernier rôle au cinéma. L’acteur meurt en effet peu après le tournage… en 1984. Plongée terrifiante dans les méandres du totalitarisme, et impressionnante adaptation d’un monument de la littérature d’anticipation, 1984 sort pour la première fois dans une version entièrement restaurée en 4K. Proposé dans un combo Blu-ray + UHD, ainsi qu’en édition DVD, le film est accompagné de nombreux bonus, dont un entretien (35 mn) exceptionnel et inédit avec Michael Radford et Retour en 1984 (24’), un documentaire d’Alexandre Jousse.. Le combo sera également enrichi d’un livret de 40 pages sur George Orwell et 1984. (Rimini éditions)
 JOHNNY S’EN VA-T-EN GUERRE
JOHNNY S’EN VA-T-EN GUERRE
Jeune Américain plein d’enthousiasme, Joe Bonham décide de s’engager pour aller combattre sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Au cours d’une mission de reconnaissance, il est grièvement blessé par un obus et perd la parole, la vue, l’ouïe et l’odorat. On lui ampute ensuite les quatre membres alors qu’on croit qu’il n’est plus conscient. Allongé sur son lit d’hôpital, il se remémore son passé et essaie de deviner le monde qui l’entoure à l’aide de la seule possibilité qui lui reste : la sensibilité de sa peau. Une infirmière particulièrement dévouée l’aide à retrouver un lien avec le monde extérieur. Lorsque le personnel médical comprend que son âme et son être sont intacts sous ce corps en apparence inerte, ils doivent prendre une décision médicale selon les valeurs et les croyances de l’époque. Dalton Trumbo adapte ici lui-même son roman antimilitariste Johnny Got His Gun publié en 1939. L’auteur pensait initialement confier la réalisation du film à son ami cinéaste Luis Buñuel et avait également demandé à Salvador Dalí d’adapter son œuvre. Mais les deux hommes refusent car ils estiment que l’œuvre appartient à Dalton Trumbo et que seul lui peut la transposer à l’écran. Luis Buñuel participe cependant de manière non officielle au script, notamment pour les scènes avec le Christ. En 1971, le film marque ainsi les débuts de Dalton Trumbo comme réalisateur, lui qui avait été l’une des plus célèbres victimes de la chasse aux sorcières du maccarthysme. Le résultat est saisissant. Ce brûlot contre l’abjection guerrière est porté par le formidable Timothy Bottoms qui apporte à ce « légume » parqué sous un drap-linceul dans une obscure chambre d’hôpital, un bouleversante humanité. Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 1971, Johnny s’en va-t-en guerre (qui sort dans une belle version Blu-ray) obtint le grand prix spécial du Jury. (Gaumont)
 COFFRET FERNANDEL
COFFRET FERNANDEL
Champion du box-office (on dit qu’il a attiré plus de 200 millions de spectateurs dans les salles obscures), Fernand Contandin dit Fernandel (1903-1971) fut le comique emblématique du cinéma français d’avant et d’après la Seconde Guerre mondiale, jouant dans nombre de films devenus des classiques, notamment signés Marcel Pagnol. On retrouve ce monument du cinéma national dans un coffret regroupant trois de ses films réalisés au tournant des années cinquante et nouvellement restaurés. Signé Carlo Rim, L’armoire volante (1948) raconte les aventures d’une octogénaire têtue qui part pour Clermont-Ferrand avec deux déménageurs afin de rapporter à Paris ses quelques meubles. Son neveu, Alfred Puc, percepteur de son état, est très inquiet. Il est vrai qu’il fait très froid et qu’au retour, la brave dame meurt de froid. Affolés, les déménageurs laissent le corps dans une armoire à glace, regagnent Paris en avertissant le neveu… Avec cette farce loufoque qui surprit le public par son côté grinçant et sombre, pas assez « fernandelesque » en somme, Rim signe son premier film et réussit à convaincre Fernandel de s’éloigner de ses indéfectibles rôles « provençaux » en observant : « L’armoire volante ne sera drôle que s’il est joué comme un drame ». Dans L’héroïque Monsieur Boniface (1949), Fernandel est Boniface, un timide étalagiste qui trouve un soir en rentrant chez lui un cadavre dans son lit. Enlevé à sa sortie du commissariat par le véritable assassin, Charlie, un chef de bande, Boniface se retrouve libre et héros du jour au lendemain. Adulé, fêté et reconnu, Boniface commence sérieusement à gêner Charlie, qui décide de séduire sa petite amie, Irène. L’affront donnera à l’honnête Boniface la force d’accomplir cette fois, un audacieux coup de maître qui mettra fin à la bande de gangsters. Le cinéaste Maurice Labro mêle ici le comique burlesque avec l’humour noir et insuffle au film un rythme presque constamment heureux. A sa sortie, le film connut un beau succès avec plus de 3,2 millions de spectateurs. Ce qui permit au personnage de Boniface de connaître de nouvelles aventures lors d’un second film avec la même équipe, l’année suivante. Dans Boniface somnambule, notre homme est devenu un irréprochable détective privé aux magasins Berthès et spécialement au rayon bijouterie, Mais Victor Boniface est somnambule. Ce qui l’amène à dérober la nuit ce qu’il surveille si brillamment le jour. Ce travers va le conduire à faire arrêter héroïquement trois gangsters : Charlie, René et leur complice, qui avaient pour projet de profiter de sa condition nocturne. Mlle Thomas, la sous-directrice de la bijouterie lui confiera son cœur et deviendra la mère de ses nombreux enfants qui seront, eux aussi, somnambules. Dans un scénario bien huilé, Maurice Labro présente les personnages dans de nouvelles situations rocambolesques où Boniface retrouve les malfaiteurs du film précédent qui souhaitent désormais prendre leur revanche après leur déconfiture lors du premier épisode. Sans plus de réussite, évidemment ! (Pathé)
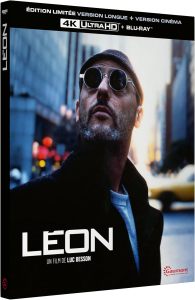 LEON
LEON
Tueur à gages solitaire, Léon vit à New York depuis au moins une dizaine d’années. Ce type froid et méticuleux est particulièrement méthodique dans son travail. Ses contrats viennent uniquement de Tony, un mafieux propriétaire du restaurant « Supreme Macaroni ». Léon habite le même quartier que son donneur d’ordres dans un immeuble vétuste de Little Italy, au bout d’un long couloir. Léon occupe son temps libre en faisant des exercices physiques, en prenant soin de sa plante d’intérieur et en allant voir des comédies musicales de Gene Kelly dans un cinéma de quartier. Lorsque Léon croise, en rentrant chez lui, Mathilda, une adolescente en train de fumer, il lui fait savoir qu’il réprouve son tabagisme. Il comprend qu’elle est livrée à elle-même, qu’elle est mal-aimée dans une famille distendue et recomposée. Un jour, Léon remarque que la gamine saigne du nez. Mathilda lui demande si la vie est aussi dure uniquement pour les enfants ou si c’est comme ça pour toute la vie. Il lui répond avec aigreur : « C’est comme ça tout le temps ». En 1994, Luc Besson signe son sixième long métrage et se penche sur la rencontre entre Léon et une voisine de palier âgée de 12 ans dont la famille va être assassinée à cause des trafics du père. Pour venger son petit frère, le seul membre de sa famille qu’elle aimait sincèrement, Mathilda implore Léon de lui apprendre son « métier ». Besson s’est inspiré de Jeff Costello, le tueur à gages (Alain Delon) du Samouraï de Melville pour créer Léon avec lequel Jean Reno trouve un rôle similaire à celui qu’il tenait dans Nikita (1990). Ce bon film d’action marque la première apparition à l’écran de Natalie Portman, 12 ans, dans le rôle de Mathilda. Autour de Reno et d’elle, on remarque Gary Oldman et Danny Aiello. Le film qui avait réuni près de 3,5 millions de spectateurs dans les salles, sort dans une édition limitée 4K Ultra-HD. (Gaumont)
 LES GUERRIERS DE L’APOCALYPSE
LES GUERRIERS DE L’APOCALYPSE
Une unité des Forces japonaises d’auto-défense, en manœuvre à proximité d’une plage, se retrouve mystérieusement transportée quatre cents ans dans le passé à la suite de la déformation de l’espace temps. Équipés d’un char de combat, d’une jeep, d’un hélicoptère et d’un patrouilleur en plus de leur armement individuel, le lieutenant Iba et ses hommes sont entraînés dans les guerres de clans qui déchirent le Japon féodal du XVIe siècle. Les voilà bientôt tiraillés entre l’envie de regagner le pays qu’ils connaissent et celle de changer le cours de l’Histoire… Disponible pour la première fois en 4K UHD et Blu-ray dans une version restaurée et dans son montage intégral (139 mn), voici un étonnant film devenu culte qui réunit le meilleur du film de samouraï, de la science-fiction et du cinéma d’action nippon dans une confrontation spectaculaire entre passé et présent. Réalisé en 1979 par Kosei Saito, le film met en vedette, devant et derrière la caméra (il est en charge de la réalisation des scènes de combats), la star japonaise Sonny Chiba (The Street Fighter, Kill Bill : Volume 1) dans le rôle d’Iba, un officier progressivement gagné par une folie destructrice alors qu’il s’interroge sur sa vocation de guerrier plus à l’aise dans l’époque féodale. Ses hommes, moins enclins à la guerre, seraient prêts à retourner dans leur époque mais, par obéissance à Iba, ils resteront à ses côtés. Saito montre comment apparaissent les frictions au sein du détachement et aussi comment elles sont rapidement réglées dans le sang. Puis comment les hommes d’Iba vont s’allier avec un seigneur de la guerre. Mais surtout il signe un grand moment de cinéma avec, pendant une bonne demi-heure, la bataille entre le commando et toute une armée féodale. Pour cela, le cinéaste, connu pour Ninja Wars en 1982, dispose de moyens considérables avec des effets spéciaux remarquables, une abondante figuration, des costumes de qualité qui lui permettent de signer un grand spectacle. Dans les suppléments, on trouve Les grandes manœuvres (28 mn), un entretien avec Fabien Mauro, spécialiste des fictions japonaises à effets spéciaux (tokusatsu) et auteur de Kaiju, envahisseurs & apocalypse : L’Âge d’or de la science-fiction japonaise (Aardvark Éditions, 2020). « Ce qui est au cœur du récit, c’est la fonction des Forces japonaises d’auto-défense et de l’éthique des soldats. […] Ils vont aller à l’encontre de leurs fondamentaux pour se lâcher et se libérer dans ce Japon de l’ère Sengoku qui est propice au combat. » et aussi la version française (109 mn) des Guerriers de l’apocalypse, le film tel qu’il fut diffusé en salles lors de son exploitation en France en 1982. (Carlotta)
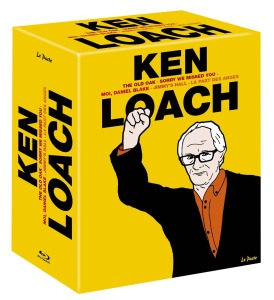 COFFRET KEN LOACH
COFFRET KEN LOACH
Dans le cinéma britannique, Ken Loach, du haut de ses 88 ans, fait figure de vénérable patriarche. Mais cette impression est contredite par un cinéma dynamique constamment ancré dans le réalisme social et qui traite souvent des situations difficiles au sein de la classe ouvrière. Loach, découvert avec Kes en 1969, est un maître qui sait associer la réalité quotidienne avec un récit plein de souffle, créant un lien d’empathie immédiat avec ses personnages. Un beau coffret réunit cinq films marquants de Loach dont le plus récent, The Old Oak (2023) dans lequel il décrit une petite localité du nord-est du Royaume-Uni divisée par l’arrivée de réfugiés syriens. TJ Ballantyne, propriétaire du pub The Old Oak (le vieux chêne) se montre plutôt bienveillant à leur égard, aidant la jeune Yara, passionnée de photographie. Avec Sorry We Missed You (2019), le cinéaste dénonce les dérives de l’«uberisation», et les ravages qu’elles peuvent exercer sur la vie d’une famille. Ricky devient chauffeur-livreur indépendant, aux ordres sans concessions d’une plateforme de vente en ligne. L’achat du véhicule et tous les frais imprévus sont à sa charge, les rendements exigés sont oppressants, les pénalités financières implacables. Son épouse Abby, auxiliaire de vie, se débat elle aussi dans des horaires à rallonge. Ils n’ont plus le temps de s’occuper de leurs enfants, ce qui va conduire au désastre… Couronné de la Palme d’or à Cannes 2016 (la seconde pour Loach après Le vent se lève en 2006), Moi Daniel Blake évoque, dans le Royaume-Uni des années 2010, le délabrement des services sociaux. Daniel Blake, un homme de 59 ans souffrant de graves problèmes cardiaques, et Katie Morgan, une mère célibataire de deux enfants, malmenés par l’administration, tentent de s’entraider. Pour Jimmy’s Hall (2014), Loach, en s’inspirant de faits réels, parle de l’Irlande des années 20 et 30 à travers le parcours de l’activiste républicain James Gralton, qui après dix années passées aux USA, revient dans sa terre natale et ouvre, en pleine campagne, une salle de danse qui est aussi un lieu d’enseignement, d’échange et de culture. Cette initiative lui attire les foudres de l’Église catholique et des conservateurs. En 2012, Loach fait un détour par la comédie avec La part des anges qui obtiendra le prix du Jury à Cannes.Il montre les efforts d’un jeune Écossais violent, récemment devenu père, cherchant à s’insérer dans le jeu social après un long séjour en centre de rééducation pour avoir sauvagement agressé, sous cocaïne, un jeune homme qui en est resté infirme. Le chemin de la rédemption passe curieusement par la découverte… des grands whiskies. (Le Pacte)
 COFFRET KORE-EDA
COFFRET KORE-EDA
Réputé pour son approche novatrice, non spectaculaire et quasiment documentaire du cinéma de fiction, le Japonais Hirokazu Kore-eda a signé une suite de chroniques familiales qui évoque avec une grande douceur le deuil, le mensonge, l’abandon, la culpabilité, la difficulté d’être parents, la solidarité des enfants. Par sa délicatesse, ses sentiments pudiques et ses qualités de mise en scène, Kore-eda est comparé à son compatriote Ozu, lui-même citant plutôt Mikio Naruse ou Ken Loach. Un passionnant coffret regroupe six œuvres parmi les plus récentes du cinéaste nippon. Dans L’innocence (2023), un enfant se comporte de manière étrange. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule à travers les yeux de la mère, de l’enseignant et de l’enfant, la vérité émerge progressivement. Chaque personnage du film pourrait à un degré variable être marqué du sceau de la figure du monstre, qui apparaît dans le film comme un reflet des angoisses sociales contemporaines. Avec La vérité (2019), Kore-eda filme Fabienne, une grande vedette de cinéma (Catherine Deneuve) qui change la perception que le public a d’elle en publiant ses mémoires. À sa demande, sa fille installée aux États-Unis revient en France avec sa famille. La relation entre les deux femmes a toujours été difficile, et les retrouvailles vont être douloureuses. Une affaire de famille (2018), Palme d’or à Cannes 2018, analyse avec délicatesse la problématique du modèle familial japonais, opposant stéréotypes sociaux et réalité des relations dans la recherche du bien-être des enfants, réalités des sentiments et intérêts cupides face à la richesse et à la pauvreté. Dans The third Murder (2017), Kore-eda, à partir d’un fait-divers sordide, propose une réflexion sur la justice et sur la notion de culpabilité. Un récit noir mais émouvant. Auteur d’un roman à succès, Ryota, le héros de Après la tempête (2016), est détective privé pour subvenir à ses besoins et pour payer la pension alimentaire de son fils de onze ans. Il s’efforce de trouver de l’argent en jouant à la loterie et en pariant sur les courses cyclistes. Lors d’un typhon annoncé sur la ville, il est coincé dans l’appartement de sa mère, avec son ex-femme et son fils. L’occasion, peut-être, de se reconnecter. Dans Notre petite sœur (2015), Sachi, Yoshino et Chika, trois sœurs d’une vingtaine d’années, vivent dans la maison de leurs grands-parents à Kamakura. Leurs parents sont divorcés. Un jour, elles apprennent la mort de leur père, qu’elles n’ont pas vu depuis quinze ans. À l’enterrement, elles rencontrent leur demi-sœur, Suzu, 14 ans, qui vit avec sa belle-mère et son beau-frère. Observant le comportement de la belle-mère à l’enterrement, Sachi devine que Suzu a pris soin de leur père à sa mort, pas la belle-mère. À la gare, Sachi invite spontanément Suzu à venir vivre avec elles dans la maison familiale. (Le Pacte)
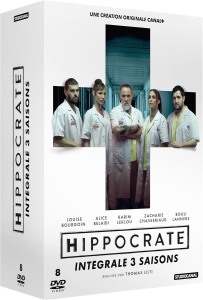 INTEGRALE HIPPOCRATE
INTEGRALE HIPPOCRATE
Dire que Thomas Lilti sait de quoi il parle quand il évoque la médecine et l’univers de l’hôpital est un truisme. Car le réalisateur a bien été médecin avant de passer du côté du grand écran. Très vite, il eut l’idée de créer une série sur l’univers hospitalier après l’échec de son premier long métrage, Les yeux bandés (2007). Cependant Lilti réalisa d’abord un long métrage sur le sujet, Hippocrate (2014) qui reçut un bel accueil critique et public couronné d’un César du meilleur second rôle pour Reda Kateb. Restant dans le milieu médical, il signe ensuite Médecin de campagne (2016) et Première année (2018). Enfin, avec Canal+, le cinéaste revint à son projet de série qui s’étendra sur trois saisons. Dans la première saison, on suit Alyson, Hugo et Chloé, trois internes en médecine, qui doivent gérer, seuls, un service hospitalier après le confinement, pour 48h, des médecins titulaires en raison d’un risque de contagion lié à la mort d’un patient atteint d’un méningocoque. Pour les internes, les défis, de la gestion des malades à la pression de la situation sanitaire, se succèdent d’autant que la quarantaine des titulaires se prolonge… Dans la saison 2, une vague de froid s’abat sur la France, alors les hôpitaux se retrouvent submergés de patients. Alyson et Hugo poursuivent leur stage dans le service de médecine interne. Chloé, l’interne sénior qui a été gravement malade à la fin de la première saison, tente de revenir pratiquer malgré son état de santé inquiétant. Quant à l’interne albanais Arben Bascha, la directrice de l’hôpital a découvert qu’il pratiquait la médecine sans avoir terminé ses études en Albanie à la fin de la première saison. Arben disparaît sans laisser d’adresse. Les internes vont devoir gérer l’hôpital Raymond-Poincaré sous la tutelle du docteur Brun, le nouveau patron des urgences aussi exigeant que charismatique. La troisième et ultime saison se déroule pendant l’été. Sur décision des autorités sanitaires, de nombreux services hospitaliers ont été fermés et ceux qui restent ouverts sont surchargés. Une grève de SOS Médecins aggrave la situation, laissant toute une population sans accès aux soins. Les patients affluent, les tensions sont palpables. À l’hôpital Poincaré, les soignants se rendent vite compte que les consignes ne sont pas tenables et certains décident de désobéir. Avec un regard réaliste et documenté sur le monde hospitalier, Hippocrate oscille entre fiction et reportage pour évoquer des trajectoires individuels mais aussi mettre en lumière les défis du système hospitalier français et offre un regard réaliste sur la vie des jeunes médecins en formation. Enfin, les attachants personnages sont, ici, remarquablement incarnées par ces excellents comédiens que sont Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Karim Leklou, Bouli Lanners, Zacharie Chasseriaud, Anne Consigny, Eric Caravaca, William Lebghil ou Geraldine Nakache. Une série intense, engagée et profondément humaine ! Avoir et à revoir ! (Studiocanal)
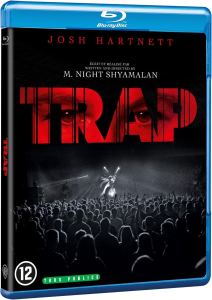 TRAP
TRAP
Grand costaud au sourire charmeur, Cooper Adams est un père de famille que son adolescente de fille Riley adore… surtout depuis qu’il a pris des places pour le concert de la pop-star Lady Raven. S’il s’occupe parfaitement de Riley, Cooper semble constamment aux aguets. Son regard balaye la grande salle de concert. Partout, de nombreux policiers barrent les entrées et les sorties tandis que, sur le parvis, les véhicules du FBI s’alignent en rangs serrés. Il apprend que la police, dirigée par une profileuse, a décidé de se servir du spectacle pour prendre au piège un tueur en série connu sous le nom du Boucher. Pris dans la nasse, Cooper va tenter de quitter les lieux… Avec Trap, M. Night Shyamalan (qui a connu, en 1999, son premier grand succès, tant commercial que critique, avec Sixième sens) s’éloigne quelque peu de sa veine fantastique habituelle pour s’inscrire dans le genre serial-killer. Mais, ici, point de suspense. On comprend, de suite, que le « gentil » Cooper n’est autre que le tueur. L‘intérêt de Trap réside alors dans le portrait d’un type sacrément malade de la tête, à la fois bon père de famille et tueur froid, prêt à tout pour protéger les siens et disposé sans sourciller à asphyxier au monoxyde de carbone un malheureux enfermé dans une cave. Le réalisateur a confié à sa fille Saleka, 28 ans, le soin d’incarner Lady Raven la chanteuse pop mais aussi de coécrire, coproduire, mettre en scène le show et interpréter toutes les chansons originales intégrées dans un vrai concert live. Seuls les spectateurs sont moins nombreux qu’il n’y paraît. Grâce aux effets visuels, les 300 personnes présentes au concert ont été multipliées de manière à remplir les 15 000 places du concert. Reste enfin à imaginer comment Cooper Adams va sortir d’une nasse bien close… Pour porter le personnage du serial-killer, le cinéaste a trouvé un interprète de choix. Josh Hartnett s’est fait connaître, dans le genre horrifique, en jouant le fils de Jamie Lee Curtis dans Halloween, 20 ans après (1998) et a souvent incarné ensuite, des personnages complexes comme le flic Bucky Bleichert dans Le dahlia noir (2006) de Brian de Palma. Avec le regard qui dérape, le sourire qui vire au rictus, son Boucher a de quoi faire peur. Et c’est bien ce que recherche Trap. (Warner)
 MAXXXINE
MAXXXINE
Sur les images en noir et blanc d’un film amateur, une charmante petite fillette blonde sourit et répond gentiment à son père : « Je n’accepterai jamais une vie que je ne mérite pas ». Nous sommes en 1959. Nous retrouvons, en 1985, Maxine Minx. La fillette est devenue une belle jeune femme qui a fait son chemin dans les films pour adultes. Mais Maxine en a assez du X et aspire à devenir une actrice de cinéma classique. Lors d’un casting pour La puritaine II, elle réussit à convaincre les producteurs et la rude réalisatrice Elizabeth Bender (Elizabeth Debicki) de lui confier le personnage principal de cette suite d’un film d’horreur à succès. La carrière hollywoodienne de Maxine Minz est désormais sur la bonne voie. Mais c’est sans compter sur un tueur en série qui fait régner la terreur à Los Angeles en assassinant de jeunes starlettes et en marquant leurs cadavres du sceau de la Bête… MaXXXine est le troisième et dernier volet d’une trilogie entièrement réalisée par l’Américain Ti West. En 2022, X racontait, dans une ambiance grindhouse, les aventures de la jeune Maxine partant, en 1979, tourner un film pornographique dans une ferme du Texas, propriété d’un vieux couple, Pearl et Howard. Ceux-ci, découvrant le genre du film, vont provoquer un massacre. Dans la foulée, West met en scène Pearl, préquelle de X, qui s’attache au personnage de Pearl et explore ses origines. Si Maxine a survécu au massacre orchestré par Pearl et Howard, elle continue à être hantée par les événements de 1979. Et cela déteint évidemment sur son parcours hollywoodien. Heureusement, elle peut compter sur son agent dont les méthodes ressemblent singulièrement à celles de Cosa Nostra. Avec pas mal de sang, de crâne fracassé mais aussi d’humour, Ti West s’amuse avec les codes du film d’horreur. Ici, West rend hommage au cinéma américain, serait-il de série B, en se glissant dans les coulisses d’un tournage en multipliant les clins d’oeil à Theda Bara, l’un des premiers sex-symbols de la cité des rêves, à Norman Bates et au motel de Psychose, au Dahlia noir, à Buster Keaton, à Marilyn Chambers et Behind the Green Door et même à l’immense Bette Davis qui, en matière de monstre et de dureté à Hollywood, en connaissait un rayon. L’Anglaise Mia Goth, vedette de ce thriller psychosexuel, semble marcher dans ses traces. (Universal)
 LAURE CALAMY EN TROIS FILMS
LAURE CALAMY EN TROIS FILMS
Comédienne qui sait conjuguer la drôlerie et la mélancolie, Laure Calamy s’est essayé avec succès sur les planches avant de passer du théâtre au grand écran où on la remarque dans des courts-métrages de Vincent Macaigne ou de Guillaume Brac. Avec Un monde sans femmes (2012) du second, elle reçoit le prix Jeanine-Bazin au festival Entrevues de Belfort. C’est son personnage de Noémie l’assistante dans la série télé Dix pour cent (2015) qui va la faire connaître du grand public. Voici un joli coffret qui regroupe trois films dans lesquels Laure Calamy a pu donner toute sa mesure. En 2020, elle tient le rôle principal d’Antoinette Lapouge, une institutrice qui attend avec impatience l’été pour passer des vacances avec Vladimir, son amant, père d’un de ses élèves. En apprenant que Vladimir ne peut pas venir car Éléonore, sa femme, a organisé une randonnée surprise dans les Cévennes avec leur fille et un âne, Antoinette décide de suivre leur trace sur le chemin de Stevenson, seule avec un âne nommé Patrick. Antoinette dans les Cévennes de Carole Vignal est une comédie franchement pétillante qui vaudra à la comédienne d’obtenir le César 2021 de la meilleure actrice. Sorti en 2022, Annie Colère est un film plus grave dans lequel la cinéaste Blandine Lenoir évoque la France de 1974, environ un an avant la loi Veil (qui dépénalisera l’avortement) en suivant Annie, une ouvrière d’usine (Laure Calamy) qui a deux enfants et ne souhaite pas en avoir plus. Lorsqu’elle se retrouve involontairement enceinte, elle fait appel au Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC) qui milite pour la légalisation de l’avortement en aidant des femmes à avorter ostensiblement. Annie, dont l’avortement s’est bien passé, va s’investir avec vigueur dans le mouvement… Enfin, en 2023, l’actrice retrouve la réalisatrice Carole Vignal pour Iris et les hommes, une comédie dans laquelle elle incarne Iris, une dentiste (au cabinet florissant) pourvue d’un mari formidable et de deux filles parfaites. Tout va donc bien pour Iris. Mais depuis quand n’a-t-elle pas fait l’amour ? Peut-être est-il temps de prendre un amant. S’inscrivant sur une banale appli de rencontre, Iris ouvre la boite de Pandore. Les hommes vont tomber… Comme s’il en pleuvait ! Les trois films sont accompagnés de suppléments dont des entretiens avec les cinéastes et la comédienne. (Diaphana)
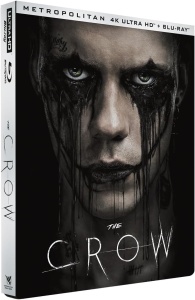 THE CROW
THE CROW
A Détroit, Eric Draven et Shelly Webster sont retrouvés dans leur appartement, la veille de leur mariage. Eric est passé par la fenêtre, mort sur le coup. Shelly meurt après avoir été torturée et violée. Eric et Shelly sont enterrés côte à côte. Leur amie, la petite Sarah, leur dépose des fleurs, mais un corbeau veille… À la nuit tombée, Eric revient d’entre les morts. Perturbé, déboussolé, il est guidé par le corbeau jusqu’à son appartement, abandonné dans l’état. Assailli par les souvenirs, les moments de bonheur lui reviennent, ainsi que sa mort, et celle de sa bien-aimée. Fou de colère, il se maquille à la façon d’un masque appartenant à Shelly, et sort ses vêtements gothiques. Enragé et invincible, il est bien décidé à prendre sa vengeance. Aidé par le corbeau, il traque et tue tous les responsables de la mort de Shelly les uns après les autres. La police, et notamment l’inspecteur qui a enquêté sur leurs morts, est sur ses traces. Eric retrouve également Sarah, qu’il protège. Aidé par l’inspecteur, il est bien décidé à réduire à néant le gang qui dirige la ville. Cependant ces derniers ont compris le lien entre le corbeau et Éric. Alors que ce dernier a fait un véritable massacre, il est blessé et le lien avec le corbeau est ainsi rompu. Sarah étant en danger, Eric n’abandonne pas. Eric se sert des moments de souffrance de Shelly, captés à travers l’inspecteur qui est resté à son chevet, pour désorienter son adversaire. Une fois sa vengeance accomplie, la petite Sarah comprend qu’Eric ne reviendra plus. Portant la bague de Shelly, elle n’oubliera jamais la légende du corbeau, car l’amour véritable est éternel. Avec The Crow qu’il réalise en 1994 en adaptant les éléments de comics parus en 1989, Alex Proyas donne un film fantastique où les décors gris, terribles et beaux, créent un monde violet et oppressant. Dans le rôle d’Eric Draven, jeune guitariste de rock, on trouve Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. Sa mort sur le tournage (par un revolver faussement chargé à blanc) acheva de faire de The Crow (qui sort en version 4K Ultra HD) un film culte. (Metropolitan)
 PILE OU FACE
PILE OU FACE
À Bordeaux, l’inspecteur Louis Baroni est chargé de l’enquête sur la mort d’une Madame Morlaix, tombée par la fenêtre de son appartement après une dispute avec son mari. Persuadé de la culpabilité d’Edouard Morlaix, le flic s’acharne à vouloir le faire avouer bien que l’affaire soit rapidement classée. En effet une affaire de trafic de drogue secoue la ville avec la mort par overdose du fils d’un notable. Mais Baroni s’en fiche et traque Morlaix malgré la sympathie latente qu’il ressent pour le veuf. En 1980, Robert Enrico, qui avait marqué les esprits avec Le vieux fusil (1975) et la romance tragique entre Romy Schneider et Philippe Noiret, retrouve ce dernier pour un polar qui délaisse un peu l’intrigue policière pour un face-à-face psychologique. Noiret incarne un flic proche de la retraite, intègre mais désabusé tandis que Michel Serrault est Morlaix, un employé comptable pas plus éploré que cela en veuf qui rêve d’aller vivre sur l’île de Talua. Le film, qui sort en Blu-ray dans la collection « Nos années 80 », doit beaucoup aux dialogues de l’excellent Michel Audiard qui signe aussi le scénario (d’après le roman Suivez le veuf d’Alfred Harris) en compagnie de Robert McCallum, pseudo du réalisateur américain Gary Graver, connu comme chef-opérateur d’Orson Welles. On aime entendre Baroni soupirer: « La justice, docteur, c’est comme la Sainte Vierge : si elle n’apparaît pas de temps en temps, le doute s’installe. » (Studiocanal)
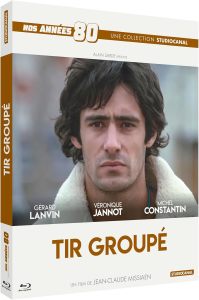 TIR GROUPÉ
TIR GROUPÉ
Fripier aux puces de Clignancourt, Antoine Béranger (Gérard Lanvin) en couple avec Carine Ferrand, employée dans un magasin de luxe mais ils ne vivent pas encore ensemble. Un soir, après avoir dîné au restaurant avec Carine et tenté vainement de la faire venir chez lui, Antoine la raccompagne à la gare où elle doit prendre le train qui la ramène chez ses parents à Enghien-les-Bains. Dans le train, Carine est sauvagement agressée par un voyou et ses deux acolytes sous les yeux des autres passagers trop apeurés pour intervenir. Alors qu’il s’apprête à quitter le train avec ses complices, Balestra assène un violent coup de karaté à Carine, qui meurt sur le coup. Prévenu du drame par l’inspecteur Gagnon (Michel Constantin), chargé de l’affaire, Antoine, fou de douleur et de chagrin, se remémore les moments passés avec Carine, dont leur première rencontre quelques mois auparavant. Un autre voyageur s’est fait agresser et tuer dans les couloirs du métro par les mêmes voyous qui lui ont coupé les doigts pour lui voler son alliance. Voyant que la police peine à retrouver les coupables, Antoine décide de les retrouver lui-même et s’achète une arme à feu. Avant de devenir réalisateur, Jean-Claude Missiaen fut critique de cinéma, notamment au Nouveau Cinémonde, aux Cahiers et à L’avant-scène cinéma. A partir de la fin des années soixante, il sera pendant une dizaine d’années l’attaché de presse de Woody Allen et de Claude Sautet. En 1981, Missaien (1939-2024) écrit le scénario de Tir groupé qu’il mettra en scène l’année suivante. Après cette première réalisation, il tournera encore pour le cinéma deux autres films policiers. Ici, il donne au trentenaire Gérard Lanvin un personnage qui n’est pas sans faire penser à celui de Charles Bronson dans Un justicier dans la ville (1974). Fou de chagrin et de douleur, Antoine Béranger décide en effet de mener sa propre enquête… Un polar efficace qui sort en Blu-ray dans la collection « Nos années 80 ». (Studiocanal)
 BLINK TWICE
BLINK TWICE
Jeune serveuse plutôt futée, Frida travaille dans un bar à cocktails de Los Angeles. Elle est fascinée par Slater King, un riche et jeune homme d’affaires ayant fait fortune grâce à la technologie. Elle réussit à s’introduire, avec sa copine Jess, dans le cercle fermé du magnat de la technologie et à participer à une réunion intime sur son île privée. Malgré le cadre idyllique, la beauté des gens, le champagne qui coule à flots et les soirées dansantes, Frida sent que cette île a quelque chose de plus terrifiant qu’elle n’y paraît… Fille du chanteur Lenny Kravitz et de la comédienne Lisa Bonet, Zoë Kravitz a été remarquée comme comédienne dans des films comme X-Men : Le commencement (2011), la saga Divergente (2014-2016), After Earth (2013), Mad Max: Fury Road (2015), Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald (2018) ou The Batman (2022) dans lequel elle incarne Catwoman. Avec Blink Twice (Pussy Island en v.o.), elle passe donc derrière la caméra et ne se tire pas mal, techniquement parlant, de ce thriller qui lorgne vers le genre rape and revenge. De fait, après avoir été sous le charme d’une île paradisiaque, Frida va déchanter lorsque son amie Jess disparaît. Il ne faut pas longtemps pour que le doute gagne à propos de ceux et de celles qui séjournent également dans les lieux. Frida s’en tirera mais de nombreux protagonistes resteront sur le carreau. Après avoir incarné Whitney Houston dans le biopic de 2022, la Londonienne Naomi Ackie s’empare joliment du personnage de Frida. A ses côtés, Channing Tatum, toujours dans la cool attitude, est Slater King, un magnat sortant de thérapie. Autour d’eux, on note la présence de Christian Slater, Geena Davis, Haley Joel Osment et Kyle MacLachlan en thérapeute tordu. (Warner)
LA NOUVELLE VAGUE D’HONG KONG ET LA GUERRE CONTRE LE NARCOTRAFIC 
 NOMAD
NOMAD
Rejetons de la classe aisée hongkongaise, Louis et son amie Kathy vont se lier à Tomato et Pong, de condition plus modeste. Devenus inséparables, les deux couples mènent une vie oisive, rêvant de rallier des contrées lointaines à bord du Nomad, le voilier du père de Louis. Ils seront bientôt rejoints par Shinsuke, le petit ami nippon de Kathy, poursuivi pour avoir déserté l’Armée rouge japonaise… En 1982, le Hongkongais Patrick Tam suscite l’admiration avec Nomad, son troisième long- métrage aussi audacieux qu’inclassable. Marqué notamment par le cinéma de Jean-Luc Godard, le réalisateur, connu pour The Sword (1980), un brillant film de sabre, fait à son tour preuve d’un style tout à fait singulier, optant pour des choix de couleurs et de cadrage très spécifiques qui naviguent entre le réalisme le plus brut et l’imagerie du roman photo. Interprétée par quatre des plus talentueux acteurs de cette génération (Pat Ha, Kent Tong, Cecilia Yip et la star de la cantopop Leslie Cheung dans son premier rôle « sérieux »), cette romance agitée et palpitante a créé la controverse en décrivant la sexualité débridée d’une certaine jeunesse hongkongaise et le climat politique désordonné de son époque. Car l’hédonisme des héros sera bientôt rattrapé par le réel et la comédie romantique des débuts basculera vers le thriller politique avant de s’achever dans un chaos sanglant un dénouement inattendu. Près de quarante ans après sa sortie en Asie, ce classique incontournable de la Nouvelle Vague hongkongaise sort pour la première fois en blu-ray dans sa version Director’s Cut restaurée en 4K ! Le film est accompagné de deux suppléments. Réflexion sur Nomad (18 mn) est un texte inédit de Patrick Tam écrit en 2024 et illustré pour l’occasion. « Ce film, dit le cinéaste, n’est ni une œuvre de réalisme social, ni un portrait réaliste de la jeune génération de l’époque. Ce n’est pas un film sur la jeunesse elle-même, mais sur l’énergie qu’elle dégage. » Génération perdue (25 mn) est un entretien exclusif dans lequel le producteur Dennis Yu et le cinéaste Stanley Kwan (alors assistant réalisateur sur le tournage) louent le talent de Patrick Tam, son style raffiné et le haut degré d’exigence qu’il a mis en pratique dans Nomad, au risque de la censure. (Carlotta)
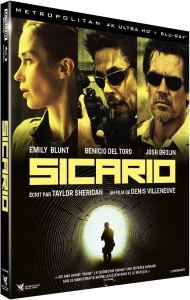 SICARIO
SICARIO
Jeune agente du FBI, Kate Macer est divorcée et sans aucune vie de famille. Cette idéaliste ne vit que pour son métier. Membre de l’unité HRT opérant dans la région de Phoenix dans le sud des États-Unis, elle est confrontée chaque jour à la violence des trafiquants de drogues qui ont transformé la région frontalière avec le Mexique en zone de non-droit. A la suite d’une intervention, elle se porte volontaire pour rejoindre l’équipe de Matt Graver. Leur mission : s’attaquer par tous les moyens au chef du cartel de Juárez. Face à la barbarie des cartels et au cœur d’un système opaque où l’État américain engage secrètement des sicaires tueurs à gages comme l’équipe de Matt Graver et d’Alejandro pour tuer le chef du cartel, Kate va devoir remettre en cause toutes ses certitudes si elle veut survivre. Depuis Incendies en 2010, le Québécois Denis Villeneuve enchaîne des films qui, sous les dehors du film de genre (Prisoners, Enemy), questionne les noirceurs de l’âme humaine. C’est le cas, en 2015, avec ce formidable Sicario (qui sort dans une édition Blu-ray 4K Ultra HD), plongée âpre et violente dans la guérilla constante qui oppose le gouvernement américain aux cartels de la drogue entre le Texas et le nord du Mexique. S’il maîtrise parfaitement les scènes d’action (ainsi une fusillade sur une autoroute encombrée à proximité d’un péage), Villeneuve est encore meilleur dans les portraits qu’il brosse d’une agent du FBI (Emily Blunt) prise dans une opération qui échappe à tout contrôle légal ou encore de son responsable (Josh Brolin) dépourvu de tout état d’âme. Mais le personnage le plus impressionnant est assurément celui porté par Benecio del Toro. Regard halluciné, il incarne un ancien procureur qui a vu toute sa famille assassinée et qui est devenu un énigmatique consultant mais surtout un tueur à gages appliqué à poursuivre sa vengeance. Un thriller vigoureux, précis et palpitant. (Metropolitan)
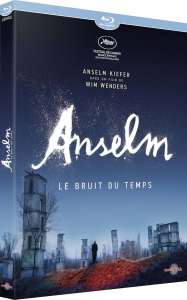 ANSELM – LE BRUIT DU TEMPS
ANSELM – LE BRUIT DU TEMPS
Célèbre pour ses grands films de fiction que sont Paris Texas (1984), Palme d’or à Cannes ou Les ailes du désir (1987), prix de la mise en scène toujours sur la Croisette, Wim Wenders a toujours développé une activité de documentariste. Dès 1980, il signe Nick’s Movie sur les derniers jours de Nicholas Ray ou, en 1983, il donne Tokyo-Ga qui explore le monde de Yasujiro Ozu sans oublier Buena Vista Social Club (1999) sur la musique cubaine. Plus près de nous, Wenders a célébré la danse avec Pina (2011) consacré à Pina Bausch. Ici, le cinéaste allemand se penche sur l’art, la technique, la vie et la psyché de son compatriote Anselm Kiefer. Anselm – Le Bruit du temps est une expérience cinématographique unique qui éclaire l’œuvre d’un artiste et révèle son parcours de vie, ses inspirations, son processus créatif, et sa fascination pour le mythe et l’histoire. Le passé et le présent s’entrelacent pour brouiller la frontière entre film et peinture, permettant de s’immerger complètement dans le monde de l’un des plus grands artistes de ce temps. « Pour se connaître soi, dit Kiefer, il faut connaître son peuple, son histoire… j’ai donc plongé dans l’Histoire, réveillé la mémoire, non pour changer la politique, mais pour me changer moi, et puisé dans les mythes pour exprimer mon émotion. C’était une réalité trop lourde pour être réelle, il fallait passer par le mythe pour la restituer. » Portrait éblouissant d’un artiste qu’on avait eu l’occasion de voir en 2001 à la fondation Beyeler de Riehen avec Die sieben Himmelspaläste 1973-2001, le documentaire, disponible pour la première fois en Blu-ray et dvd, de Wenders (né en 1945 tout comme Kiefer dans l’Allemagne traumatisée par la guerre) est d’une éblouissante beauté pour illustrer la mission d’un artiste (qui vit et travaille à Barjac dans le Gard) : toujours rappeler la banalité du mal. Dans les suppléments, on trouve Conversation entre Wim Wenders et Hans Ulrich Obrist (16 mn), une rencontre inédite avec Hans Ulrich Obrist, historien et critique d’art, dans laquelle Wim Wenders discute de la genèse du film, liée à sa visite de l’atelier hors norme d’Anselm Kiefer à Barjac, de son amitié de trente ans avec l’artiste et du rôle de la 3D pour créer une expérience immersive dans les œuvres d’art de ce dernier. (Carlotta)
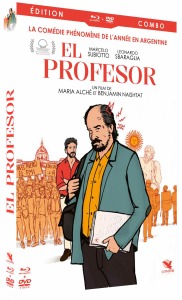 EL PROFESOR
EL PROFESOR
Alors qu’il accomplit son jogging dans les rues de Buenos Aires, le professeur Caselli, détenteur de la chaire de philosophie de l’université de Puan, s’effondre et meurt brusquement. A l’université, c’est la consternation. Son successeur naturel devrait être Marcelo Pena, dont il fut le mentor. Mais, en dehors de ses cours où il excelle, Marcelo est terne, maladroit et introverti. Alors que ses collègues universitaires rendent hommage à Caselli, débarque Rafael Sujarchuk. Il vient d’Allemagne où il enseigne à Francfort et il est de retour en Argentine parce qu’il file le parfait amour avec une vedette du cinéma et de la télévision. Tandis que Marcelo Pena, frappé par l’émotion et pris par sa discrétion naturelle, ne parvient pas à dire quelques mois, Sujarchuk éblouit son monde avec des citations de Heidegger dans le texte. Le malheureux Pena a vite compris que Sujarchuk brigue le poste de Caselli et il a conscience que ses chances de prendre la suite de son maître sont très maigres. D’autant que son rival a tout le charisme et le pouvoir de séduction qui lui manquent. Par le passé, le cinéma argentin a donné quelques belle surprises en forme de comédies grinçantes comme Les nouveaux sauvages (2014) de Damian Szifron ou Citoyen d’honneur (2016) de Gaston Duprat et Mariano Cohn. Ici, c’est encore un duo de cinéastes argentins -Maria Alché et Benjamin Naishtat- qui est à l’oeuvre pour une comédie dramatique qui place au centre de son propos, un personnage de parfait anti-héros. Car Marcelo Pena, s’il parle brillamment de l’oeuvre de Jean-Baptiste Rousseau, est un type fade et terriblement velléitaire. Et pourtant, on s’attache à ce type chauve et déjà bedonnant (Marcelo Subiotto) qui peine à s’imposer face à un (brillant) bellâtre (Leonardo Sbaraglia)… Le film vaut aussi par quelques séquences savoureuses comme le cours de philo dispensé à une vieille dame et aussi par ce qu’il montre de la réalité économique de l’Argentine où les profs d’université (et ils ne sont pas les seuls) tirent le diable par la queue… (Condor)
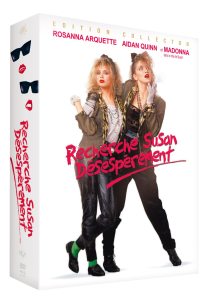 RECHERCHE SUSAN DESESPEREMENT
RECHERCHE SUSAN DESESPEREMENT
Jeune bourgeoise un peu coincée du New Jersey, Roberta s’ennuie ferme dans sa luxueuse maison. Lorsqu’elle découvre, dans le journal, une petite annonce « Recherche Susan désespérément », elle décide d’enquêter afin de découvrir qui se cache derrière cette fameuse Susan… Probablement le meilleur film de Madonna (avec peut-être Dick Tracy en 1990 et Evita en 1996) qui rencontre aussi, avec Desperately Seeking Susan (1985), son plus gros succès sur le grand écran. Il est vrai que le personnage de Susan lui va comme un gant. Le film mis en scène par Susan Seidelman eut une influence importante pour la mode des eighties, faisant des crucifix, mitaines et jupes flottantes de Madonna le stéréotype de la Bad Girl de l’époque. Au rythme d’Into the Groove de Madonna, voici une comédie policière rythmée, kitsch et rafraîchissante au cœur du New York branché des années 80 car le film possède la bonne humeur et le charme indéfinissable de cette époque. L’intrigue originale regorge de quiproquos et de joyeuses situations cocasses, alliant romantisme et burlesque. L’opposition entre le monde bourgeois et le monde punk fonctionne très bien, et les personnages sont attachants. Recherche… est porté par Rosanna Arquette, très craquante en « desperate housewife » et une Madonna délurée, frimeuse et provocante qui tient à avoir, ici, un style « sexy, assoiffé de vie et complètement trash ». À leurs côtés, on remarque John Turturro et Aidan Quinn. Si le film apparaît comme une comédie légère, c’est aussi une véritable ode au féminisme qui relate avant tout l’histoire d’une émancipation, celle de Roberta, femme délaissée par son riche mari imbu de lui-même et de Susan, une joyeuse pétroleuse. Cette plongée au cœur de la contre-culture punk et new wave des années 80 sort, pour la première fois en Blu-ray dans un coffret collector en édition limitée qui ravira tous les fans de la madone. Le coffret comporte le Blu-ray , deux DVD, mais aussi un livre de 98 pages, une affiche du film exclusive, cinq cartes postales, trois badges et plus de 2h30 de bonus inédits tels que des entretiens avec Rosanna Arquette, Susan Seidelman et la productrice Sarah Pillsbury. (Bubbelpop)
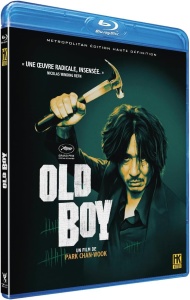 OLD BOY
OLD BOY
Alors qu’il s’apprêtait à fêter l’anniversaire de sa fille, Oh Dae-su est arrêté par la police pour ivresse sur la voie publique. Arrivé plus tard, son ami Joo-hwan, persuade les policiers de le laisser repartir. Mais sur le chemin du retour, Oh Dae-su est enlevé. Il est ensuite séquestré dans une pièce, sans savoir par qui ni pourquoi, avec pour seul lien avec l’extérieur une télévision, par laquelle il apprend que sa femme a été assassinée, qu’il est le principal suspect du meurtre et que sa fille a été confiée à des parents adoptifs. Oh Dae-su passe le temps en s’entraînant à boxer contre les murs et en essayant de creuser un tunnel pour s’échapper. Relâché quinze ans plus tard, toujours sans explication, Oh Dae-su se voit confier un téléphone et est contacté par le commanditaire de son enlèvement alors qu’il est dans un restaurant où il s’évanouit tandis que Mi-do, la cheffe cuisinière, est prise de compassion et le recueille chez elle. Oh Dae-su tente de coucher avec elle, mais Mi-do le repousse tout en lui avouant néanmoins qu’elle est aussi attirée par lui. Lorsque Old Boy a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2003, les festivaliers ont vécu un choc. On se souvient de la manière dont le héros arrangeait les dents d’un malfrat avec un marteau ou encore comment Oh Dae-su dévore, dans un bar, un poulpe vivant. On a appris par la suite que Choi Min-sik, qui incarne Oh Dae-su, était… végétarien. Second volet d’un triptyque sur la vengeance (le premier, en 2002, Sympathy for Mister Vengeance, avait établi la réputation de Park Chan-wook), ce thriller impressionne par une mise en scène virtuose récompensée, sur la Croisette, du Grand prix du jury. En se fondant sur un manga, lui-même inspiré du Comte de Monte Cristo, le cinéaste sud-coréen décrit la tragique aventure d’un homme kidnappé en sortant de chez lui et emprisonné pendant quinze ans sans aucune explication… La scène la plus spectaculaire dans ce film visuellement impeccable, est celle où O Dae-su retrouve son lieu de détention et va mettre hors de combat son tortionnaire et tous ses hommes… Dans un couloir verdâtre, Park Chan-wook filme cette chorégraphie violente où les coups, de bâton ou de marteau, pleuvent en une unique et long plan-séquence avec de petits travellings pour accompagner le ballet entre Oh Dae-su (qui a un couteau planté dans le dos) et ses assaillants. Un dernier plan poitrine montre le héros avec un petit sourire tandis qu’un filet de sang coule sur son cou. (Metropolitan)
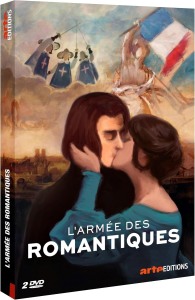 L’ARMEE DES ROMANTIQUES
L’ARMEE DES ROMANTIQUES
En ce début du 19e siècle, un nouveau courant artistique, le romantisme, déferle sur la France. Victor Hugo, George Sand, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Nadar, Eugène Delacroix, Berthe Morisot, Gérard de Nerval, Gustave Courbet, Frédéric Chopin, Edouard Manet, Charles Baudelaire, Hector Berlioz… toute une jeune génération d’artistes est bien décidée à tout révolutionner. Ils ont brisé les conventions grâce à leurs mots, leurs plumes ou leurs pinceaux. Ils vont bouleverser l’histoire des arts et des idées en se battant pour leur liberté d’expression. Racontée entièrement en animation traditionnelle 2D, au coeur du Paris bouillonnant, cette série (4 x 52 minutes en deux DVD) met en scène la capitale littéraire et artistique entre 1824 et 1870 et révèle les plus intimes secrets de la génération des Romantiques. De jeunes artistes intrépides, pressés de réveiller la société et briser les carcans classiques par tous les moyens en leurs pouvoirs, pinceaux, plumes ou fusil. Leurs destinées croisées sont incroyablement romanesques et leurs combats font plus que jamais écho dans le monde d’aujourd’hui. Déjà responsable en 2015 pour Arte d’une première série documentaire intitulée Les Aventuriers de l’art moderne, Amélie Harrault s’intéresse, ici, en compagnie de Dan Franck auteur de l’idée originale, aux romantiques. « Nous avons décidé, dit-elle, de poser notre regard sur le 19e siècle, une période qui est finalement mal connue, alors qu’elle est toujours d’actualité. Cette période est peu étudiée à l’école. On aborde la Révolution française, puis Napoléon avant de passer directement à la IIIe République. C’est une période complexe, troublée, qui demande du temps. La République ne s’est pas faite en une révolution, il y en a eu plusieurs. En travaillant sur ce projet, j’ai réalisé qu’Alexandre Dumas avait l’âge de Victor Hugo et que, finalement, tous ces artistes romantiques se connaissaient. L’idée de la série est de dessiner un paysage cohérent et linéaire afin de ne pas perdre le spectateur dans la chronologie.» Par ailleurs, Amélie Harrault disposait d’un impressionnant fonds iconographique et libre de droit, l’animation permettant de mettre en avant des registres picturaux très différents. Le coffret est accompagné de différents supplément dont le making of du générique (2mn35), les secrets de fabrication (33 mn), une rencontre avec Amélie Harrault & Céline Ronté et Le carnet des romantiques, 28 pages de textes et dessins. (Arte Editions)
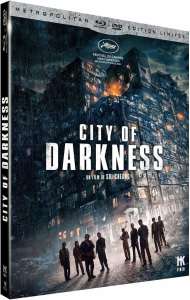 CITY OF DARKNESS
CITY OF DARKNESS
Dans les années 80, le seul endroit de Hong Kong où la Loi britannique ne s’appliquait pas était la redoutable citadelle de Kowloon, une enclave livrée aux gangs et trafics en tous genres. Fuyant le puissant boss des Triades Mr. Big, le migrant clandestin Chan Lok-kwun se réfugie à Kowloon où il est pris sous la protection de Cyclone, chef de la Citadelle. Avec les autres proscrits de son clan, ils devront faire face à l’invasion du gang de Mr. Big et protéger le refuge qu’est devenue pour eux la cité fortifiée. Remarqué en 2021 pour le polar Limbo puis en 2023 avec Mad Fate, un drame autour d’un maître de feng shui et d’une prostituée assassinée, le cinéaste hongkongais Soi Cheang est à la tête depuis 2000 d’une solide filmographie. Ici, il adapte la bande dessinée éponyme d’Andy Seto pour une plongée dans l’univers de la pègre des années 80. Présenté en séance de minuit au festival de Cannes en mai dernier, City… a été l’un des plus gros succès de tous les temps dans les salles de Hong Kong. Si l’intrigue n’est pas très originale sur fond de guerre des gangs, c’est du côté de la mise en scène que le film mérite l’attention. D’abord parce que City of Darkness emporte le spectateur dans le décor, façon tour de Babel, de la citadelle de Kowloon, personnage à part entier du film, qui tient à la fois du château fortifié que du bidonville que les personnages sillonnent dans tous les sens au gré des coursives, des puits ou des toits. Un décor qui se prête aux rudes combats entre Lok-Kwun et les nervis de Mr. Big sur fond de spectaculaires envols mais aussi de moments quasiment burlesques. (Metropolitan)
 UNE FEMME A SA FENETRE
UNE FEMME A SA FENETRE
En 1936, à Delphes, Margot, la ravissante épouse trompée de Rico Santorini, un diplomate italien vaguement mâtiné de play-boy, mène une vie dorée, se gardant toutefois de céder aux avances d’un soupirant sympathique et assidu, l’industriel Raoul Malfosse. Le climat politique est troublé. Le monde décadent et sans âme de la grande bourgeoisie grecque n’offre guère d’occasions de vivre intensément comme le souhaiterait la romanesque Margot, qui cache sa véritable nature sous un masque de cynisme et de frivolité. Un coup d’Etat se prépare. Un chaude nuit d’août, par la fenêtre de sa chambre, Margot aperçoit un homme poursuivi par la police. Elle décide de recueillir le fugitif et de le cacher. C’est un militant hostile au régime en place, du nom de Michel Boutros. Bientôt, elle parvient à le faire embaucher comme chauffeur chez Malfosse, et en tombe amoureuse. Désormais, tous les moyens lui semblent bons pour vivre sa passion… Bientôt, Margot disparaît définitivement avec l’homme qu’elle aime. Rico et Malfosse tenteront en vain de la retrouver. En 1967, une jeune femme, la fille de Michel et Margot, revient en Grèce sur les lieux où ses parents se sont connus et aimés. En 1976, sur un scénario de Jorge Semprun, Pierre Granier-Deferre tourne Une femme à sa fenêtre, d’après le roman éponyme de Drieu la Rochelle paru en 1929. Le parcours politique de Pierre Drieu la Rochelle, brillant intellectuel, ami d’Aragon et de Malraux, qui, à la fin des années trente, se disait à la fois « socialiste » et « fasciste », est évidemment nauséabond par ses actes de collaboration avec les nazis. Pourtant le film de Granier Deferre réussit bien à mêler un contexte historique pesant (même si on ne connaît pas forcément bien les arcanes de l’histoire de la Grèce) et de fortes aventures individuelles. Et puis Une femme à sa fenêtre (qui sort en Blu-ray dans la collection Nos années 70) vaut évidemment par quatre excellents comédiens évoluant avec une grâce inquiétante, dans les beaux paysages de Grèce. Romy Schneider, magnifiquement photographiée par Aldo Tonti, est une Margot faussement frivole. L’actrice qui vient de tourner Le vieux fusil (1975) est au sommet de sa beauté et de son art. Elle est entouré de Victor Lanoux (Boutros), Umberto Orsini (Rico) et Philippe Noiret (Malfosse) qui était déjà son partenaire dans le film de Robert Enrico. (Studiocanal)
 LE GARÇON ET LE HÉRON
LE GARÇON ET LE HÉRON
Durant la guerre du Pacifique, la mère de Mahito meurt dans l’incendie de l’hôpital où elle travaille à Tokyo. Son père Shoichi se remarie avec Natsuko, la jeune sœur de son épouse décédée, qui est enceinte de lui, et déménage à la campagne avec son fils. Mahito a du mal à s’adapter à sa nouvelle vie et à faire le deuil de sa mère. Il est importuné par un héron cendré surnaturel. En poursuivant la créature, Mahito découvre une mystérieuse tour en ruine, dont l’entrée est obstruée. La tour aurait été construite par son grand-oncle, qui aurait par la suite disparu sans laisser de traces. Mahito se fabrique un arc et une flèche avec une plume du héron. Alors qu’il rentre de l’école, où il s’est battu avec d’autres garçons, Mahito se blesse volontairement avec une pierre. En convalescence chez lui, il découvre le livre Et vous, comment vivrez-vous? avec une dédicace de sa mère qui voulait lui en faire cadeau lorsqu’il serait plus grand. Une domestique lui dit alors que Natsuko a disparu. En compagnie de Kiriko, une des domestiques, le gamin se lance alors à sa recherche et se dirige vers la tour. Il y retrouve le héron, qui se moque de lui, lui dit que sa mère est vivante et qu’il doit entrer dans la tour pour la sauver, elle et Natsuko. À l’intérieur, le héron lui montre une image de sa mère qui s’avère être une illusion. Mahito tire une flèche avec son arc, qui va se ficher dans le bec du héron, révélant l’homme difforme qui se cache à l’intérieur.… Réalisateur fêté, le Japonais Hayao Miyazaki charme depuis des années le public des cinémas avec des films comme Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké, Le voyage de Chihiro ou Le château ambulant, Miyazaki fait, ici, un retour remarqué avec une œuvre qui aura nécessité sept années de travail. Couvert de récompenses dont l’Oscar du meilleur film d’animation, Le garçon et le héron a été aussi un beau succès dans les salles françaises avec plus d’un million et demi d’entrées. Le film occupe une place à part dans le parcours de Miyazaki (82 ans) qui mêle au conte poétique et merveilleux une part d’autobiographie. Un univers captivant sur lequel règne un maître de l’animation et de l’imaginaire ! (Wild Side)
 DINER A L’ANGLAISE
DINER A L’ANGLAISE
Sarah et Tom sont en proie à de graves difficultés financières. Leur seule solution est de vendre leur maison londonienne. Lorsque leurs amis débarquent pour un dernier dîner, Jessica, une vieille amie, s’invite et se joint à eux. Après une dispute à première vue sans importance, Jessica se pend dans le jardin. Tom s’apprête à appeler la police lorsque Sarah réalise que si l’acheteur l’apprend, la vente tombera à l’eau, ruinant ainsi leur couple. La seule façon de s’en sortir est de ramener le corps de Jessica dans son propre appartement. Après tout, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Le dîner était presque parfait ! Comédie dramatique à l’humour so british, Dîner à l’anglaise relate la nuit sous haute tension que va vivre un petit groupe d’amis bourgeois après le suicide de l’un d’entre eux. Rapidement, c’est la panique, la petite soirée tranquille vire au cauchemar. Chaque événement déclenche le suivant, et les rebondissements et situations cocasses s’enchaînent alors avec brio et sans temps mort. À travers un solide comique de situation et le thème revisité du cadavre encombrant, The Trouble with Jessica (en v.o.) distille une savoureuse satire de la middle class anglaise, la montrant superficielle et pleine de vanité. Le vernis social vole en éclat, et de sombres secrets sont révélés. Entre scandales, culpabilité, fausse loyauté et trahisons, l’ambiance est à la fois étouffante et hilarante. Les dialogues sont percutants, l’humour noir est grinçant et jouissif. De plus, ce petit bijou bien corrosif, mis en scène par Matt Winn, est servi par de bons acteurs britanniques comme Shirley Henderson, Rufus Sewell, Olivia Williams, Indira Varma ou Alan Tudyk. Sarcastique ! (Blaq Out)
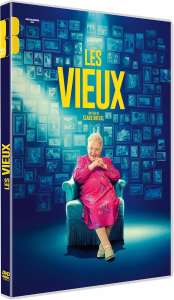 LES VIEUX
LES VIEUX
Ils sont de toutes origines et ont vécu près d’un siècle. Ils ont traversé les bouleversements de l’histoire. Ils sont drôles, émouvants, rebelles. Ils nous surprennent et nous émerveillent. Pourtant, on entend rarement leur voix. Voici une invitation au voyage, à travers la France, à leur rencontre : les Vieux. « Chacun a sa place, jusqu’au dernier souffle ». Ce sont d’anciens pêcheurs, mineurs, agriculteurs, ouvriers, ou encore baron, ils viennent de milieux géographiques et culturels très différents, ont chacun leur propre personnalité, mais tous ont un point commun : ils sont vieux. De nos jours, si les personnes âgées sont présentes dans le débat public, c’est souvent de façon négative : le coût des retraites, la fin de vie, la vétusté des Ephad… Mais on n’entend rarement les principaux concernés. Les Vieux leur donne enfin la parole. À travers le portrait intime d’une trentaine de personnes âgées de 80 à 100 ans, ce documentaire dresse une peinture tendre et colorée de la vieillesse. Devant la caméra de Claus Drexel (Au Bord du Monde, en 2014, évoquait le quotidien de sans-abris à Paris), ils disent les moments forts de leur vie, marquée par la guerre, le progrès, et racontent la façon dont ils vieillissent, les difficultés mais aussi les joies. Leurs témoignages d’une grande richesse offrent un voyage à travers la France au fil du siècle dernier. On rit, on est ému, on a envie d’appeler nos grands-parents : ce film à la fois drôle, captivant et touchant, est bouleversant d’humanité, et change notre regard sur la vieillesse. « Si j’ai un rêve par rapport à ce film, dit le cinéaste, c’est qu’il permette de recréer du lien ». (Blaq Out)
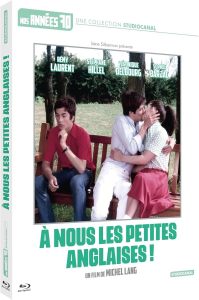 A NOUS LES PETITES ANGLAISES
A NOUS LES PETITES ANGLAISES
Été 1959. Après avoir raté leur baccalauréat, deux lycéens français, Jean-Pierre et Alain, voient leurs vacances à Saint-Tropez annulées par leurs parents, au profit d’un séjour linguistique d’un mois dans le sud de l’Angleterre pour, officiellement, améliorer leur anglais. Alain est d’une nature romantique et est déçu de laisser sa petite amie à Paris, mais Jean-Pierre lui remonte le moral : ces vacances forcées seront l’occasion de faire de nouvelles conquêtes car selon lui, c’est bien connu, les Anglaises sont beaucoup plus libérées et adorent les « Frenchies ». De là à aider les deux copains à peine pubères (Rémi Laurent et Stéphane Hillel) à perdre leur innocence, il n’y a qu’un pas. En se souvenant de ses vacances à Ramsgate, station balnéaire du Kent, pendant l’été de ses 17 ans, le réalisateur français Michel Lang signe une comédie juvénile qui fera un carton dans les salles françaises de 1976, réunissant 5,7 millions de spectateurs et se plaçant juste après L’aile ou la cuisse de Claude Zidi (5,8 millions d’entrées) et Les dents de la mer de Steven Spielberg (6,2 millions). Dans la collection « Nos années 70 », voici une pantalonnade qui fait de deux boutonneux des héros au milieu de copines à couettes. Michel Lang, pour son premier long-métrage, marche un peu dans les brisées de Pascal Thomas qui signait, en 1972, Les zozos pour évoquer, avec une vraie verve, les premiers émois estivaux et amoureux de deux potaches. Avec le recul, on regarde ces aventures avec entrain et tendresse. Le tout sur des notes de Mort Schuman qui obtiendra un César de la meilleure musique écrite pour un film. Michel Lang reviendra à cette thématique vacancière en 1978 avec L’hôtel de la plage. Pour une bonne bouffée de (joyeuse) nostalgie ! (Studiocanal)
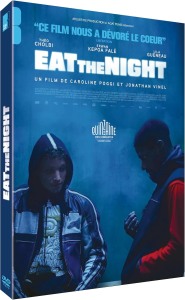 EAT THE NIGHT
EAT THE NIGHT
Pablo et sa sœur Apolline s’évadent de leur quotidien en jouant à Darknoon, un jeu vidéo qui les a vus grandir. Un jour, Pablo rencontre Night, qu’il initie à ses petits trafics, et s’éloigne d’Apolline. Alors que la fin du jeu s’annonce, les deux garçons provoquent la colère d’une bande rivale. Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, le second film de Caroline Poggi et Jonathan Vinel plonge le spectateur dans un univers puissant et singulier, où monde réel et virtuel s’opposent et s’entrelacent en permanence, dans un compte à rebours haletant. Entre jeu vidéo et thriller narcotique, passion amoureuse et liens frère-sœur, Eat the night est un récit initiatique à la fois moderne et bouleversant. « Darknoon a toujours été là. C’est là que je vis. Je m’y sens mieux que dans ma propre ville ». Alors que le jeu vidéo est souvent perçu comme une influence néfaste, les deux cinéastes le montrent ici comme un refuge face à la violence du réel : l’univers du jeu est lumineux et coloré, tandis que le quotidien est sombre et banal. Une réflexion rafraîchissante, à l’heure où la majorité de nos interactions passe désormais par le virtuel. En mixant drogue, amour et jeux vidéo, ce conte hybride unique, à la fois tendre, violent et passionnel, est aussi teinté de la nostalgie du paradis perdu. Les personnages, bien écrits et interprétés avec justesse par Théo Cholbi (La Nuit du 12), Lila Gueneau (L’Aventure des Marguerite) et Erwan Kepoa Falé (Le Lycéen), sont très réalistes. L’expérience visuelle est par ailleurs envoûtante, les images de synthèse du jeu Darknoon étant des plus somptueuses. Un thriller hypnotique ! (Blaq Out)
 RIDDLE OF FIRE
RIDDLE OF FIRE
Il était une fois un trio d’enfants cherchant à craquer le code parental de leur nouvelle console et aussi la parfaite recette de la blueberry pie, une secte de braconniers qui ne cessent de se chicaner, une petite fille qui a des dons elfiques… Un premier long métrage dont le budget est aussi lilliputien que sont géantes sa sophistication formelle et sa liberté épique. Comme si, dans une forêt enchantée du Wyoming, Tom Sawyer, le Club des cinq et les Goonies s’étaient donné rendez-vous pour faire un jeu de plateau autour d’un feu de camp. Premier long-métrage de Weston Razooli, Riddle of Fire est aussi le tout premier « néo-conte de fées » ! Mêlant heroïc fantasy, western, road movie, ou encore folklore britannique, cette comédie d’aventure féerique à la croisée de Stranger Things et des Goonies met en scène un groupe d’enfants espiègles, entraînés dans une suite de péripéties improbables. Les quêtes s’enchainent telles des niveaux de jeu vidéo, entremêlant le réel et l’épique d’une aventure médiévale, et plongent le spectateur dans un délirant jeu de rôles grandeur nature. Tourné sur pellicule Kodak 16mm, Riddle of Fire exploite merveilleusement les belles étendues du Wyoming. Avec ses tons bleus et verts dominants, la photographie plonge le spectateur dans un univers mystique et enchanteur. D’entêtants morceaux de dungeon synth – une musique électronique atmosphérique empruntant au metal et au médiéval – accompagnent les images et achèvent la construction de ce monde à mi-chemin entre réalité et songe. Avec un scénario regorgeant de trouvailles inventives, respirant la liberté et embrassant dès le début l’innocence et l’insouciance des enfants, cette aventure séduit aussi par le jeu des jeunes acteurs. Une odyssée rocambolesque au souffle enchanteur à voir en famille. (Blaq Out)
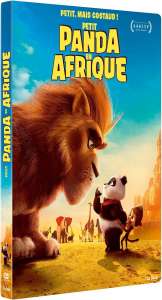 PETIT PANDA EN AFRIQUE
PETIT PANDA EN AFRIQUE
Pang est un jeune panda qui grandit dans un village idyllique et tranquille au cœur de la Chine. Mais lorsque sa meilleure amie, Jielong la dragonne, est enlevée pour être offerte en présent à un jeune roi lion arrogant et capricieux, Pang n’hésite pas une seconde. Bravant tous les dangers, il embarque pour une aventure qui va le mener jusqu’en Afrique ! En cours de route, Pang se lie d’amitié avec un singe malicieux et intrépide qui le guide dans ce continent étranger, riche en merveilles et en dangers. Ensemble, ils rencontrent différents animaux africains et découvrent des paysages exotiques qui ne cessent de surprendre le jeune panda. Ce périple permet à Pang de comprendre les vraies valeurs de l’amitié, de la bravoure, et de la persévérance, tout en célébrant les différences culturelles. Réalisé par Richard Claus et Karsten Kiilerich, Petit Panda en Afrique est un attachant film d’animation européen qui nous emmène de la Chine à l’Afrique à travers le voyage du téméraire jeune Pang, panda plein de courage qui ressemble comme un frère à son « cousin » adepte de kung fu. Les auteurs apportent beaucoup de soin aux paysages chinois et africain joliment reproduits dans l’animation et le propos, à travers des personnages drôles et touchants, célèbre la fidélité, la solidarité et la découverte de l’autre. Un beau film coloré et tendre pour toute la famille. (Le Pacte)
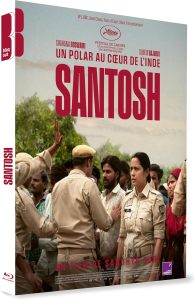 SANTOSH
SANTOSH
Une région rurale du nord de l’Inde. Après la mort de son mari tué lors d’une émeute dans un quartier musulman, Santosh, une jeune femme, hérite de son poste et devient policière comme la loi le permet. Lorsqu’elle est appelée sur le lieu du meurtre d’une jeune fille de caste inférieure, Santosh se retrouve plongée dans une enquête tortueuse aux côtés de la charismatique inspectrice Sharma, qui la prend sous son aile. En Inde, il y a deux sortes d’intouchables : ceux que personne ne veut toucher et ceux que personne n’a le droit de toucher. C’est ce que découvre la jeune Santosh qui donne son nom à ce polar saisissant, lorsqu’elle reprend l’emploi de son défunt mari en tant que policière, et qu’elle constate les inégalités de traitement au sein du système policier indien. Premier film de fiction de la documentariste Sandhya Suri, ce solide polar féministe plonge le spectateur dans l’Inde profonde d’aujourd’hui. La loi de nomination compassionnelle, qui permet à l’héroïne d’hériter de l’emploi de son mari, est bien réelle. Le système de castes qui est dénoncé l’est tout autant : ainsi, les Dalits sont condamnés dès leur naissance à une vie marginale. Entre corruption, brutalités policières, camouflage de viols et de meurtres commis sur les femmes, le long-métrage aborde des questions dures et essentielles. Mais Santosh n’est pas qu’un simple film à dimension sociale : c’est avant tout un thriller intense, captivant et sombre, à la mise en scène élégante et aux scènes percutantes. C’est aussi un beau portrait de femme, sur la quête de statut et le cheminement dans le deuil du personnage principal, interprété avec justesse par la comédienne indienne Shahana Goswami. Sorti en Blu-ray et DVD, le film est accompagné du court métrage The Field de Sandhya Suri, qui avait été nommé aux BAFTA Awards en 2018. (Blaq Out)
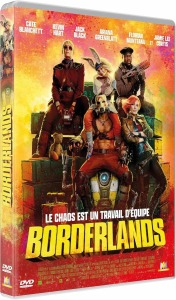 BORDERLANDS
BORDERLANDS
Chasseuse de primes au passé trouble, Lilith revient à contrecœur sur sa planète natale, Pandore, la planète la plus chaotique de la galaxie… Sa mission est de retrouver la fille d’Atlas, l’homme le plus puissant (et le plus méprisable) de l’univers, qui a été enlevée par le mercenaire Roland. Pour y arriver, Lilith va devoir former une alliance inattendue avec une joyeuse équipe de marginaux : Roland, un mercenaire chevronné ; Tiny Tina, une pré-ado avec un gros penchant pour la démolition ; Krieg, le protecteur musclé de Tina ; Tannis, une scientifique fantasque et Claptrap, un robot très bavard. Ensemble, ces héros improbables vont devoir affronter les pires espèces extraterrestres et de dangereux bandits pour découvrir les secrets les plus explosifs de Pandore. Mais l’adolescente n’a-t-elle pas demandé à Roland de l’aider à fuir l’emprise de son père ? Réalisateur du diptyque d’horreur Hostel (2005 et 2007), le réalisateur américain Eli Roth (connu aussi pour avoir, comme acteur, tenu l’un des rôles principaux du Inglorious Basterds de Tarantino) adapte, ici, une série de jeux vidéo éponyme de Gearbox Software pour donner un film d’action passablement foutraque avec des personnages bien déglingués. Lors de sa sortie en salles, le film a été un échec au box office mais, au vu de son univers joyeusement fun, il mérite probablement d’être réévalué. Bien sûr, le scénario n’est pas bien épais et ce n’est pas la subtilité qui l’étouffe mais voilà quand même un film de genre qui s’ingénie à partir dans tous les sens et dans lequel le casting (Cate Blanchett, Edgar Ramirez, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Gina Gershon et Jack Black qui prête sa voix au robot Claptrap) a plutôt fière allure. (M6)
 SUPER PAPA
SUPER PAPA
Faire lire les enfants, quelle excellente idée ! On applaudit donc Tom lorsqu’il décide d’offrir le merveilleux Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry à son fils Gaby qui va sur ses huit ans. Las, Tom se trompe et donne au gamin un cahier vierge ayant la même couverture. Pour sauver la situation et ne pas perdre la face, le père prétend qu’il s’agit d’un livre magique où les rêves qui y sont écrits deviennent réalité. Dès lors, Tom, totalement dépassé, tente d’exaucer les souhaits les plus extravagants de son fils. Pour son premier long-métrage reposant sur une histoire personnelle, Léa Lando signe une petit comédie française pleine de poncifs et de gentils sentiments autour d’un humoriste sur le déclin qui se voit confier la garde de son fils Gaby, à la suite du décès de la mère de ce dernier. Ahmed Sylla (L’ascension, Inséparables) campe ce père qui tente de faire bonne figure et surtout d’apporter du bonheur à un gamin (quand même passablement crédule) en maintenant l’illusion de la magie. Quitte in fine à se faire démasquer. Mais la séquence émotion est alors au rendez-vous. A mi-chemin entre le feel good movie et la comédie familiale, un film qui ne fait pas de mal mais qui ne marquera pas les mémoires. (M6)
 DOUCE NUIT, SANGLANTE NUIT 2
DOUCE NUIT, SANGLANTE NUIT 2
Après les décès de son frère Billy et de son père adoptif, Ricky, interné dans un asile psychiatrique où il coule des jours paisibles, décide de perpétuer la mission que s’était donnée son grand frère. Celui-ci, déguisé en Santa Claus, avait sauvagement massacré, le soir de Noël, des personnes qu’il considérait comme « vilaines » et décidé de retrouver la Mère supérieure qui avait traumatisé son frère lorsqu’il était enfant. Etait-il vraiment nécessaire de donner une suite au slasher réalisé en 1984 par Charles E. Sellier ? Mais lorsqu’un producteur se saisit de l’opportunité, pour remettre le couvert, que peut-on y faire… D’autant que le film n°2, mis en scène en 1987, par Lee Harry, ne se prive pas de « recycler » les meilleures scènes du n°1, histoire de raconter au spectateur ce qui s’était passé dans le premier film. Quant au personnage du jeune Ricky, il est très gravement atteint comme en témoigne son rire de dingue. Les amateurs de slasher apprécieront peut-être cette encyclopédie trash qui empile les scènes de meurtres. Douce nuit, sanglante nuit 2 sort dans une version restaurée en HD. L’édition comprend le premier film de 1984 ainsi que Douce Nuit Sanglante Nuit – la saga, un livret (24 pages) écrit par Marc Toullec. (Rimini Editions)
LE CHANTRE DES PLAISIRS SIMPLES ET LE TERRIBLE FRERE N°1 
 COFFRET OTAR IOSSELIANI
COFFRET OTAR IOSSELIANI
Avec son air de vieux monsieur malicieux, l’inclassable Otar Iosseliani a pris la tangente à 89 ans, le 17 décembre dernier à Tbilissi, dans sa Géorgie natale, laissant derrière lui une œuvre courant sur plus d’un demi-siècle et marquée par un ton inimitable et discrètement subversif. Après des études de piano, il entre à l’université de Moscou pour suivre des études de mathématiques et de mécanique. Mais il comprend vite que ce type d’études signifie, en URSS, être recruté par l’armée. Pour se dégager en douceur, il s’oriente vers des études de mise en scène à l’Institut de cinéma de l’Union soviétique et y réalise, en 1958 son premier film, Aquarelle (10 mn) où une blanchisseuse, mère de famille nombreuse, se lasse de voir son mari, ivrogne, lui voler toute sa paie… Iosseliani, c’est une lucidité implacable mais qui ne se dépare jamais d’une poésie douce et d’une humanité franche et généreuse. Toujours à juste distance, sa caméra observe les actions humaines avec une malicieuse bienveillance teintée de mélancolie, capturant l’essence de la condition humaine par son regard acéré. De ses débuts en Union soviétique à son exil en France et sa reconnaissance internationale, Otar Iosseliani, souvent décrit comme un « disciple géorgien et pince-sans-rire de Jacques Tati », se révèle comme un penseur essentiel du cinéma, dont l’intelligence, la culture et la légèreté forment un cocktail unique et inoubliable. Dans le cadre de sa belle politique d’édition, Carlotta Films présente, pour la première fois, dans un coffret de neuf Blu-ray, l’intégrale de l’oeuvre (plus de 30 heures de films) regroupant huit courts et les longs-métrages, tant de fictions que documentaires. On y trouve évidemment de grands classiques comme Pastorale (1975), volontiers considéré comme son chef d’oeuvre. L’histoire est d’une parfaite simplicité. Quatre musiciens venus de la ville passent quelques jours dans un village perdu de haute montagne afin de répéter au calme. Tout le temps que dure le film, on suit la vie du village et notamment de la famille qui héberge les musiciens. On se dispute souvent mais on fait front devant les autorités, sans hésiter à prendre des libertés avec la loi… Iossellani filme la lente disparition de la culture géorgienne. Rien d’étonnant, le film fut longtemps interdit par les censeurs soviétiques. Un musicien -percussionniste celui-là, à l’opéra de Tbilissi- on en trouve un aussi dans cet autre fleuron qu’est Il était une fois un merle chanteur (1970), une fable à l’humour tendre. Et puis il y a encore Les favoris de la lune (1984) ou La chasse aux papillons (1992) qui attestent d’une écriture unique, délicatement sophistiquée, une manière de fugue cinématographique riche d’un petit peuple attachant. Parmi les suppléments, on trouve Otar Iosseliani tourne « Lundi matin », un film documentaire de Niko Tarielashvili (54 mn) et Otar Iosseliani, le merle siffleur dans la Collection Cinéma de notre temps. Réalisatrice et adaptatrice : Julie Bertuccelli (92 mn). Enfin le coffret est accompagné d’un livre (220 p.) qui propose un panorama critique de ses œuvres, projet de film inachevé, retranscription d’un séminaire tenu par le réalisateur à Bologne en 1997. … Otar Iosseliani, l’art de la fugue ou la promesse de pénétrer au cœur de la « méthode Iosseliani ». (Carlotta)
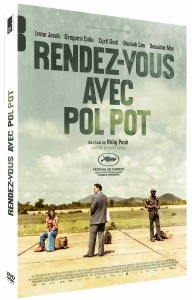 RENDEZ-VOUS AVEC POL POT
RENDEZ-VOUS AVEC POL POT
Sur la piste d’un immense aérodrome vide, quelque part dans un Cambodge devenu Kampuchéa démocratique, une femme et deux hommes attendent… Au loin, enfin, un camion chargé de miliciens s’approche. Nous sommes en 1978 et depuis trois ans, le pays, économiquement exsangue, est sous le joug de Pol Pot et de ses sinistres Khmers rouges. Lise Delbo est journaliste et Paul Thomas, reporter-photographe. Avec eux, se trouve Alain Cariou, intellectuel français, sympathisant de l’idéologie révolutionnaire et vieil ami de Pol Pot. Le trio a accepté l’invitation du régime et espère obtenir un entretien exclusif avec Frère n°1. En attendant l’hypothétique rencontre, le camarade Sung, qui s’exprime parfaitement en français, promène les visiteurs dans des ateliers où l’on peint et sculpte des statues de Pol Pot ou encore dans les champs où un paysan répond, en tremblant de tout son corps, aux questions de la presse. Tant Cariou que les journalistes comprennent très vite que la propagande est à l’oeuvre pour leur présenter une réalité très arrangée. Peu à peu, le traitement réservé aux visiteurs les inquiète et fait basculer leurs certitudes. En s’appuyant sur l’histoire vraie de deux journalistes américains (Elizabeth Becker et Richard Dudman) et d’un Britannique marxiste, Malcolm Caldwell, venus en visite au Cambodge en décembre 1978, le cinéaste franco-cambodgien Rithy Panh signe une remarquable et poignante plongée dans l’horreur du génocide perpétré par les Khmers rouges. Rithy Panh avait 11 ans quand les Khmers rouges prennent le pouvoir. Suivent presque quatre ans d’un régime sanguinaire où toute la population est envoyée dans des camps de travail. Durant ces années, où il perd ses parents et une partie de sa famille, l’adolescent est témoin des pires atrocités. Depuis ses débuts de réalisateur, Panh mène un travail de mémoire en documentant l’histoire de son pays natal et notamment le traumatisme horrible d’un génocide qui coûta la vie à deux millions de personnes. Même s’il se situe, ici, sur le terrain de la fiction (les trois Français sont incarnés par Irène Jacob, Cyril Gueï et Gregoire Colin), le cinéaste réussit pleinement à capter l’indicible. Il le fait dans une mise en scène très habile où les images classiques de la fiction se mêlent à celles d’archives mais aussi en jouant la carte de dioramas qui illustrent poétiquement les faits et gestes des personnages du récit. En suppléments, deux entretiens avec Rithy Panh et Irène Jacob. (Blaq Out)
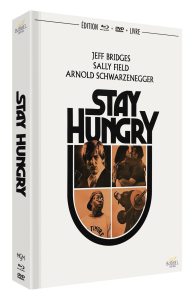 STAY HUNGRY
STAY HUNGRY
Jeune homme du Sud, Craig Blake est né avec une cuillère en argent dans la bouche… Fils de la grande bourgeoisie américaine, il vit seul et oisif dans une immense et belle demeure après la mort de ses parents dans un accident d’avion. Du côté de Birmingham, en Alabama, il passe son temps à monter à cheval, à chasser et à pêcher. Blake sert d’homme lige à des investisseurs douteux qui veulent mettre la main sur tout un quartier afin d’y bâtir un gratte-ciel. Il reste à mettre à acheter un petit club de gym. Blake est chargé de le faire. Mais le jeune homme va découvrir un univers qu’il ne connaît pas et qui l’amuse avant de le séduire. De plus, il croise sur place Joe Santo, un culturiste venu d’Autriche qui s’entraîne pour le titre de Mister Univers… Blake tombe aussi sous le charme de Mary Tate Farnsworth, la petite amie de Santo… Lorsqu’il se lance en 1976 dans le projet de Stay Hungry, le réalisateur Bob Rafelson est l’une des figures les plus emblématiques du Nouvel Hollywood, notamment pour avoir produit le très culte Easy Rider (1969) de Dennis Hopper et d’avoir mis en scène Five Easy Pieces (1970) avec Jack Nicholson. A la fin des années 70, Rafelson travaille sur un film consacré à l’esclavage en Afrique. Mais le projet est trop lourd et le cinéaste cherche quelque chose de plus joyeux qu’il va trouver dans le roman éponyme de Charles Gaines consacré aux salles de gym. Dans un temps où le business du fitness commence à prendre forme, Stay Hungry fait œuvre novatrice en montrant un monde alors peu connu, celui des culturistes. Si Rafelson embauche Jeff Bridges et Sally Field pour les rôles de Blake et Mary Tate, il va trouver en Arnold Schwarzenegger un élément de choix pour son film. A l’époque grande star du bodybuilding, l’Autrichien va entamer, avec Stay Hungry (son mantra est « Pour grandir, il faut que ça brûle ») la carrière de cinéma que l’on sait. Si Rafelson offre un beau rôle dramatique à Arnie, il réussit quelques bons portraits intimistes et des séquences remarquables comme cette réception mondaine où Joe Santo devient un phénomène de foire. Jusqu’ici inédit en Blu-ray en France, Stay Hungry sort en mediabook dans une belle édition collector en tirage limité avec différents bonus et un livre (100 p.) sur la genèse du film. Le film est proposé par le label Bubbelpop, un nouvel éditeur qui se propose de rééditer des films cultes et pop des années 70/80 dans des éditions collector prestigieuses incluant des packagings de qualité, des goodies tels que des livrets, cartes postales, mais aussi, des suppléments vidéos exclusifs réalisés par leurs propres soins. (Bubbelpop)
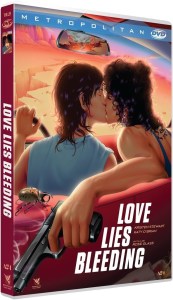 LOVE LIES BLEEDING
LOVE LIES BLEEDING
Un club de gym perdu au milieu de nulle part. Pas l’établissement BCBG mais plutôt l’entrepôt miteux. Ce qui n’empêche pas des costauds de pousser de la fonte. Frêle jeune femme, Lou gère la salle… Un soir, alors qu’elle ferme la boîte, elle remarque, sur le parking désert, Jackie, une ravissante culturiste. Immédiatement amoureuse, Lou l’invite à venir s’entraîner au club. Rapidement, les deux femmes vont être emportées dans une liaison explosive. Bientôt aussi, les ennuis commencent dans une spirale de pure violence où les morts brutales s’enchaînent. Le second long-métrage de la cinéaste anglaise Rose Glass n’y va pas avec le dos de la cuillère. Parce que les étreintes passionnées de Lou et Jackie ne seront rien à côté de l’enfer qui s’ouvre devant elles. Embauchée comme serveuse dans un club de tir, Jackie découvre que Langdon, le patron, n’est autre que le père de Lou avec lequel cette dernière est complètement en froid. Il faut dire que ce type au crâne chauve et aux longs cheveux dans le cou (le vétéran Ed Harris) est un vrai et dangereux fêlé. Tandis que Lou tente de sauver son aventure avec Jackie, celle-ci rêve de participer à un concours de body-building à Las Vegas. Love Lies… condense, dans l’Amérique de 1989, l’ambiance hot de Bound, le côté gore des films de zombies et l’atmosphère très roady de Thelma et Louise, le tout avec un traitement visuel qui puise ses références chez Cronenberg et Lynch. Katy O’Brian (Jackie) est charmante. Kristen Stewart s’empare avec force d’une Lou malmenée par les mauvais coups de la vie. Ces deux-là, malgré un scénario souvent défaillant, tiennent brillamment la baraque. Rose Glass s’interroge sur ce qu’est un personnage féminin fort, ici une bodybuildeuse mentalement et physiquement forte mais aussi exploitée et manipulée. Loufoque, disparate, inquiétant, troublant. (Metropolitan)
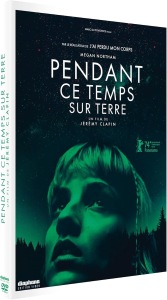 PENDANT CE TEMPS SUR LA TERRE
PENDANT CE TEMPS SUR LA TERRE
Elsa, jeune femme de 23 ans, travaille comme aide-soignante dans un EHPAD dirigé par sa mère. Une existence bien banale, sinon qu’on remarque qu’à la maison, le père de famille s’isole volontiers dans une pièce où il semble « ailleurs ». L’ambiance familiale cache un drame, puisque Franck, le frère ainé d’Elsa, a disparu trois ans plus tôt lors au cours d’une mission spatiale. Nul ne sait ce qui s’est réellement passé. Reste, pour rendre hommage à Franck, une statue le représentant au centre d’un rond-point. Dans la famille, la disparition de Franck laisse toujours un grand vide. Sans but dans la vie, Elsa, végète dans l’établissement de sa mère. Un jour, la jeune femme est contactée depuis l’espace par une forme de vie inconnue qui prétend pouvoir ramener son frère sur terre. Mais il y a un prix à payer… J’ai perdu mon corps, le premier long-métrage (2019) de Jérémy Clapin avait largement retenu l’attention, étant notamment couronné à la Semaine de la critique à Cannes. Une main coupée s’échappait du frigo d’un laboratoire pour entamer un voyage à travers la banlieue parisienne et se réunir avec son corps, un jeune homme nommé Naoufel… Ici, le réalisateur, qui se dit fasciné par l’Espace, tourne la page de l’animation pour un second « long » en prises de vues réelles autour de la relation entre une humaine et une forme de vie extraterrestre. « Ce film, dit le cinéaste, c’est le portrait d’une femme coincée entre deux mondes, celui des morts et des vivants, entre l’espoir et la résignation, entre son enfance et l’âge adulte, entre la Terre et l’Espace. C’est un film qui essaie avant tout de transmettre un sentiment, celui de n’appartenir qu’a moitié au monde. » Autour d’un deuil impossible, Jérémy Clapin invite le spectateur, sur une musique de Dan Lévy, à accompagner Elsa (Megan Northam) à travers deux univers : son parcours dans son monde intérieur, imagé, quasi inaccessible, et sa trajectoire sur terre. Troublant. (Diaphana)
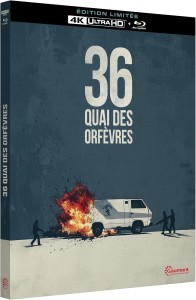 36, QUAI DES ORFEVRES
36, QUAI DES ORFEVRES
Paris. Depuis plusieurs mois, un gang de braqueurs opère en toute impunité avec une rare violence, attaquant à l’arme de guerre des transports de fonds. Proche de la retraite, Robert Mancini, le directeur de la Police Judiciaire exacerbe la concurrence entre le patron de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) et celui de la Brigade de répression du banditisme (BRB). Mancini se montre parfaitement clair avec ses deux subordonnés les plus directs : celui qui fera tomber ce gang le remplacera à son poste de « grand patron » du 36, quai des Orfèvres. Léo Vrinks, le chef de la BRI et Denis Klein, le patron de la BRB, n’hésiteront pas à user de moyens illégaux pour réussir. Deux services concurrents, deux stars de la police et un gros poste à pourvoir, tous les éléments sont réunis pour déclencher une guerre des polices. Plutôt que de reprendre la pâtisserie familiale du côté d’Oléron, Olivier Marchal a fait carrière dans la police nationale, passant par la PJ de Versailles, les renseignements généraux, section antiterrorisme, la police judiciaire du 13earrondissement de Paris avant de sauter le pas du spectacle tout en restant inspecteur la nuit à la PJ. Il quitte définitivement la police en 1994 mais celle-ci demeure omniprésente dans son œuvre de cinéma. Avec Gangsters (2002), 36 quai des Orfèvres (2004) et MR 73 (2008), il signe une trilogie, racontant, dans le second film, les affrontements entre les divas qui dirigeaient la BRB et La BRI. Sans doute Olivier Marchal a-t-il la main un peu lourde en évoquant l’atmosphère qui régnait, à une certaine époque au 36, quai des Orfèvres, mais après tout, on est au cinéma et pas dans un rapport des « boeufs-carottes ». On est tellement au cinéma que Marchal a réuni, ici, un casting de haut vol avec Daniel Auteuil (Vrinks), Gérard Depardieu (Klein), André Dussollier (Mancini) et aussi Roschdy Zem, Valeria Golino, Daniel Duval ou Mylène Demongeot. En édition Blu-ray 4K Ultra HD. (Gaumont)
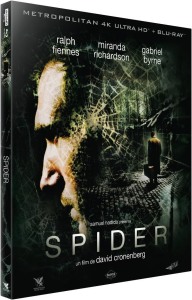 SPIDER
SPIDER
Après plusieurs années d’internement psychiatrique, Dennis Cleg, un jeune homme surnommé Spider, est transféré en foyer de réinsertion dans les faubourgs de l’est londonien. C’est à quelques rues de là qu’enfant, il a vécu le drame qui a brisé sa vie. Il n’avait pas encore douze ans, lorsque son père a tué sa mère pour la remplacer par une prostituée dont il était tombé amoureux. De retour sur les lieux du crime, Spider replonge peu à peu dans ses souvenirs et mène une étrange enquête. En 2002, entre eXistenZ (1999) et A History of Violence (2005), David Cronenberg adapte le roman éponyme de l’écrivain anglais Patrick McGrath qui signera lui-même le scénario du film. Parmi les éléments d’analyse de l’oeuvre du cinéaste canadien, la psychanalyse occupe une place importante et son influence a nourri nombre de films sondant les addictions et les phobies de la société occidentale, ainsi Vidéodrome (1983), Faux-semblants (1988), Le festin nu (1991) ou Crash (1996). Ici, Cronenberg « étudie » l’esprit d’un schizophrène. En errant sur les lieux de son enfance, en tentant de rassembler les morceaux du puzzle qu’est sa mémoire, Spider emporte le spectateur dans son monde, l’invitant à démêler le vrai du faux de sa propre réalité. Dans sa dissection d’un esprit adolescent malade, le cinéaste s’interdit le recours aux ressorts du divertissement, nous laissant le soin d’entrer, tout en lenteur contemplative, dans la tête « déraillante » du malheureux Dennis Cleg bouleversé par le complexe d’Oedipe. Si le récit est complexe, la mise en scène est brillante, pleine de subtilité et de « signes de piste ». Enfin, entouré de comédiens remarquables (Miranda Richardson et Gabriel Byrne dans le rôle des parents Cleg), Ralph Fiennes est magistral. Il ne doit pas prononcer cinq phrases de tout le film et pourtant son jeu traduit, tout en nuances, la folie qui habite le malheureux Spider. Un grand cru de Cronenberg. (Metropolitan)
 FAINEANT(E)S
FAINEANT(E)S
Amies inséparables, Nina et Djoul sont expulsées de leur squat. Elles reprennent la route à bord de leur vieux camion avec une soif de liberté et une seule obsession : faire la teuf… Ah, le monde est bien brutal pour les routardes. D’entrée, on plonge dans la violente dispersion policière d’une rave. Au fond d’un panier à salade, les deux filles se tiennent la main… Ce sont ces deux marginales que Karim Dridi, révélé par Pigalle et Bye Bye, sortis tous les deux en 1995, va suivre dans un périple aussi brinquebalant que le vieux fourgon pourri qui leur sert de demeure. Le cinéaste franco-tunisien raconte un road-movie avec des aventures, des rencontres, de sacrées galères aussi. Car l’alcool, la crasse, le blues sont au rendez-vous de ce voyage. Mais il y a aussi des moments forts et plein de pûreté, comme des instants authentiques de grâce où les regards disent le lien et les émotions. Deux comédiennes étonnantes, .jU (Djoul) et Faddo Jullian (Nina) se glissent superbement dans la peau de ces punks à chien qui aspirent, sans frein, à une liberté totale. Même si le prix à payer est bien cher. Autour de la peur, du désarroi mais aussi de la joie, Dridi signe une sombre errance en forme de mode de vie. (Blaq Out)
 TWISTERS
TWISTERS
Du temps où elle était étudiante, Kate Cooper avait été très marquée par un accident qui a tué trois de ses amis lors d’une violente tornade. Désormais, l’ancienne chasseuse de tornades préfère les étudier à New York, sans prendre de risques. Elle va cependant reprendre du service quand son ami Javi lui propose un nouvel appareil pour les détecter. Bientôt il s’agira de tenter de maitriser l’une des forces les plus destructrices de la nature : des tornades F5. En retournant sur le terrain, Kate (l’Anglaise Daisy Edgar-Jones) va croiser la route d’un insouciant chasseur vidéaste, Tyler Owens, célèbre sur les réseaux sociaux et surtout un personnage accro au danger… En 1996, on découvrait Twister mis en scène par le Hollandais Jan de Bont dans lequel Helen Hunt et Bill Paxton interprétaient des chasseurs de tempêtes à la poursuite d’une énorme tornade en Oklahoma. Deuxième film le plus rentable de 1996 aux Etats-Unis, (avec près de 55 millions d’entrées vendues sur le sol américain), Twister rapporte 495 millions de dollars dans le monde. En général, Hollywood vogue très vite sur la vague du succès. Mais, dans le cas précis, il a fallu attendre le 25e anniversaire de Twister pour voir une nouvelle version de ce film catastrophe. Etait-il bien nécessaire, comme Hollywood aime tant à la faire, de remettre, ici, une couche ? Sans doute que non mais le cinéaste coréano-américain Lee Isaac Chung (remarqué, en 2020 à Sundance avec Minari, un film évoquant sa famille s’installant dans l’Arkansas à la poursuite du rêve américain) réussit plutôt bien son coup. Certes une tornade reste une… tornade mais le film, avec des effets spéciaux très efficaces, parle globalement d’une nature qui se dérègle, générant le chaos, des pertes matérielles et surtout humaines. Les questionnements et les angoisses écologiques d’aujourd’hui sont ainsi bien présentes dans Twisters. Un film-catastrophe de qualité. (Warner)
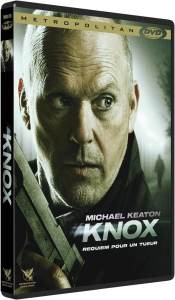 KNOX
KNOX
Tueur à gages expérimenté, John Knox apprend qu’il est atteint de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une forme de démence à évolution rapide. John a désormais de plus en plus de mal à exercer son « travail ». Lors d’un contrat, dans la confusion, il tue par erreur son partenaire et laisse de nombreux cadavres derrière lui. Il décide alors de décrocher et d’utiliser ses derniers jours pour tenter de se racheter notamment auprès de son fils, Miles, qu’il n’a pas vu depuis des années. Contre toute attente, ce dernier se présente à sa porte, blessé et les vêtements plein de sang. Miles demande de l’aide à son père et lui avoue qu’il a tué un homme… Alors que sa santé et son esprit se détériorent rapidement, Knox fait notamment appel à son vieil ami Crane (incarné par Al Pacino) qui le conseille soigneusement sur tous les aspects de ce qui doit être spécifiquement fait. Il compte également sur l’aide d’Annie, une prostituée qu’il voit tous les jeudis depuis quatre ans… Comédien connu pour ses collaborations avec Tim Burton (Beetlejuice en 1980 puis sa reprise en 2024), Michael Keaton incarne surtout Bruce Wayne/Batman dans Batman (1989) et sa suite Batman : Le Défi (1992) qui furent deux grands succès au box-office. Mais on l’a vu aussi, en pugnace journaliste d’investigation, dans Spotlight (2015) qui remporta l’Oscar du meilleur film en 2016. En 2008, Michael Keaton passait pour la première fois à la réalisation avec Killing Gentleman dans lequel il incarnait un… tueur à gages rencontrant une femme victime de violences conjugales. Avec Knox, Keaton revient donc derrière (et devant) la caméra pour un thriller à l’atmosphère tendue. Il est ce type malade qui tente de rassembler ses derniers repères. Les fans de Michael Keaton sont à la fête… (Metropolitan)
 LONGLEGS
LONGLEGS
Au FBI, l’agent Lee Harker est une nouvelle recrue talentueuse. On affecte la jeune femme (qui montre des signes de clairvoyance) sur le cas irrésolu d’un tueur en série insaisissable surnommé Longlegs (Nicolas Cage). L’enquête, aux frontières de l’occulte, se complexifie encore lorsqu’elle se découvre un lien personnel avec le tueur impitoyable qu’elle doit arrêter avant qu’il ne prenne les vies d’autres familles innocentes. En effet, dans les années 70, dans l’Oregon, Lee, alors fillette, aperçoit par la fenêtre de sa chambre un homme dans une voiture se stationner devant chez elle. Alors qu’elle sort, munie de son polaroid, l’homme, à l’allure douteuse et au teint pâle, se présente à elle et semble imprévisible. Fils de l’acteur Anthony Perkins, Osgood Perkins embarque le spectateur dans un long cauchemar qui distille d’entrée, avec une séquence d’introduction impressionnante, une solide malaise. Dans une mise en scène très soignée avec de solides déflagrations de violence, le cinéaste américain s’attache aussi à peaufiner la personnalité d’une enquêtrice isolée socialement et dont les failles vont apparaître de plus en plus fortement. Dans une atmosphère sinistre, la traque menée par Lee Harker (Maika Monroe) va prendre un tour aussi effrayant qu’onirique dans un voyage dans la part la plus sombre de l’homme. (Metrpolitan)
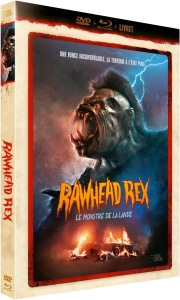 RAWHEAD REX
RAWHEAD REX
L’auteur américain Howard Hallenbeck se rend en Irlande en famille, à la recherche d’objets religieux datant d’avant le Christianisme. Au même moment, des fermiers déplacent un énorme obélisque qui trônait au milieu d’un champ, sans se douter qu’ils vont ainsi libérer une créature monstrueuse enterrée là depuis des siècles. La route de la famille Hallenbeck va alors croiser celle du monstre sanguinaire… Avant de devenir un maître de l’horreur avec entre autres Hellraiser, le romancier et cinéaste Clive Barker collabore avec le jeune réalisateur George Pavlou, qui souhaite tourner des films d’horreur, et adapte pour lui sa nouvelle Rawhead Rex. Bien que Barker s’avoue alors déçu de cette adaptation, le film est aujourd’hui un incontournable du film de monstres ! Aux éléments classiques du genre, le film ajoute des spécificités qui en font un film à part. L’action et le tournage se déroulent en Irlande, dont les paysages sauvages apportent une ambiance glauque et mystérieuse à souhait. Les scènes de nuit sont splendides, la forêt très dense fait froid dans le dos. Le scénario s’inspire de cultes anciens, impliquant notamment une déesse de la fertilité. Le monstre n’est pas juste un meurtrier sanguinaire, c’est un démon piégé depuis des millénaires dans les profondeurs de l’enfer. Entre magie blanche et magie noire (et avec son lot d’effets gore), l’histoire mélange habilement occultisme, religion et culture celte, pour une approche très british du fantastique. Entre éviscérations, décapitations, morsures fatales et corps étripés, Rawhead Rex n’a aucune pitié et n’épargne pas même les enfants ! Un film qui vaut le coup d’œil, sa créature étant l’une des plus kitsch du cinéma d’horreur. (Rimini Editions)
LE ROAD MOVIE DE WENDERS ET ROGER THORNHILL SUR UNE ROUTE DESERTIQUE 
 PARIS TEXAS
PARIS TEXAS
Comme poussé par une idée fixe, Travis Henderson marche, seul et hagard, dans le désert du Texas. Il cherche sans succès de l’eau, arrive finalement dans un bar isolé et y perd connaissance. Il est recueilli par un médecin qui trouve sur lui une carte avec le numéro de téléphone de son frère, Walt Henderson. Celui-ci fait le trajet depuis Los Angeles pour le retrouver. Travis n’avait plus donné signe de vie depuis quatre ans, laissant derrière lui sa femme et son petit garçon… Malgré leurs retrouvailles, Travis ne dit rien, ne mange pas et ne dort pas. Il refuse de prendre l’avion pour retourner à Los Angeles, ce qui oblige son frère et lui à faire tout le trajet en voiture. Ce n’est que progressivement qu’il retrouve l’usage de la parole. Lorsque son frère lui demande où il espérait aller en errant dans le désert, Travis répond enfin qu’il comptait se rendre à Paris, au Texas, où ses parents s’étaient connus et l’auraient conçu. Son père aimait d’ailleurs plaisanter en disant « J’ai connu ma femme à Paris ». Dans la magnifique collection de ses coffrets Ultra collector, Carlotta a fait la part belle récemment à L’empire des sens d’Oshima, Les ailes du désir de Wenders, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper ou La comtesse aux pieds nus de Mankiewicz. Wim Wenders est de retour, pour le numéro #28 marqué par un visuel exclusif de la plasticienne américaine Sister Hyde, dans cette collection avec son Paris, Texas, Palme d’or à l’unanimité au Festival de Cannes 1984. Il signe un road movie anticonformiste, étourdissant de beauté et d’émotion. Le jeu exceptionnel de Harry Dean Stanton et de Nastassja Kinski dans ce qui est probablement son plus beau rôle, le scénario magistral de Sam Shepard, la sublime photographie de Robby Müller et la bande originale ensorcelante de Ry Cooder, tout concourt à donner à Paris Texas son statut de film culte à l’aura indépassable. Pour son 40e anniversaire, le film est disponible pour la première fois en Blu-ray dans une nouvelle restauration 4K de la Wim Wenders Stiftung, supervisée par Donata et Wim Wenders. Outre les abondants suppléments, traditionnels dans l’ultra collector (introduction de Wim Wenders, deux entretiens avec le cinéaste, l’un sur l’aventure du film, l’autre, à Cannes 2024, sur la restauration de Paris, Texas ; scènes coupées (24 mn) ; l’émission Cinéma, Cinémas de 1984 où Wenders parle de sa passion pour le rock et de sa joie d’avoir collaboré avec Ry Cooder et Sam Shepard ; enfin un film (7 mn) : Souvenirs de la famille Henderson immortalisés en Super 8), le coffret contient Quitter l’autoroute sous-titré Paris Texas de Wim Wenders, un livre (200 pages, incluant deux cahiers de photographies exclusives) qui donne la parole au cinéaste et à son équipe à travers une série d’entretiens menés en 1984 et en 2024, avant de proposer le scénario de la version finale du film, incluant les dialogues originaux de Sam Shepard. Un ouvrage inédit qui rend hommage à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation du film, de sa production à sa récente restauration. De la belle ouvrage! (Carlotta)
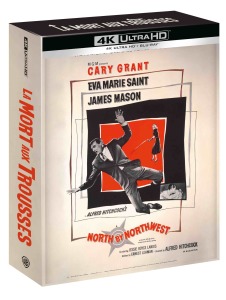 LA MORT AUX TROUSSES
LA MORT AUX TROUSSES
Patron d’une société de publicité new-yorkaise, Roger Thornhill a un rendez-vous d’affaires au Plaza Hotel. Mais, victime d’un malentendu, il est enlevé par des hommes qui le prennent pour un certain George Kaplan. Thornhill est conduit à Glen Cove dans la belle demeure de M. Townsend. Persuadé d’avoir enlevé George Kaplan, Townsend cherche à obtenir de lui des renseignements. Refusant de coopérer, Thornhill, saoûlé par les sbires de Townsend, se retrouve dans une voiture sur une route de bord de mer surplombant une falaise… En 1959, dans la foulée de Sueurs froides (1958) et avant Psychose (1960), c’est un Alfred Hitchcock au meilleur de sa forme qui réalise l’un de ses films les plus fameux et qui ressort, ici, dans une version Blu-ray 4K Ultra HD. On se replonge, avec un bonheur toujours égal, dans ce thriller brillant et enlevé autour d’un pur leurre. Car Georges Kaplan n’existe pas. Ce supposé espion est un fantôme inventé de toutes pièces pour piéger d’autres espions. Et c’est le malheureux Thornhill qui lui donne une sorte de réalité dans une course folle qui, entre kidnapping et meurtres à répétition, ne cesse jamais. Tout, ici, fonctionne à merveille : le scénario, les acteurs, les décors et évidemment la mise en scène. North by Northwest (en v.o.), ce sont des moments d’anthologie comme la fuite sur les falaises du mont Rushmore sous les visages des présidents Jefferson, Roosevelt ou Lincoln ou encore le mythique chassé-croisé en rase campagne entre Thornhill et un avion très menaçant. Il y a aussi la musique de Bernard Herrmann et le beau duo composé de Cary Grant et Eva Maria Saint. Avec un Hitch croquignolet qui, dans la dernière séquence, montre les deux « désormais fiancés » rentrant à New York en wagon-lit, s’apprêtant à s’allonger sur leur couchette avec un dernier plan du train qui entre dans un tunnel… (Warner)
 LE COMTE DE MONTE-CRISTO
LE COMTE DE MONTE-CRISTO
Marin en Méditerranée, Edmond Dantès, n’écoutant que son courage et contre les ordres de son capitaine, sauve une naufragée nommée Angèle, porteuse d’une lettre de Napoléon… Le capitaine Danglars la lui dérobe. Viré par son armateur pour avoir manqué à son devoir, Danglars doit laisser la place à Dantès. Edmond revoit la belle Mercédès de Morcerf qu’il espère épouser. Las, le jour des noces, Dantès est arrêté et accusé de bonapartisme… Il a beau clamer son innocence, il se retrouve bientôt dans un cul-de-basse-fosse au château d’If. Avec Le comte de Monte-Cristo, les producteurs Dimitri Rassam et Ardavan Safaee poursuivaient leur quête de Dumas en trouvant l’occasion de porter au grand écran, un vengeur masqué aux allures de héros contemporain. Déjà dans le coup du diptyque des Trois mousquetaires comme scénaristes, Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte endossent, cette fois, la casquette de réalisateurs pour mêler aventure et thriller sur fond de grande histoire d’amour. Après de nombreux autres cinéastes, le tandem De la Patellière/Delaporte puise dans un riche matériau littéraire, de quoi alimenter une épopée de trois heures sans épuiser toutes les péripéties d’un énorme roman. Alors on retrouve bien sûr les geôles du château d’If, la rencontre avec l’abbé Faria, la découverte du trésor des Templiers sur l’île de Montecristo, la transformation d’Edmond Dantès en mystérieux et inquiétant personnage dont l’immense fortune lui permet de peaufiner une terrible vengeance. Travaillant une image volontiers en clair-obscur, les cinéastes développent donc essentiellement le thème de l’implacable vengeance d’un homme blessé qui va punir méthodiquement un sacré trio de traîtres doublés de crapules. Dantès (incarné par un Pierre Niney crédible) pense que sa rédemption est impossible mais il lance quand même à une Mercédès (Anaïs Demoustier) toujours amoureuse, ces derniers mots : « Attendre et espérer ». (Pathé)
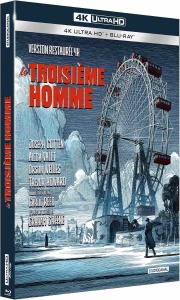 LE TROISIEME HOMME
LE TROISIEME HOMME
Très modeste écrivain américain, Holly Martins débarque dans la Vienne dévastée de l’après-guerre. Il recherche son vieil ami Harry Lime mais celui-ci vient d’être écrasé par une voiture dans les rues de la capitale autrichienne découpée en quatre zones occupées par les Alliés. Martins choisit alors de mener sa propre enquête pour démasquer les assassins de son ami. Mais, rapidement, dans une ville qui semble être devenue capitale du marché noir, l’Américain comprend que Lime était mêlé à des activités peu recommandables. La police anglaise le recherche spécifiquement pour trafic de péniciline. Autour de Martins, tout le monde semble à la limite de la légalité s’il s’agit de survivre. La fin justifie donc les moyens… Ecrit par Graham Greene, Le troisième homme (1949) est certainement le film le plus connu du Britannique Carol Reed qui signa aussi, et entre autres, une bonne adaptation de Greene avec Notre agent à La Havane (1959). Sa célébrité est notamment due à son thème musical composé et interprété à la cithare par Anton Karas que le cinéaste avait repéré par hasard dans une taverne proche de la Grande roue du Prater. D’ailleurs Le troisième homme vaut aussi pour l’utilisation qui est faite par Reed des endroits célèbres de Vienne comme le Prater, l’hôtel Sacher, le café Mozart, le palais Pallavicini ou encore le cimetière central. Une bonne partie des séquences tournées dans les égouts l’ont été en studio. Pour repérer celles réalisées dans les vrais égouts, il faut observer la buée qui sort de la bouche des comédiens. L’Office du tourisme de Vienne organise toujours des visites guidées « spécial Troisième homme » ! Film d’espionnage, film noir, thriller, Le troisième homme est tout cela. Si Joseph Cotten campe un Holly Martins qui ne comprend rien à rien, toujours balloté par les événements et manipulé par les uns et les autres, on se souvient bien de l’apparition, dans un rayon de lumière, du grand Orson Welles, le mystérieux et cynique Harry Lime qui dira : « En Italie, pendant trente ans, sous les Borgia, ils ont eu la guerre, la terreur, le meurtre, les effusions de sang, et ils ont produit Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. En Suisse, ils ont eu l’amour fraternel, cinq cents ans de démocratie et de paix, et qu’est-ce que cela a donné…? La pendule à coucou ». Un classique (en Blu-ray 4K Ultra HD) remarquablement écrit qui obtint à Cannes 1949 le Grand prix, ancêtre de la Palme d’or. (Studiocanal)
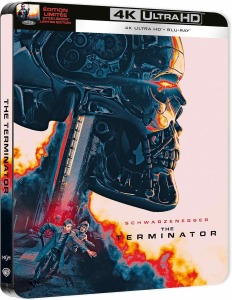 TERMINATOR
TERMINATOR
En 2029, une guerre oppose ce qui reste de l’humanité, anéantie par un holocauste nucléaire, aux machines dirigées par Skynet, un système informatique contrôlé par une intelligence artificielle et qui a pour objectif d’imposer la suprématie des machines sur les hommes. La résistance humaine, menée par John Connor, étant sur le point de triompher en 2029, Skynet envoie dans le passé, en 1984, un Terminator T-800, assassin cybernétique à l’apparence humaine, afin de tuer la mère de John, Sarah Connor (Linda Hamilton), et ainsi d’empêcher la naissance de John, « effaçant » de manière rétroactive son existence et ses actes futurs. En réaction, John envoie à la même époque Kyle Reese (Michael Biehn), un résistant humain, afin de protéger sa mère. Le Terminator de James Cameron, sorti dans les salles en 1984, est tout simplement devenu un classique de la science-fiction made in Hollywood en traitant du voyage dans le temps et de la menace que pourraient faire naitre des robots créés par une superintelligence issue de la singularité technologique. Si son succès n’était pas « garanti » avant sa sortie en salles, le film qui lança définitivement la carrière de James Cameron rencontra cependant un large public. Et les héritages se mirent à fleurir avec un n°2, toujours signé Cameron puis quatre suites moins passionnantes mais aussi une série télé ou des gammes de jeux vidéo. Le vrai bonheur dans cet univers en voie de robotisation, c’est de voir Arnold Schwarzenegger à l’oeuvre, fonçant à travers Los Angeles sur sa moto et arrosant alentour, le masque imperturbable, des pruneaux, façon machine à tuer parfaitement incassable. Arnie sortait de Conan le barbare (1982) et n’était pas plus enthousiaste que cela à l’idée de jouer dans le film. Pour sa part, le cinéaste n’était pas convaincu non plus par l’ex-culturiste autrichien. Mais la magie du cinéma a opéré ! Et Arnold Schwarzenegger sera Terminator for ever tout en y gagnant un statut de mégastar. En steelbook 4K Ultra HD. (Warner)
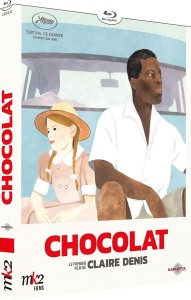 CHOCOLAT
CHOCOLAT
Une belle jeune femme marche sur une plage… Entre mer et palmiers, le paysage est idyllique. Mais France n’est pas en vacances au Cameroun. Embarquée dans une voiture par un Américain noir (qui dit ne pas se sentir chez lui dans le pays) et son jeune fils, elle tarde un peu avant de se décider à revenir dans les pas de son enfance africaine. Née à Paris parce que sa mère voulait accoucher en France, Claire Denis retourne à l’âge de deux mois en Afrique. Elle y grandit et fait sa scolarité primaire dans les écoles mixtes, notamment au Cameroun, en Somalie, en Haute-Volta et à Djibouti. Son père, administrateur civil travaillant dans les colonies françaises d’Afrique, présentait à ses enfants l’indépendance comme une chose positive pour les pays africains. Claire Denis sera assistante réalisatrice de Robert Enrico, Jacques Rivette, Jim Jarmush ou Wim Wenders pour Paris Texas et Les ailes du désir. Poussée par le cinéaste allemand, elle passe à la réalisation en 1988 avec l’histoire d’un couple de Blancs parmi les Noirs peu de temps avant l’indépendance du Cameroun. Une vie perturbée par les passagers d’un avion en perdition qui se pose en pleine brousse, à Mindif, où le commandant Marc Dalens est responsable militaire… Dans une approche assez contemplative, Claire Denis invite à une plongée (très bien écrite et montée) dans le passé à travers son personnage de petite fille observant son père (François Cluzet), sa mère (l’Italienne Giulia Boschi) et Protée, le boy de la famille (Isaach de Bankolé) qui souffre en silence de la situation de son peuple et avec lequel France a lié un pacte quasi-magique. Autour d’eux gravitent différents personnages haut en couleurs comme un planteur de café qui se croit tout permis, un étrange prêtre, un cuisinier qui ne parle qu’anglais ou Luc qui veut briser les tabous en se rapprochant des Noirs… Présenté en compétition au Festival de Cannes 1988, Chocolat annonce l’arrivée d’une sensibilité singulière sur la scène cinématographique française. Ce premier film remarquable préfigure toute l’oeuvre de Claire Denis : son style cérébral et sensuel (Trouble Every Day), sa remarquable direction d’acteurs (Beau travail) et son goût pour les cultures métissées (White Material). Dans les suppléments, un entretien avec la cinéaste sur la genèse de son film. (Carlotta)
 LE MOINE ET LE FUSIL
LE MOINE ET LE FUSIL
En 2006, le Bhoutan s’ouvre à la modernisation et découvre Internet, la télévision… et la démocratie. Pour apprendre à son peuple à voter, le gouvernement organise des « élections blanches ». Mais dans le pays du Bonheur National Brut, où la religion et le Roi importent plus que la politique, les habitants semblent peu motivés. Cependant, dans une province montagneuse reculée, un moine décide d’organiser une mystérieuse cérémonie le jour du vote et charge l’un de ses disciples de trouver un fusil… Au même moment, un Américain considéré par les autorités internationales comme un trafiquant d’armes, est sur place à la recherche d’un fusil de collection : une arme datant de la guerre de Sécession. Au grand étonnement de ses concitoyens, le roi du Bhoutan annonce qu’il va se retirer du pouvoir pour permettre à son pays d’accéder à la démocratie. Le peuple doit donc se préparer à de prochaines élections. Un système tellement méconnu des citoyens que le gouvernement envoie des délégués sillonner le pays pour apprendre aux uns et aux autres à voter. Le ton est donné, car il apparait que l’immense majorité des habitants ne voit pas l’intérêt de ces élections, puisque semble-t-il, tout va bien pour eux avec un système qu’ils connaissent et qui leur convient. En incitant les uns et les autres à afficher et défendre des convictions, on risque de faire émerger des divergences. Cinéaste et photographe bhoutanais, Pawo Choyning Dorji a été remarqué en 2022 lors de la sortie en France de son premier long-métrage, L’école du bout du monde (2019). Ici, il filme à nouveau son pays et ses habitants pour mettre en valeur, sans esbroufe, de magnifiques paysages et faire surtout sentir les conditions de vie ainsi que la mentalité des gens du Bhoutan dont la manière simple d’aborder la vie est impressionnante. Avec la télévision et Internet, ces hommes, ces femmes et ces enfants peuvent devenir des cibles peu méfiantes face à la consommation à l’oeuvre dans la société moderne. Ces gens découvrent le Coca et observent, fascinés, à la télévision, Daniel Craig incarnant 007 dans Quantum of Solace. Pawo Choyning Dorji s’interroge, tout en finesse, sur la démocratie et ses effets pervers. Comment accéder au bonheur ? Faut-il pour cela que les individus s’opposent entre eux ? Une belle fable sur la perte d’une certaine innocence. (Pyramide)
 LES MISERABLES
LES MISERABLES
« Ma conviction est que ce livre sera un des principaux sommets, sinon le principal, de mon œuvre » écrivait Victor Hugo à son éditeur parisien en 1862. L’écrivain ne s’était pas trompé. Les misérables est une histoire universelle de référence traversant le temps et les frontières et évidemment une inépuisable source d’inspiration pour le cinéma. On recense aujourd’hui plus d’une cinquantaine d’adaptations du best-seller du 18e siècle sur grand et petit écran. Dixième adaptation cinématographique du chef-d’œuvre d’Hugo, Les misérables de Jean-Paul Le Chanois (qui ressort dans deux beaux coffrets dvd et Blu-ray en édition restaurée) est aussi l’une des plus célèbres. Très fidèle à l’œuvre littéraire, le film doit son adaptation au travail de l’écrivain, dialoguiste et scénariste, René Barjavel. Sorti en 1958 sur les écrans, le film est divisé en deux époques et réunit les plus grandes stars du cinéma français de l’époque : Jean Gabin, Bernard Blier, Bourvil, Danièle Delorme, Serge Reggiani, Fernand Ledoux dans l’histoire fameuse de Jean Valjean qui, en 1818, parvient à s’évader du bagne de Toulon après vingt ans de travaux forcés. Injustement condamné, Valjean est de retour et il n’aspire qu’à la tranquillité et au bonheur. Son destin bascule avec la rencontre de l’évêque de Digne, Mgr Myriel. Tendre et humaniste, Jean Gabin est un Jean Valjean bouleversant. Le méchant bistrotier, Thénardier, est incarné par Bourvil qui fait preuve d’une veulerie incomparable. Bernard Blier est un Javert inflexible et complexe, il prouve qu’il est un immense comédien capable de jouer tous les registres. Le Chanois (qui a signé, en 1954, son plus grand succès, Papa, maman, la bonne et moi, une comédie de mœurs sur la famille française type) donne un régal visuel pour cette fresque cinématographique. Comme l’a dit le cinéaste, son adaptation de Victor Hugo « n’est pas un film historique mais on y voit de l’histoire. Ce n’est pas non plus un film de reconstitution mais on y voit le Paris d’autrefois. Enfin, ce n’est pas un film colorié, comme la mode s’en était répandue, mais bien un film où la couleur apporte ses éléments indispensables ainsi que le Technirama, ce procédé d’écran large qui permet d’assurer une netteté exemplaire sur tous les plans. » Véritable prouesse technique pour l’époque. Les misérables, champion du box-office en France en 1958, connut un immense succès populaire avec presque 8 millions d’entrées. (Pathé)
 JEUX INTERDITS
JEUX INTERDITS
Au cours de l’exode de juin 1940 en France, un convoi de civils est bombardé et mitraillé par des avions allemands. Paulette, cinq ans, perd ses parents et se met à errer dans la campagne. Dans les bois, elle rencontre Michel Dollé, un garçon de dix ans, qui l’emmène vivre dans la ferme de ses parents. Réticent au début, le père de Michel accepte l’arrivée de Paulette, plus par peur que les Gouard, ses voisins et ennemis jurés, le fassent et en tirent une quelconque gloire, que par charité. Paulette enterre discrètement le petit chien, mais Michel devine rapidement son geste, et à deux ils se mettent à créer des sépultures pour tous les animaux morts qu’ils découvrent : rats, crapauds, poussins. Michel en vient à tuer des animaux pour rassurer Paulette. On a tous entendu des débutants travailler leur guitare en grattant le thème de Jeux interdits écrit par Narciso Yepes. Mais c’est évidemment très court de ramener le film écrit en 1952 par René Clément à ce (très) célèbre morceau de musique. De fait, trois ans avant Charles Laughton et sa fameuse Nuit du chasseur (1955), le cinéaste français plonge dans l’imaginaire de l’enfance en distillant d’impressionnantes images oniriques. Dès son ouverture, Jeux interdits entraîne, avec une brutalité voulue, le spectateur dans l’horreur de la guerre avec une population jetée sur les routes et affolée par la puissance militaire ennemie. Des malheureux errant jusqu’à la mort. Parmi eux, une fillette rescapée et serrant dans ses bras le cadavre de son chien. De l’atrocité inaugurale de cette vision guerrière, le film va glisser vers un monde plus apaisé lorsque Paulette rencontre la famille d’accueil et surtout découvre Michel et son monde. Ecrit par Jean Aurenche et Pierre Bost, grands scénaristes français des années 30-40, le film de René Clément, d’abord conçu comme un sketch destiné à un film sur les enfants et la guerre, va s’imposer comme un immense succès qui vaudra au réalisateur le Lion d’or à la Mostra de Venise 1952 et un Oscar du meilleur film étranger à Hollywood en 1953. Si on peut reprocher au film (qui ressort dans une version restaurée 4K) une vision passablement caricaturale de la France profonde et paysanne, Jeux interdits séduit et émeut par le jeux des enfants. Si Georges Poujouly semble parfois réciter ses répliques, Brigitte Fossey, petite fille blonde de 5 ans, est parfaite de simplicité naïve et de grâce tragique. (Studiocanal)
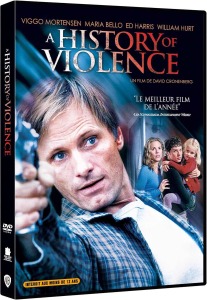 A HISTORY OF VIOLENCE
A HISTORY OF VIOLENCE
Citoyen paisible de la petite ville de Millbrook dans l’Indiana, bon père et bon mari, Tom Stall est patron d’un petit coffee shop. Un soir, deux tueurs complètement barrés font irruption dans son établissement, s’apprêtant à commettre un massacre. En quelques fractions de secondes, Stall les abat avec une dextérité surprenante. Le fait divers fait la une des médias, la fierté de sa famille et propulse Stall, à son corps défendant, au rang de célébrité locale et nationale. Alors qu’il tente de retrouver une vie normale, un mafieux partiellement défiguré, répondant au nom de Fogarty, débarque dans son petit restaurant et l’appelle par un autre nom : Joey. Fogarty et ses complices prennent en effet Tom, qu’ils ont vu récemment à la télévision, pour un de leurs anciens adversaires. Peu à peu l’épouse et le fils de Tom se rendent à l’évidence : Tom a été Joey dans une autre vie, à Philadelphie, auprès de son frère, à la tête d’un gang. Trois principaux thèmes imprègnent le cinéma de David Cronenberg: l’étude du corps humain sous un aspect angoissant à l’instar de La mouche (1986) ou Faux semblants (1988); l’observation visionnaire du rapport de l’humain à la technologie (Crash, 1996) et le délitement de la société. A History of Violence, réalisé en 2005, fable sur la violence refoulée, s’inscrit pleinement dans ce dernier thème. On découvre un couple marié avec deux enfants essayant de mener une vie droite, honnête, épanouie. « Derrière ce thème principal, note le cinéaste, se profilent pourtant des choses beaucoup plus troublantes, dérangeantes. C’est un thriller intéressant parce qu’atypique. On peut le prendre à plusieurs niveaux, les enjeux ne sont pas aussi basiques que l’intrigue principale peut le laisser supposer. » Avec un petit côté Hitchcock pour l’innocent pris pour un autre par des gens effrayants, le film de Cronenberg distille à merveille le trouble (Tom et sa femme se conduisent comme des collégiens énamourés) et fait affleurer la figure de ces monstres glaçants qui traversent son cinéma. Maria Bello (l’épouse de Tom) a quelques scènes bien hot. Le toujours excellent Viggo Mortensen (que Cronenberg retrouvera en 2077 pour Les promesses de l’ombre) incarne parfaitement le type bien sous tous rapports… jusqu’à ce que le vernis craque. Avec Cronenberg, il ne faut jamais se fier aux apparences. (Warner)
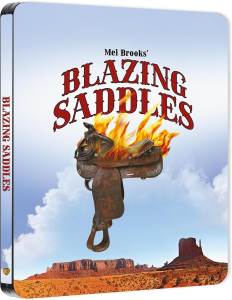 LE SHERIF EST EN PRISON
LE SHERIF EST EN PRISON
A cause de sables mouvants, la réalisation d’une ligne de chemin de fer dans les Etats-Unis de 1874 est remise en cause. Le changement d’itinéraire fait que la ligne pourrait passer par Rock Ridge, une ville frontière où tous les habitants portent le même nom, Johnson. Le procureur général Hedley Lamarr veut racheter à bas prix les terrains prévus pour la construction. Pour y parvenir, il tente de chasser les habitants de leur ville. Ainsi, pour leur faire peur, il envoie une bande d’affreux dirigée par le crétin Taggar. La population de Rock Ridge demande au gouverneur de leur affecter un nouveau shérif. Le gouverneur se laisse persuader par Lamarr de choisir, pour cette fonction, Bart, un Afro-Américain et ouvrier à la construction des chemins de fer. En 1974, avec Blazing Saddles (en v.o.), Mel Brooks atteint certainement le meilleur de son cinéma. Après Les producteurs (1968) et Frankenstein Junior (1974), le New-yorkais, âgé aujourd’hui de 98 ans, réussit, sur une thématique westernienne, un festival de loufoquerie centré autour de l’humour juif. Si le film tourne autour de Bart (Cleavon Little), shérif d’une ville en état de siège, on se régale de la prestation de Gene Wilder, vieux complice de Brooks, qui incarne Waco Kid, un as de la gâchette devenu alcoolique qui assure : « A moi tout seul j’ai tué plus d’hommes que Cecil B. DeMille » ! Pour le reste, on trouve, ici, des belligérants qui décident de quitter leur plateau de tournage pour aller semer le trouble sur le tournage d’une comédie musicale avant que le tout dégénère en bataille de tartes à la crème. Pour faire bonne mesure et volontiers à la limite du bon goût, Brooks (qui joue à la fois le gouverneur et le chef des Indiens) saupoudre son film de casques à pointe, de petites vieilles racistes, de chanteuses teutonnes et de canards de bain. A ce jeu, Madeline Kahn, autre copine du cinéaste, se régale avec la Teutonic Titwillow, la bien nommée Lili von Schtupp. A sa sortie, cette folle et burlesque parodie connut un succès impressionnant. Elle ressort dans une belle version restaurée. Et on se gondole toujours autant. (Warner)
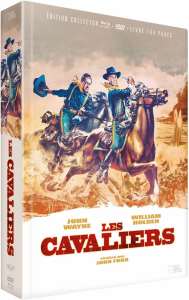 LES CAVALIERS
LES CAVALIERS
En pleine guerre de Sécession, un détachement de cavalerie nordiste, sous les ordres du colonel Marlowe, est envoyé derrière les lignes ennemies, pour détruire les voies de chemin de fer. À ses côtés, le major Kendall, le médecin militaire auquel Marlowe s’oppose régulièrement. Les deux hommes sont aussi contraints d’emmener avec eux Hannah Hunter, une aristocrate sudiste, qui pourrait menacer le succès du raid de sabotage. Après maintes péripéties, ils arrivent à saboter la principale voie ferrée, à brûler train et coton. Poursuivis par les Sudistes, il font tout pour leur échapper… « Je n’ai jamais de ma vie rencontré un homme qui en savait autant sur la guerre de Sécession que Ford » affirme William H. Clothier, le directeur de photographie de The Horse Soldiers. Si Ford a déjà abordé la thème de la guerre de Sécession dans son cinéma, il faut attendre la fin de sa carrière pour que le réalisateur de La prisonnière du désert, consacre, ici, en 1959, tout un film à ce terrible conflit fratricide. Adapté du roman éponyme d’Harold Sinclair, lui-même basé sur un fait réel, Les cavaliers, charge vigoureuse contre la guerre, est une œuvre à l’atmosphère sombre et oppressante et, pour tout dire, assez mélancolique. Souvent considéré comme un film mineur de Ford, Les cavaliers, marqué par des problèmes de production et la mort accidentelle d’un cascadeur, est pourtant un grand film sur les horreurs de la guerre. Dans sa mise en scène, dans le travail sur les paysages, les couleurs, le traitement du cinémascope, le film atteint le niveau des grands westerns mythiques de Ford. Enfin, entouré notamment de William Holden et de Constance Towers, John Wayne retrouve à nouveau son réalisateur-fétiche pour un personnage de militaire désabusé et tourmenté. Ensemble, ils tourneront encore deux films, et non des moindres : L’homme qui tua Liberty Valance (1962) et La taverne de l’Irlandais (1963). Remastérisé HD, Les cavaliers sort dans une belle édition médiabook collector Blu-Ray et dvd avec un livre (184 p.) retraçant les 50 ans de carrière de Ford, le tout accompagné de plus de trois heures de bonus. (Rimini éditions)
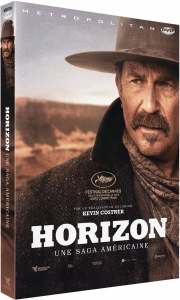 HORIZON : UNE SAGA AMERICAINE, CHAPITRE 1
HORIZON : UNE SAGA AMERICAINE, CHAPITRE 1
En 1859, dans la vallée de San Pedro en Arizona, des arpenteurs marquent avec des piquets les frontières d’une prochaine ville, Horizon. Peu de temps après, Desmarais, un missionnaire qui cherche Horizon découvre l’équipe d’arpentage tuée par une bande d’Apaches. Il enterre leurs corps et fonde la ville d’Horizon. En 1863, des pionniers installés dans un Horizon florissant est attaqué par un raid indien mené par Pionsenay. La majorité des habitants est tuée. Le jeune Russell Ganz s’enfuit à cheval pendant le carnage et rejoint le Camp Gallant pour prévenir l’armée. Un détachement mené par le lieutenant Trent Gephardt vient porter secours aux survivants, dont font partie Frances Kittredge et sa fille Elizabeth qui partent avec l’armée pour chercher refuge au Camp Gallant. Au même moment, Russell rejoint un groupe dirigé par son compatriote survivant Elias Janney et le chasseur de scalps Tracker pour s’en prendre aux Apaches… Pour son retour à la réalisation, bien des années après le western Open Range (2003), Kevin Costner avait un projet plutôt colossal, raconter en quatre films pour une durée de près de dix heures, les grandes heures de l’Ouest américain avant et après la guerre de Sécession, une époque pleine de bruit et de fureur, de périls et d’aventures, de lutte avec la nature sauvage et de combats colonisateurs contre les peuples autochtones. Une entreprise d’autant plus ambitieuse qu’on dit et qu’on répète, dans le monde du cinéma, que le western a définitivement vécu. Ce qui reste encore à prouver. Pour l’heure, on ignore si la saga dans son ensemble verra le jour mais le chapitre 1 au eu les honneurs, hors compétition, du dernier Festival de Cannes. Et Kevin Costner, boosté par le succès de la série Yellowstone, s’est lancé dans une sacrée entreprise. Son film hors-normes multiplie les histoires, joue sur les points de vue, détaille des trajectoires et des destinées en s’appuyant sur une imposante brochette d’acteurs : Sienna Miller, Sam Worthington, Danny Huston, Will Patton, Jena Malone, Luke Wilson et Kevin Costner lui-même dans le rôle du marchand de chevaux Hayes Ellison. Cette chronique chorale de l’Ouest américain est rattrapée malheureusement par une certaine démesure. Mais l’homme de Danse avec les loups bataille toujours pour ce genre mythique qu’est le western. Pour cela, on l’apprécie. (Metropolitan)
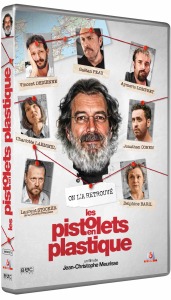 LES PISTOLETS EN PLASTIQUE
LES PISTOLETS EN PLASTIQUE
Léa et Christine sont obsédées par l’affaire Paul Bernardin, un homme soupçonné d’avoir tué toute sa famille et disparu mystérieusement. Alors qu’elles partent enquêter dans la maison où a eu lieu la tuerie, les médias annoncent que Paul Bernardin vient d’être arrêté dans le Nord de l’Europe… Metteur en scène de théâtre avec la compagnie Les chiens de Navarre, Jean-Christophe Meurisse réalise, avec Les pistolets en plastique, son troisième long-métrage de cinéma après Apnée (2016) et Oranges sanguines (2021). Une œuvre marquée par la fantaisie et l’humour. « C’est ce que j’aime : le mélange, dit le cinéaste. Ce que je n’aime pas : rester dans un registre unique. Je veux que tout soit tendu, aussi bien dans la narration que dans la forme. On ne sait pas sur quel pied danser. On va de l’absurde à l’horreur, on est dans le rire du pire, entre tragédie et comédie de manière permanente. » Les pistolets en plastique s’inspire, sans s’en cacher, de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès en évoquant au passage, l’affreuse mésaventure du malheureux pris à l’aéroport de Glasgow pour le type recherché par toutes les polices. Cependant, il n’est pas question, ici, de biopic mais bien de monstres. « J’aime montrer les monstres, dit le réalisateur. Ma naïve utopie, c’est que plus on montre le mal au cinéma, moins il y en a dehors. » Des monstres, le film en montre une belle brochette et s’ouvre sur deux médecins légistes devisant tranquillement, lors d’une autopsie, sur le goût des gens pour les faits divers atroces… Avec une belle brochette de comédiens, Meurisse, avec un côté jubilatoire autant qu’effrayant, décrit la mécanique folle et absurde du monde. Le portrait satirique de notre société est drôlement cruel. Mais quand on entend de méprisables personnages proférer de parfaites horreurs, on se dit que la fiction est en-dessous de la réalité. (M6)
 ELYAS
ELYAS
Ancien soldat des forces spéciales, Elyas est revenu très traumatisé des combats en Afhghanistan. Luttant contre son stress post-traumatique, il est de retour dans la vie civile et accepte d’assurer la sécurité d’Amina et de sa fille Nour qui ont fui les Émirats arabes unis et trouvé refuge dans un château français. Bientôt, un commando retrouve Amina et Nour, Elyas redevient le soldat qu’il fut afin de les protéger. Ils ne sont pas si nombreux que cela dans le cinéma français, les bons réalisateurs de films d’action. Le Mosellan Florent-Emilio Siri est de ceux-là. On remonte volontiers à 2002 et à Nid de guêpes dont l’action se situait à Strasbourg autour d’un casse dans un entrepôt abritant du matériel informatique en parallèle avec le transfèrement d’un mafieux albanais qui tourne au vinaigre. Le film attire d’ailleurs l’attention de Bruce Willis qui demande au Français de venir le mettre en scène dans Otage (2005). Après un passage par le biopic de Claude François (Cloclo en 2012 avec Jérémie Rénier), Siri est de retour à l’action. L’amateur n’est pas déçu car le cinéaste n’a pas perdu la main. Son thriller va au rythme de fusillades et d’explosion de violence qui montent vers un dénouement brutal qui n’aurait pas déparé dans une production américaine. Le vétéran de l’armée est désormais contraint à un job civil qui le laisse amer mais Elyas s’acquitte, avec efficacité, de sa tâche, allant jusqu’à se prendre d’affection pour la fillette qu’il est chargé de protéger contre de sévères affreux. Des talibans ? L’excellent Roschdy Zem s’empare avec aisance de ce vieux briscard aussi déterminé que mutique mais bien incapable de s’intégrer dans une vie normale. Une bonne série B. (Studiocanal)
LES FEMMES DE TRUFFAUT, MARIA SCHNEIDER ET LE CHARME DE KWAN 
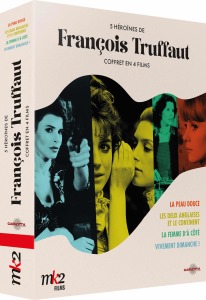
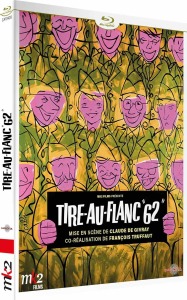 CINQ HEROINES
CINQ HEROINES
DE TRUFFAUT
En 1977, François Truffaut invente le personnage de Bertrand Morane dans L’homme qui aimait les femmes et le confie au magnifique Charles Denner. Mais on ne peut s’empêcher de voir derrière ce séducteur, le réalisateur lui-même… De fait, les femmes sont très présentes dans le cinéma de François Truffaut. Les héroïnes abondent, tout comme les égéries pour leur prêter leurs traits. On songe évidemment à Françoise Dorléac dans La peau douce, à Fanny Ardant dans La femme d’à côté et Vivement dimanche ! en passant par Kika Markham et Stacey Tendeter dans Les deux Anglaises et le continent. Les films du réalisateur phare de la Nouvelle Vague font clairement la part belle aux personnages féminins iconoclastes, à la fois puissants, sensibles, mystérieux et toujours romanesques. La peau douce (1964) où Jean Dessailly incarne un bourgeois parisien qui s’éprend d’une jeune hôtesse de l’air, Les deux Anglaises et le continent (1971) où un dandy parisien va s’inscrire, à l’aube du 20e siècle, au Pays de Galles, dans un audacieux trio, La femme d’à côté (1981) qui emporte Bernard et Mathilde dans un intense tourbillon amoureux et Vivement dimanche ! (1983), ultime film de Truffaut et savoureuse variation sur les codes du film noir sont à retrouver, pour la première fois, dans un beau coffret 4 Blu-ray (restauration 4K) et en coffret 4K Ultra HD (présentés en Dolby Vision). Cette bouleversante ode à la féminité est complétée par un documentaire inédit de David Teboul, François Truffaut, le scénario de ma vie (101 mn). Quelques mois avant sa disparition, le cinéaste se confie à son ami de jeunesse Claude de Givray et replonge dans son histoire familiale. Mais le temps va lui manquer pour achever son projet autobiographique. Il avait pour titre : Le scénario de ma vie. Enfin le coffret contient de nombreux suppléments (scènes commentées, images de tournage, entretiens et analyses). Toujours de Truffaut, voici un bel hommage au film noir avec Tirez sur le pianiste (1960) qu’il adapte d’un polar de David Goodis pour offrir à Charles Aznavour un rôle de pianiste de bar. Avec, en prime, une apparition de Boby Lapointe chantant Avanie et framboise. Le film est restauré 4K et est, là encore, accompagné de multiples suppléments dont un extrait de Étoiles et toiles (15mn) sur l’adaptation de Goodis par Truffaut. Enfin, dans cette belle séquence Truffaut, on déguste une sucrerie en forme de drôle de vaudeville ! Co-scénariste de Baisers volés et Domicile conjugal, Claude de Givray signe, avec Tire-au-flanc 62 sa première mise en scène, s’associant derrière la caméra avec son ami François. Combinant dialogues vifs et montage enlevé, le duo livre une subtile critique de l’absurdité des institutions, tout en illustrant l’esprit rebelle et ingénieux des jeunes conscrits. Une satire grinçante et percutante où l’on croise Cabu, Bernadette Lafont ou Pierre Étaix… Et là encore, de bons suppléments ! (Carlotta)
 MARIA
MARIA
C’est l’histoire d’une belle adolescente brune de 16 ans qui vit chez sa mère dans le Paris des années 68. Et qui a retrouvé son père. Qui n’est autre que le comédien Daniel Gélin. Qui ouvrira les portes des plateaux de cinéma à celle qui allait devenir, à son corps défendant, une actrice très sulfureuse à cause du Dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci. Avec Maria, la cinéaste française Jessica Palud s’empare d’une aventure tragique, celle de Maria Schneider, belle actrice dont la trajectoire fut complètement saccagée, un jour de 1972, lors du tournage du Dernier tango à Paris. En s’appuyant librement sur Tu t’appelais Maria Schneider (2018 chez Grasset et Fasquelle), le roman de Vanessa Schneider, journaliste au Monde et cousine de l’actrice, Jessica Palud se concentre sur son personnage central : « Être dans son regard et ne jamais l’abandonner » Porté par une Anamaria Vartolomei vibrante, farouche et fragile (et un épatant Matt Dillon en Marlon Brando) le film prend évidemment une résonance particulière alors que le cinéma français traverse de sérieuses turbulences liées à la fois à la question du consentement sur un tournage ou au cours d’un casting ou, plus globalement, aux affaires de violences sexuelles. Tout commence pourtant sous les meilleurs auspices. Bertolucci dit à celle qui sera sa Jeanne dans une relation torride et impossible: « Je vois en vous une page blanche, quelqu’un de blessé qui me plaît beaucoup ! » Si l’on se souvient du Dernier tango comme d’un grand poème plus funèbre que sexuel porté par la musique de Gato Barbieri, il apparaît clairement que ce film a fini par se résumer à cette fameuse scène dite du beurre. D’ailleurs, à l’époque, certains spectateurs demandaient, à la caisse des cinémas, « le film du beurre » ! La cinéaste va filmer le ressenti d’une actrice dominée par deux regards masculins, le basculement de la scène, la violence envers Maria Schneider et surtout le terrible silence du plateau. Jessica Palud souligne enfin que la trahison et la manipulation ne sont pas des outils nécessaires à la mise en scène de cinéma. Dans une ultime scène, alors que Maria Schneider enchaîne les interviews dans un press-junket, on lui glisse à l’oreille que Bertolucci est dans un salon voisin. Veut-elle qu’on organise une rencontre, une séance photo ? Elle lâche : « Je ne sais pas qui est cet homme. » (Studiocanal)
 STANLEY KWAN – LE ROMANTISME MADE IN HONG KONG
STANLEY KWAN – LE ROMANTISME MADE IN HONG KONG
« Pour moi, dit Stanley Kwan, raconter une histoire, c’est capturer l’expérience humaine, explorer les émotions et mettre en lumière des aspects de la vie autrement négligés. » Avec un beau coffret qui réunit quatre chefs-d’œuvre en version restaurées 4K et 2K, voici une plongée dans l’univers intimiste et romanesque d’un cinéaste né en 1957 et formé auprès de grands noms du cinéma hongkongais comme Ann Hui et Patrick Tam. Aux côtés de Wong Kar-wai et de Fruit Chan, Stanley Kwan fait partie de la troisième « Nouvelle Vague » apparue dans les années 1980. Alors en marge d’un cinéma commercial et populaire, le réalisateur fait appel, à ses débuts, à des acteurs célèbres, à l’instar de Chow Yun-fat dans Women (1985), pour se faire connaître et ainsi développer son propre ton et point de vue. Si son deuxième long-métrage, le mélancolique Amours déchus, obtient les faveurs de la critique, c’est avec son troisième film, le très romanesque Rouge (produit par Jackie Chan, alors roi incontesté du cinéma en Asie), que Kwan rencontre son public et devient la coqueluche des plus grands comédiens hongkongais. Avec son ambitieux « méta-biopic » Center Stage, le cinéaste franchira les portes de l’international avant d’opérer, dix ans plus tard, un virage plus intimiste avec Lan Yu. Virtuose du mélodrame, dont il maîtrise les codes avec une délicatesse et une sincérité rares, cet admirateur de Truffaut ou Ozu n’aura de cesse, à travers son œuvre, d’explorer la notion d’identité. Le coffret propose quatre films emblématiques du travail de Kwan qui mêle une mélancolie majestueuse à des réflexions complexes sur l’histoire, la société et la politique chinoise et hongkongaise. Amours déchus (1986) réunit trois amies qui essayent de devenir respectivement mannequin, actrice et chanteuse. Lors d’une soirée, elles rencontrent Tony Cheung, fils nonchalant d’un gros vendeur de riz. Mais l’une des femmes est assassinée… Rouge (1987) est une romance fantastique qui joue superbement d’atmosphères colorées pour suivre sur deux époques (1934 et 1987) les amours contrariées de la courtisane Fleur et de Chan Chen-pang, fils de bonne famille. Dans Center Stage (1991), Stanley Kwan met en scène entre documentaires, interviews et images d’archives ce qu’était la vie de Ruan Lingyu, grande actrice du cinéma muet du Shanghaï des années 1920, que l’on aimait comparer à Greta Garbo. Cinéaste à l’homosexualité revendiquée, sensible aux désirs et aux luttes des femmes, Stanley Kwan offre à travers ses films des vitrines de choix aux grands noms du cinéma hongkongais de l’époque, comme Maggie Cheung, Leslie Cheung ou Tony Leung Chiu-wai. Avec Histoire d’hommes à Pékin (Lan Yu en v.o.), libre adaptation d’un roman publié anonymement sur Internet, Stanley Kwan (qui a révélé son homosexualité en tournant le documentaire Yang ± Yin: Gender in Chinese Cinema, 1996), poursuit sa réflexion sur l’identité et le poids des conventions à travers la liaison entre le fils d’une famille aisée et Lan Yu, étudiant en architecture, que lui a présenté son employé, seule personne de son entourage à être courant de son homosexualité… (Carlotta)
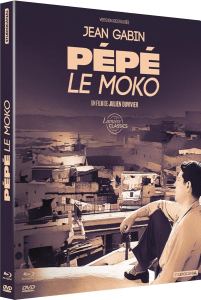 PEPE LE MOKO
PEPE LE MOKO
Attention, chef d’oeuvre ! Depuis des jours et des semaines, la police cherche à coincer le caïd du milieu parisien, Pépé le Moko, réfugié avec sa bande dans la Casbah d’Alger. Il y est intouchable, mais ne peut en sortir sans se faire arrêter. Sa vie bascule le jour où il tombe amoureux de Gaby, une jeune demi-mondaine, entretenue par un homme riche, passée là en touriste et représentant tout ce que la Casbah n’est pas : parisienne et sophistiquée. Cette relation est jalousée par Inès, maîtresse de Pépé. L’inspecteur Slimane, lui, suit tout cela très attentivement. Il compte sur les développements de ce triangle amoureux pour faire sortir le caïd de sa planque. Il pourra ainsi lui mettre la main au collet. « Pépé le Moko, écrivait Jacques Siclier, c’est l’installation officielle, dans le cinéma français d’avant-guerre, du romantisme des êtres en marge, de la mythologie de l’échec. C’est de la poésie populiste à fleur de peau : mauvais garçons, filles de joie, alcool, cafard et fleur bleue ». De fait, Julien Duvivier qui vient de donner successivement La Bandera (1935) et La belle équipe (1936), réalise, en 1937, avec Pépé le Moko (qui sort dans une belle version restaurée) l’une des œuvres les plus emblématiques du réalisme poétique français. Dans le décor merveilleusement exotique d’une Casbah reconstituée dans les studios de Joinville, il sublime le mélodrame tragique sur fond de romantisme désespéré et de vertige de l’échec. Cette adaptation du roman d’Henri La Barthe permet au cinéaste de filmer une inexorable fuite en avant forcément promise au drame. Le réalisateur de Panique (1946), autre chef d’oeuvre, joue sur du velours avec les dialogues d’Henri Jeanson, la musique de Vincent Scotto et evidemment ces fameux seconds rôles qui ont fait la gloire du cinéma français des années 30,40 et 50. On pense à Saturnin Fabre, Dalio, Charpin, Line Noro, Gaston Modot ou encore la chanteuse Fréhel. Quant à Jean Gabin, déjà présent dans La Bandera et La belle équipe, il accède, ici, au rang de vedette internationale. Et pour faire bonne mesure, il connaîtra une (brève) idylle avec Mireille Balin, sa partenaire, interprète d’une sulfureuse demi-mondaine. Gaby qui partira en brisant le coeur de Pépé. A jamais prisonnier de son territoire devenu piège. (Studiocanal)
 AU P’TIT ZOUAVE
AU P’TIT ZOUAVE
Dans un quartier populaire de Paris, Au P’tit Zouave est un sympathique boui-boui qui offre réconfort et sécurité aux habitants modestes du coin. Pourtant l’ambiance n’est pas au beau fixe. La police est sur les dents car un assassin de vieilles filles sévit dans les alentours. De plus, l’arrivée du mystérieux et fortuné M. Denis vient perturber l’équilibre déjà précaire de l’établissement. Aux yeux des jeunes loups de la Nouvelle vague, Gilles Grangier a été l’incarnation du cinéma académique des studios, bref du « cinéma à papa ». Pourtant diverses restaurations (Le sang à la tête, 1956, Echec au porteur, 1957, Trois jours à vivre, 1958 ou 125, rue Montmartre, 1959) par Pathé, ont permis de (re)découvrir les qualités d’un Grangier bien plus moderne qu’il n’y paraissait. Au P’tit Zouave fut, en 1950, le premier Grangier salué avec enthousiasme, tant par la critique que par le public. Le film rassembla plus d’un million de spectateurs. Entre comédie et film noir, utilisant une unité de lieu, le cinéaste organise son intrigue dans un décor unique, celui d’un bistrot parisien typique. On croise ici une belle brochette d’habitués du comptoir, joliment croqués. Débutant sur un mode comique, l’histoire tourne peu à peu au thriller, révélant les faux-semblants et la vérité des personnages. Grangier cultive une atmosphère populaire et jongle avec brio entre la comédie humaine du café et l’intrigue policière qui suit l’enquête du commissaire Bonnet lancé à la recherche de l’assassin. Dans cette perle du cinéma français des années cinquante, Grangier, qui mit souvent son ami Gabin à l’honneur, a constitué un excellent casting avec une galerie de personnages colorés. Dany Robin, surnommée à l’époque « la petite fiancée de la France », incarne la sensible et délicate Hélène, femme à la fois fragile et résolue, naviguant à travers les complexités émotionnelles avec une grâce naturelle. Fameux majordome (« Yes Sir ! ») des Tontons flingueurs, Robert Dalban est impeccable en patron receleur et le cinéaste a eu la bonne idée de confier à François Périer un contre-emploi qui lui permet de jouer sur son physique sympathique de jeune premier avant de révéler une noirceur inattendue. Autour d’eux, Paul Frankeur, Renaud Mary, Marie Daëms, Henri Crémieux, Jacques Morel, Annette Poivre campent de savoureuses figures. (Pathé)
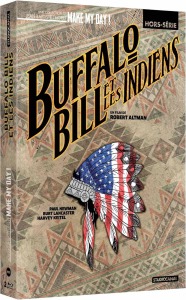 BUFFALO BILL ET LES INDIENS
BUFFALO BILL ET LES INDIENS
Dans les Etats-Unis de 1886, l’aventurier et tueur de bisons William Cody, dit Buffalo Bill, a quitté les vastes prairies. Il caracole sur la piste d’un cirque géant dans le Wild West Show (Le plus grand show de l’Ouest sauvage) tel un héros de la conquête de l’Ouest, devant des spectateurs ébahis. Hors de la scène, le personnage se révèle n’être qu’un cabotin vain et un alcoolique capricieux, mauvais tireur et piètre cavalier. Pour pimenter le spectacle, Buffalo Bill imagine d’engager le légendaire chef indien Sitting Bull, détenu par l’armée. Lors d’un spectacle auquel le président des États-Unis Grover Cleveland vient assister, Sitting Bull veut lui présenter des doléances pour son peuple mais il est éconduit. Tandis que le spectacle continue, Sitting Bull se montre bien meilleur que Buffalo Bill dans tous les domaines et ne tarde pas à ridiculiser son employeur… Juste après Nashville (1975), film choral sur la ville du disque et de la country, Robert Altman enchaîne avec cette chronique du show-business qui prend à rebrousse-poil la légende de l’Ouest américain telle que John Ford a pu la magnifier dans ses westerns. Malgré ses airs bravaches, Buffalo Bill n’est un pauvre type tristement alcoolique. Face à lui, Sitting Bull a, lui, tout d’une légende. Comme il le fit dans M.AS.H. (1970), Altman s’ingénie, avec une verve grinçante, à démonter les mythes… Le film n’eut pas un grand succès dans les salles. Et ce, malgré un superbe casting. Yeux plus bleus que jamais et bacchantes avantageuses, Paul Newman est Buffalo Bill. Autour de lui, on trouve Geraldine Chaplin dans le rôle d’Annie Oakley, célèbre pour sa redoutable précision au tir, Burt Lancaster en fabricant de légende ou encore Harvey Keitel et Joel Grey. Une description très sarcastique de l’Amérique ! Dans la collection Make my Day. (Studiocanal)
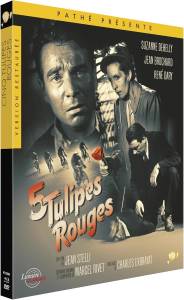 CINQ TULIPES ROUGES
CINQ TULIPES ROUGES
Pendant le Tour de France, cinq coureurs sont retrouvés assassinés avec une tulipe rouge près de leur corps. Une journaliste et un inspecteur de police mènent l’enquête pour démasquer le meurtrier. Nés quasiment en même temps, le Tour de France et le cinéma ne pouvaient que se rencontrer. Tout commence en 1925 avec un film muet de Maurice Champreux, Le Roi de la pédale, qui renouvela l’expérience en 1931 avec Hardi les gars. En 1932, Serge de Poligny signe Rivaux de la piste puis, l’année suivante, Robert Vernay tourne Prince de Six Jours. Au plan international, il faut attendre 1980 pour que l’on parle du Tour dans La bande des quatre de Peter Yates, qui raconte la fascination des cyclistes américains pour la Grande Boucle. Après Pour le maillot jaune (1940), charmante comédie sur les amours d’un coureur et d’une journaliste, le méconnu Jean Stelli va plus loin, huit ans plus tard, avec Cinq tulipes rouges, tourné en même temps que le Tour 1948, qui propose un hommage sportif et moderne de la compétition. Ici, la course est frappée par la malchance : certains favoris succombent dans des circonstances douteuses. L’inspecteur Ricoul (Jean Brochard) est alors mandaté pour retrouver le criminel, bientôt accompagné de Colonelle, une journaliste spécialiste du Tour (Suzanne Dehelly). Sur une trame « à la Agatha Christie », Stelli réunit aussi, dans ce thriller sur deux roues, quelques fins seconds rôles du cinéma français comme Raymond Bussières parfait en mécano ou René Dary (le Riton de Touchez pas au grisbi) en directeur sportif bouleversé… (Pathé)
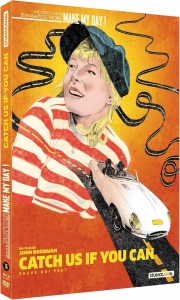 CATCH US IF YOU CAN
CATCH US IF YOU CAN
Mannequin pour une publicité télévisée pour de la viande, Dinah doit tourner sur le marché de Smithfield à Londres. Mais elle est de moins en moins motivée… Steve et ses quatre amis Lenny, Mike, Rick et Dennis n’ont guère de peine à la persuader de fuir les fausses valeurs du monde commercial. Steve et elle s’enfuient à bord d’une Jaguar Type E appartenant à la production. Lorsque Leon Zissell, le responsable de la publicité, réalise que sa Butcha Girl a disparu, il va transformer sa fuite à travers l’Angleterre en coup publicitaire. Après avoir débuté comme critique de cinéma dans des revues et à la radio, John Boorman va se voir proposer en 1965 la commande d’un film pour mettre en avant le groupe de rock britannique The Dave Clark Five qui faisait partie, comme les Beatles, de la British Invasion. A l’instar du Quatre garçons dans le vent de Richard Lester pour les Beatles, Boorman entre donc dans le monde du cinéma avec cette aventure qui mêle le road movie et le musical, les chansons du Dave Clark Five servant évidemment, ici, de b.o.. Dans son excellent collection Make my Day, Jean-Baptiste Thoret « exhume » ce Sauve qui peut (en v.f.). Même si Boorman n’est pas encore le cinéaste d’Excalibur (1981) et de Delivrance (1972), il se sort plutôt pas mal de cette commande. On trouve, ici, des séquences étonnantes comme celle de la communauté hippie gravement shootée ou encore celle du couple âgé, semble-t-il conservateur et « tradi » mais porté sur l’échangisme. Enfin le ton est souvent amer, jusque dans un dénouement où le périple de Dinah s’achève dans un endroit bien tristounet. L’année suivante, Boorman frappera fort avec Point Blank et un fameux Lee Marvin… (Studiocanal)
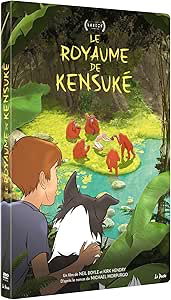 LE ROYAUME DE KENSUKE
LE ROYAUME DE KENSUKE
L’aventure de Michael, 11 ans, commence comme un beau rêve. Il est en effet parti faire le tour du monde à la voile avec ses parents. L’océan est vaste, survolé par de grands oiseaux tandis que les dauphins dansent autour du voilier. Mais la tempête menace et une gigantesque vague emporte Michael et sa chienne Stella. Quand Michael reprend ses esprits, il a échoué sur le sable d’une île déserte. Désormais la question cruciale pour le gamin désespéré, c’est comment survivre. Un mystérieux inconnu vient alors à leur secours en leur offrant à boire et à manger. C’est Kensuké, un ancien soldat japonais vivant seul, depuis la fin de la guerre, sur cette île avec ses amis les orangs-outans. Cet homme méfiant va cependant ouvrir à Michael les portes de son royaume. Lorsque des trafiquants de singes tentent d’envahir l’île, c’est ensemble qu’ils uniront leurs forces pour sauver leur paradis… Au départ de ce beau film d’animation, il y a le roman éponyme du Britannique Michael Morpurgo paru en 1999, destiné à un lectorat préadolescent et adolescent et inspiré du légendaire Robinson Crusoé. Neil Boyle et Kirk Hendry se sont emparés de cette histoire pour mettre en images l’aventure d’un jeune adolescent apeuré, isolé et coupé des siens et de ses repères. Mais voilà que l’étrange Kensuké montre le bout de sa mince barbichette. Entre l’enfant et le vieil homme, on va passer par des moments d »incompréhension et d’apprivoisement. Et puis il y aura la rencontre magique avec des orang outangs dont Kensuké semble être le gardien. L’image est belle, jouant sur des couleurs pastels qui viennent en contrepoint d’une fable écologique qui pointe l’intrusion violente des pilleurs d’animaux sauvages. Avec Kensuké et Michael, on arpente avec bonheur les espaces luxuriants d’un paradis très fragile. (Le Pacte)
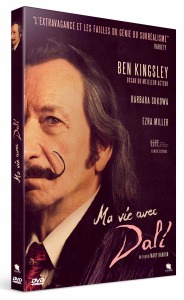 MA VIE AVEC DALI
MA VIE AVEC DALI
A New York, en 1973, James, jeune propriétaire d’une galerie, est invité à l’une des fêtes organisées par le célèbre peintre Salvador Dalí. Après avoir pénétré dans un univers exquis, le galeriste est censé assister l’artiste espagnol dans les préparatifs d’une grande exposition, une opportunité unique pour lui. Mais plus il passe de temps avec l’artiste extravagant, plus il plonge dans les difficultés financières, mais aussi relationnelles du peintre. En effet, James comprend que la relation apparemment solide entre Dalí et sa femme, Gala, tout aussi excentrique, est sur le point de voler en éclats. Révélée par I Shot Andy Warhol (1996) et réalisatrice en 2000 d’American Psycho dans lequel Christian Bale incarnait un golden boy doublé d’un assassin psychopathe, la cinéaste canadienne Mary Harron propose (avant le Daaaaaali de Quentin Dupieux sorti en 2023) un biopic de l’excentrique maître de Cadaquès. Daliland (en v.o.), centré sur la relation entre le galeriste et le peintre, met bien en valeur l’univers coloré de Dali tout en représentant, dans un style assez rock’n roll, la frénétique vie mondaine dans laquelle baigne l’artiste le plus rentable de sa génération… La cinéaste a confié le Dali de l’âge mûr au Britannique Ben Kingsley devenu célèbre en 1982 en se glissant dans la peau d’une autre grande figure réelle, Gandhi. Pour sa part, Ezra Miller joue un Dali jeune dans quelques séquence en flash-back. Enfin c’est Barbara Sukowa, l’inoubliable égérie de Fassbinder dans Lola, une femme allemande, qui s’empare du personnage de Gala… (Condor)
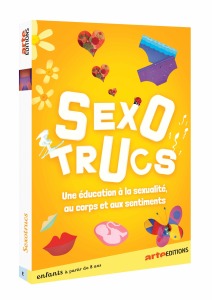 SEXOTRUCS
SEXOTRUCS
Dans une époque où le sexe est omniprésent sur tous les supports de communication et où l’on est en droit de s’interroger sur la manière dont les plus jeunes se retrouvent face à ce problème, voici une série réalisée par Pauline Brunner, Maxime Gridelet et Marion Verlé qui proposent quelques clés pour préparer les enfants à décrypter les écrans et les idées reçues auxquels ils vont être confrontés… Experte en éducation à la sexualité et en sentiments, Lili a les réponses à toutes les questions que peuvent se poser les enfants : c’est comment le sexe féminin à l’intérieur ? En vrai, deux garçons, ça peut s’aimer d’amour ? Comment on fait les bébés ? C’est quoi la puberté ? Et le consentement ? Au fil de ses explications, elle embarque le jeune spectateur dans son univers poétique et décalé fait de papier découpé et d’objets animés… Cette série qui développe ses thématiques de façon ludique et adapté aux enfants, propose vingt épisodes : La puberté masculine – Le sexe féminin – Les sentiments amoureux – L’orientation sexuelle – Le consentement – La puberté féminine – L’érection – L’égalité filles / garçons – Le sexe masculin – Le sperme – Les violences sexuelles – Comment on fait les bébés ? – L’inceste – L’intimité – Faire l’amour – La pornographie – Les règles – Les différentes familles – L’hygiène intime – L’identité de genre. (Arte éditions)
 LA PETITE VADROUILLE
LA PETITE VADROUILLE
Voici, d’un côté, Franck, un gros investisseur assez content de lui qui peut mettre 14.000 euros dans un week-end insolite en « amoureux » et, de l’autre, une troupe de solides pieds-nickelés qui se disent, enthousiastes, qu’il y a sûrement une bonne marge à se faire pour remettre à flot leurs comptes bien défaillants. Le dit week-end doit se dérouler à bord d’une péniche et lors d’un périple au cours duquel Franck (Daniel Auteuil) entend bien séduire sa collaboratrice Justine (Sandrine Kiberlain)… Une Justine qui, évidemment, a partie liée avec les branquignols. Le cinéma de Bruno Podalydès est un cinéma qui aime à musarder. Verbe intransitif qui se définit de la sorte : Passer son temps à rêvasser, flâner en s’attardant à des riens. Et c’est bien ce qui caractérise cette petite vadrouille. L’idée de son film est venue à l’aîné des Podalydès lors de petites croisières fluviales en famille à bord d’une péniche. Le cinéaste a donc bâti une comédie complètement fantaisiste dans laquelle il invite à embarquer en compagnie de personnages évidemment loufoques dont le capitaine Jocelyn, uniforme immaculé qu’il incarne lui-même. Sur fond de friction générationnelle un brin nostalgique, voici une comédie qui revendique de ronronner et qui ose un paisible éloge de la lenteur dans un monde qui va toujours plus vite. (UGC)

